
Carmen Yáñez, comment survit-on à l’enfer ?
Avec l’unique conviction d’avoir la raison et la vérité comme principe éthique. Il suffit d’avoir le regard et l’attitude d’un être humain qui éprouve de l’empathie envers ses semblables.
En 1975, vous avez été incarcérée et torturée dans les prisons de Pinochet, puis en 1981, vous avez dû quitter le Chili, affrontant de nouvelles douleurs et souffrances. Comment avez-vous vécu cet arrachement à votre pays, à vos proches, à votre famille ?
L’exil est un effet collatéral de la souffrance d’un peuple qui doit émigrer, doit renoncer à toute vie et à tout projet d’avenir, sans avoir de terre sous les pieds. Il s’agit d’une nouvelle construction de soi qui n’est pas sans incertitude.
Depuis, vous avez partagé le sort de l’émigrant et la condition de l’exilé. Votre voyage d’émigrante, votre exil, ont-ils jamais pris fin ?
Je l’ai vécu intensément, dans mon cas, il s’agissait aussi d’apprendre de nouveaux codes et une nouvelle langue. Je crois que le voyage ne s’arrête jamais, et j’essaie quoi qu’il en soit de construire ma maison où que je sois.
Avez-vous jamais perdu espoir ? Si oui, quand ?
Oui, quand on perd un être cher soudainement, quand la douleur de cette perte est déchirante. Puis, petit à petit, on se relève pour se reconstruire et recommencer.
A quel espoir vous êtes-vous accrochée quand vous avez vu toute cette obscurité ?
La vie m’a toujours sortie de l’obscurité, la mienne, celle de ma descendance (enfants, petits-enfants).
Que ressentez-vous à l’égard de vos bourreaux ?
Je ne ressens pas de haine, car la haine retourne vers celui qui hait, et je ne ressens pas non plus de pitié. Oui, je crois en la justice, je crois que tout le monde devrait payer pour ses crimes. Je ne serais pas capable de faire ce qu’ils ont fait à leurs prisonniers. Une punition suffisante est de les priver de leur liberté, car ils étaient et sont toujours un danger public. Il n’y a ni pardon, ni oubli : c’est ma devise et celle de tous ceux de ma génération qui ont souffert sous les dictatures.
Votre mari, Luis Sepúlveda, a lui aussi vécu la même expérience : prison et exil après le coup d’Etat de 1973 contre Salvador Allende. Vous avez tous deux continué à lutter pour la justice sociale, où avez-vous puisé votre force et votre courage ?
Parce que nous avons toujours été convaincus que les biens de la nature de ce monde doivent appartenir à tous les êtres de ce monde. L’inégalité n’a apporté que tristesse, déception, misère et drames humains.
Quels sont les plus grands risques pour la planète et l’humanité ?
L’ambition, la cupidité de certains êtres humains impitoyables et narcissiques qui sont responsables de l’inégalité de ce monde. Eux sont les propriétaires, les autres ne sont que des moutons consuméristes. Le changement climatique est évident dans différentes parties de la planète. Nous assistons au plus grand crime de l’humanité, mais le Pouvoir ne met pas un frein à ce désastre.
A quels espoirs devons-nous et pouvons-nous nous accrocher ?
Mon espoir est que les êtres humains trouvent équilibre, gentillesse, valeurs éthiques, empathie envers leurs semblables, sagesse.
Quelles sont vos peurs personnelles ?
Je suis attentive à ma famille, à mes amis, je prends soin d’eux, même s’ils vivent loin de moi.
Et vos espoirs ?
Un avenir sans peur.
Votre vie, vos amours, vos espoirs, votre nostalgie pour votre pays transparaissent dans vos poèmes. Dans quelle mesure imprègnent-t-ils votre vie quotidienne ?
Je voulais donner voix à ceux qui, comme moi, ont émigré à la recherche d’un lieu dans le monde où survivre.
A travers les paroles et la mémoire, une lueur d’espoir apparaît-elle ?
Sans mémoire, sans histoire, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs. Seule la mémoire historique nous révèle l’avenir hypothétique de la terre.
Comment construisez-vous l’espérance, pour vous-même et pour les autres ?
Avec ma seule arme, les mots.
La mémoire est-elle une arme de justice ?
Une puissante arme de justice.
Vous avez dit que pour vous et Luis Sepúlveda, la littérature était devenue votre nouvelle patrie. Mais y a-t-il quelque chose qui vous a manqué dans cette seconde patrie ?
Parfois, nous, migrants, avons le sentiment de n’appartenir à aucun endroit. Nous sommes devenus citoyens du monde, universels. Nous n’appartenons à aucun endroit et à tous les endroits à la fois. Peut-être nous manque-t-il le sentiment d’appartenance, les amis d’enfance, les lieux physiques où nous avons commencé notre voyage dans la vie.
Quel pouvoir la littérature peut-elle avoir aujourd’hui pour promouvoir la prise de conscience des risques et réveiller l’espoir ?
La littérature est une immense fenêtre qui permet d’observer le monde et d’apprendre à le connaître. L’histoire qui n’est pas officiellement racontée. La mémoire ouverte.
Juan Belmonte est le personnage principal du livre « Un nom de torero » de Sepúlveda. Il apparaît comme un homme qui, après avoir mené de nombreuses batailles, se sent désabusé et réticent à combattre à nouveau. Pourquoi, selon vous ?
Juan Belmonte est un personnage qui a perdu des batailles petites et grandes, c’est un perdant, mais il essaie toujours à nouveau, car son désir de justice est plus fort que la peur de perdre à nouveau.
Belmonte est-il Sepúlveda lui-même à certains moments de sa vie ?
De nombreux écrivains ont coutume d’emprunter un peu de leur biographie pour construire leurs personnages, ainsi que les sentiments décrits dans l’histoire, avec une bonne dose de fiction.
Et Veronica, l’épouse qui, dans le livre, ne s’est jamais relevée de la dictature, est-ce vous ?
Oui, en partie, mais il décrit également une femme complètement détruite, victime de la torture. Dans mon cas, j’ai réussi à surmonter cet épisode.
Sepúlveda et vous avez-vous jamais senti le poids du témoignage, de devoir raconter ?
Ce n’est pas facile, c’est un poids que nous porterons toujours. Je n’en ai pas parlé pendant de nombreuses années. J’imagine que Luis a vécu la même chose. Il y avait la peur et la honte d’en parler. C’est une larme profonde.
Pensez-vous, comme l’écrit Sepulveda, que « l’ombre de ce que nous avons fait et de ce que nous avons été nous poursuit avec la ténacité d’une malédiction » ?
Nous sommes faits de ce que nous étions, nous ne pouvons pas changer cette histoire, nous devons l’accepter et partir de là pour vivre jusqu’à la fin en cohérence avec ce que nous sommes aujourd’hui.
Conseillez-nous trois livres à lire pour alimenter la mémoire et l’espérance
J’ai reçu récemment un livre d’un écrivain uruguayen que je recommanderais : « Las Cenizas del Cóndor » de Fernando Butazzoni. Il raconte en partie l’histoire de notre Amérique latine frappée par les coups d’Etat des années 70. Sous le couvert du sinistre plan de torture et d’extermination « Le plan Condor » qui nous a laissé tant de désolation. Cependant, ce livre continue d’ouvrir des lueurs d’espoir. Nous croyons dans les êtres humains que nous sommes.
L’autre est « Look Back » de l’écrivain colombien Juan Gabriel Vásquez, basé sur des faits réels concernant les relations entre parents et enfants marquées par les idées politiques et le fanatisme.
Le troisième est « La guerra perdida » de l’écrivain mexicain Jordi Soler. L’histoire d’une famille d’exilés d’origine catalane. Leur dangereux voyage. Les pertes et la façon dont ils survivent au cœur de la jungle, en attendant la chute du dictateur qui les a arrachés à leurs racines.
Lucia Capuzzi
Journaliste «Avvenire»
Nous remercions Daniel Mordzinski de nous avoir aimablement autorisés à utiliser, pour cet article, la photographie représentant Carmen Yáñez et Luis Sepúlveda.
La plus belle histoire d’amour
Carmen Yáñez et Luis Sepúlveda sont deux figures emblématiques de la lutte contre les dictatures sud-américaines et mondiales. Tous deux ont été persécutés par le régime de Pinochet au Chili : Luis a été emprisonné et torturé immédiatement après le coup d’Etat de 1973, puis libéré grâce à la forte pression exercée par Amnesty International, avant d’être exilé ; Carmen a été arrêtée en 1975, torturée et elle aussi contrainte à l’exil.
Leur union a été profonde tant sur le plan personnel que politique. Ils se sont mariés deux fois : la première fois, très jeunes, en 1971, et l’année suivante, Carlos est né. La deuxième fois, en 2004, après que la vie les ait séparés et réunis à nouveau, car leur amour n’était pas éteint.
Pour Carmen Yáñez, la poésie a été un outil de mémoire et de résistance, tandis que pour Luis Sepúlveda (décédé à 70 ans en 2020, des suites du Covid), la littérature est devenue le moyen de raconter les injustices et les souffrances. Ensemble, ils ont construit une seconde patrie faite de mots et d’espoir, toujours convaincus que la mémoire et la justice sont les clés d’un avenir meilleur.
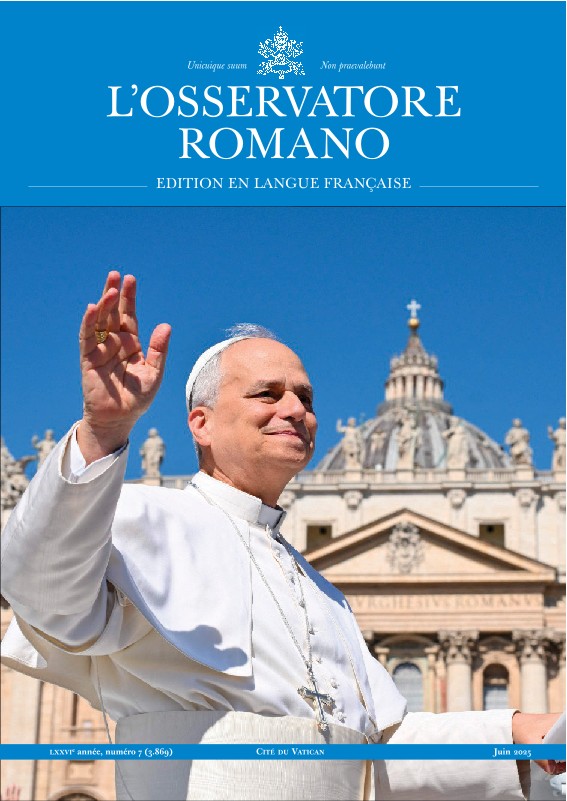



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti