
« Je suis comblée de joie par l'élection du Pape Léon XIV. C'est une véritable bénédiction pour l’Eglise », dit sœur Norma Pimentel, avec un sourire qui semble traverser l'écran. « Le Pape François nous a appris à défendre la dignité humaine, en particulier celle des personnes qui vivent en marge de la société. Et maintenant, je vois la même préoccupation chez le Pape Léon XIV : sa présence auprès des pauvres, sa compassion, sa capacité à inspirer l'espérance. Il défie les injustices qui causent la souffrance et nous invite tous au dialogue et à l'engagement pour construire l'unité. Comme nous le rappelle sa devise : « In Illo uno unum; “En celui qui est un, soyons un” ».
Dialogue. Espérance. Tels sont les mots qui guident la vie de sœur Norma, religieuse mexicaine et américaine qui a toujours été proche des derniers : les migrants, les pauvres, les marginaux. Et aujourd'hui plus que jamais.
Son énergie est palpable, même à travers l'écran. Chaque mot abolit les distances, va droit au cœur.
Cheveux courts argentés, yeux marron clair, sœur Norma Pimentel – 72 ans, des Missionnaires de Jésus, née à Brownsville (Texas) de parents mexicains – ne cache pas son émotion lorsqu'elle parle des migrants. Pour elle, chaque histoire est un visage, chaque injustice une douleur qui la touche profondément. Depuis plus de quarante ans, elle panse les blessures imprimées dans leur chair et leur esprit suite aux violences subies dans leur pays d'origine et leur fuite, à des centaines de milliers de kilomètres plus au nord, vers la frontière sud des Etats-Unis. Là, sœur Norma dirige les Caritades Católicas de la vallée du Rio Grande, à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, offrant un abri, des soins et une assistance à des dizaines de milliers de réfugiés. En 2015, le Pape François a publiquement salué ses efforts et a souhaité la rencontrer lors de son voyage à New York. Figurant dans la liste des cent personnes de l'année du magazine Time en 2020, la religieuse, diplômée des beaux-arts, est également connue comme peintre.
Pourquoi êtes-vous préoccupée sœur Norma ?
Lorsque l'administration de la Maison Blanche a changé, nous avons immédiatement commencé à lire dans les yeux des migrants une tristesse, une angoisse et un désespoir sans précédent. Sur leurs visages était gravée la question : « Que va-t-il se passer maintenant ? ». Je ne parle pas seulement des réfugiés dont le rendez-vous pour demander l'asile à la frontière a été annulé du jour au lendemain et qui sont restés bloqués sur les ponts internationaux des villes frontalières. Je parle de ceux qui résidaient aux Etats-Unis depuis des années. Des familles avec un emploi, une maison, une stabilité.... Tout ce qu'ils avaient construit risquait de s'effondrer. J'ai alors compris que ma mission était de leur redonner espoir ».
Sœur Norma, comment peut-on redonner de l'espoir à ceux qui voient leurs certitudes s'effondrer ?
Jusqu'en janvier, ce sont les personnes qui venaient de franchir la frontière qui frappaient aux portes de nos centres pour recevoir de l'aide et de l'assistance. Parfois, c'était la police des migrants elle-même qui les accompagnait. Mais mois après mois, leur nombre a diminué. Dans le même temps, les besoins des migrants « de longue durée », mais toujours en situation irrégulière en raison d'un certain nombre de restrictions juridiques, se sont accrus. Ils ont peur de quitter leur domicile, d'aller travailler, d'envoyer leurs enfants à l'école par crainte d'être arrêtés et expulsés. Ils sont littéralement terrorisés. Dans mon association, nous nous sommes donc demandé : comment faire pour que ces personnes sentent que l’Eglise est proche et accompagne leur souffrance ? Nous avons donc commencé à nous organiser en petits groupes pour aller à leur rencontre. Nous nous rendons dans les paroisses et les associations et nous expliquons aux migrants leurs droits, ce qu'il faut faire en cas de détention, à quels avocats ils peuvent s'adresser. Surtout, nous témoignons du fait que nous sommes avec eux. Qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ensemble, nous pouvons affronter tout cela. Nous les écoutons, nous cherchons des solutions à leurs problèmes pratiques et nous essayons de les préparer pour qu'ils soient prêts, psychologiquement, à faire face à ce qui pourrait leur arriver.
Dans de nombreux pays, on assiste à l'émergence de partis et de dirigeants qui proposent une poigne de fer pour freiner les migrants. D'où vient toute cette hostilité à leur égard ?
La politique s'est « emparée » de la question migratoire et l'a transformée en une puissante arme électorale. Par le biais d'un faux récit, les migrants sont présentés comme des intrus qu'il faut craindre. Ils sont privés de leur droit d'être des personnes et transformés en criminels, en profiteurs, en fainéants à entretenir, qui sont venus dans nos pays pour nous voler des emplois, des ressources et la sécurité. De ce point de vue, ils ne méritent aucune pitié. La peur justifie l'adoption des politiques les plus impitoyables à leur égard.
La rhétorique anti-immigrés a souvent beaucoup de succès chez les travailleurs les plus modestes, dans les banlieues, dans les classes populaires. Même eux ne réussissent pas à éprouver de l'empathie pour ceux qui vivent dans des conditions similaires ?
Le fait est que les citoyens disposant de moins de ressources sont les plus vulnérables à la peur. Ils se sentent fragiles, impuissants, parfois en colère, et pensent qu'un gouvernement « fort » pourra les défendre contre les difficultés croissantes auxquelles ils sont confrontés. Ils croient donc facilement à la menace de «l'ennemi extérieur» attisée par une rhétorique mensongère. Aux Etats-Unis, cependant, beaucoup commencent à se rendre compte de la supercherie. Certains commencent à revoir leur position. Les personnes expulsées ne sont pas des criminels en puissance : ce sont des voisins, des amis, des familles connues, des paroissiens, des camarades de classe de nos enfants. La vérité est que les migrants ne viennent pas pour prendre quelque chose, mais pour donner.
Que nous apportent les migrants ?
Ces dernières années, j'ai rencontré et cherché à aider plus d'un demi-million de migrants. Cela m'a en quelque sorte obligé à réfléchir à ce qu'ils représentent pour les Etats-Unis. J'ai acquis la conviction qu'ils nous apportent bien plus que leur contribution matérielle en termes de travail. En les regardant prier, à genoux, j'ai réalisé que les migrants viennent nous sanctifier par leur présence parmi nous. Notre pays, imprégné de leur énorme souffrance et de leur tout aussi grande résistance pour y faire face, devient une terre sainte. Les réfugiés ont tout perdu et pourtant ils parviennent à aller de l’avant et à arriver jusqu'ici. Leur exode est un acte de foi en la vie et en Dieu : Ils laissent derrière eux toute certitude, ils subissent toutes sortes d'abus en chemin, et pourtant ils continuent avec la force de l'espérance dans la possibilité d'atteindre un ailleurs sûr. Parfois, dans nos centres d'accueil, je vois des hommes se lever au milieu de la nuit, aller à la chapelle et, dans l'obscurité, parler au Seigneur avec une confiance et un naturel émouvants. Je remercie alors le Père pour ces frères qui sanctifient nos maisons et nos communautés. Nous, les Américains, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons. En claquant la porte au nez des migrants, en les jetant dehors sans pitié, nous nous fermons à Dieu. Il me vient à l’esprit les paroles de Jésus sur la croix : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». J'espère que le Seigneur nous pardonnera vraiment.
Sœur Norma, vous avez souvent parlé d'espérance. Quels sont les espoirs de ceux qui viennent chercher refuge dans nos pays ?
Chaque histoire est différente, mais on retrouve des traits communs. Si l'on demande à un père pourquoi il est venu, il souligne généralement la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille. Les mères, quant à elles, au lieu de parler, montrent l'enfant à leurs côtés et disent simplement : pour lui ou pour elle. Elles sont à juste titre terrorisées à l'idée qu’ils soient recrutés par des gangs criminels. C'est ce qui leur donne la détermination de partir et de les emmener dans un lieu où ils pourront s'épanouir et étudier. Les enfants, quant à eux, espèrent retrouver leur père ou leurs parents lorsqu'ils arrivent par leurs propres moyens.
Que conseilleriez-vous aux gouvernements soucieux d'ériger des murs, physiques ou juridiques, pour arrêter les migrants ?
C'est le président Reagan qui a déclaré que les Etats-Unis sont fondés sur l'accueil des migrants du monde entier. C'est une terre d'opportunités pour ceux qui veulent contribuer à la communauté et l'améliorer. Je pense que cela ne s'applique pas seulement aux Etats-Unis. Chaque pays bénéficie de l'apport de talents, de vies, de valeurs de ceux qui le rejoignent. En nous refermant sur nous-mêmes et en empêchant les autres de faire partie de notre présent et de notre avenir, nous nous privons de la possibilité de progresser en tant que société. Plutôt que de se contenter de fermer les frontières, les gouvernements devraient faire preuve d'un sérieux discernement pour mettre en œuvre une politique migratoire ordonnée, capable d'accueillir et d'intégrer véritablement les personnes.
En 2019, vous aviez exhorté le président Trump à venir rencontrer les migrants dans l'un de vos centres d'hébergement. Aujourd’hui lui adresseriez-vous la même invitation ?
Bien sûr. Il est essentiel de voir, d'écouter, de parler aux migrants en chair et en os avant de prendre des décisions à leur sujet. Lorsque nous nous approchons d'une réalité, nous la laissons nous « provoquer ». Nous nous ouvrons en quelque sorte à Dieu, qui nous parle à travers ce qui se passe. En regardant les visages des réfugiés, nous nous donnons la possibilité de découvrir en eux le visage du Christ. Les yeux fixés sur Lui, les citoyens et les dirigeants pourront faire des choix justes, pour le bien des peuples et de l'humanité.
Le Pape François a exprimé le rêve d'une Eglise pauvre pour les pauvres, un hôpital de campagne, une mère pleine de miséricorde. Pensez-vous que les catholiques américains font des pas dans cette direction ?
Les prêtres, les évêques sont sincèrement engagés dans l'effort pour apporter un message de miséricorde à la société. Malheureusement, de nombreux fidèles sont effrayés. La crise mondiale, le faux récit sur les migrants, les conséquences de dire ou de faire quelque chose à contre-courant les terrorisent. Et la peur les rend prisonniers. C'est pourquoi tant de gens font semblant de ne pas voir ce qui arrive aux migrants. L’Evangile est pourtant clair : accueillir le pauvre et l'étranger, signifie accueillir Jésus. L’Eglise ne peut se soustraire à la tâche de l’annoncer avec force, aujourd'hui et toujours.
La peur est le contraire de l'espérance, la vertu chrétienne par excellence à laquelle le Jubilé est consacré. Qu'est-ce qui rend si difficile d’espérer ?
L’individualisme dont nous sommes les otages. La concentration obsessionnelle sur nous-mêmes nous fait perdre de vue les autres. La perte du contact humain est ce qui me préoccupe le plus. Malheureusement, internet et les réseaux sociaux favorisent la virtualisation du monde et de la société, surtout chez les jeunes. L’isolement nous vole l’espérance. Ce n’est qu’en marchant ensemble que nous pouvons nous soutenir. Seuls, sans Dieu et sans nos frères, il est difficile de trouver la force d’aller de l’avant. Je ne le pourrais pas. Je ne pourrais pas aller de l’avant sans la certitude que Dieu est présent dans mon existence et qu'il m’accompagne. C'est pourquoi j’aime commencer ma journée par un moment d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. C'est le Seigneur qui me donne l’espérance que mon combat quotidien n’est pas vain. Que le mal, la douleur, l'angoisse ne dureront pas toujours. Ma mission et celle de chaque chrétien est alors de rendre tangible la présence de Dieu, ici et maintenant. En essuyant les larmes de ceux qui pleurent, en pansant les plaies de ceux qui sont abandonnés, en écoutant les lamentations des affligés. Surtout en se tenant aux côtés de ceux qui souffrent au moment des ténèbres, dans l'attente de la lumière. Parce que la lumière viendra.
Ritanna Armeni et Lucia Capuzzi
Journaliste au quotidien italien «Avvenire»
#sistersproject
Victime de la Bête
La Bête est ce train de marchandises infernal qui traverse le Mexique du sud au nord, utilisé par des centaines de milliers de migrants fuyant la misère, l’insécurité et les dictatures, et se dirigeant vers la frontière avec les Etats-Unis d’Amérique. Les migrants, parfois sans billet, montent à bord de ces convois et, au cours d’un voyage qui peut durer plusieurs semaines, endurent la faim, la soif, la chaleur, le froid et souvent même la violence.
« La bête, c’est comme cette magnifique petite fille qui a perdu ses jambes. Sa mère, son père et ses deux frères, tous les cinq, ont tenté de monter dans le train au Mexique, et la petite fille a perdu l’équilibre lorsque le train s’est éloigné après s’être arrêté quelques secondes seulement. Le train est reparti en entraînant la petite fille. La mère, saisissant désespérément un pied de la petite fille retrouvé entre les rails, a fait le tour des villes pour demander de l’aide afin d’arrêter le train. Sa fille a été emmenée à l’hôpital où elle a reçu des soins médicaux ». C’est ce qu’écrit sœur Norma Pimental sur son profil facebook.com/nonaseni. Des indications sont données pour faire un don.
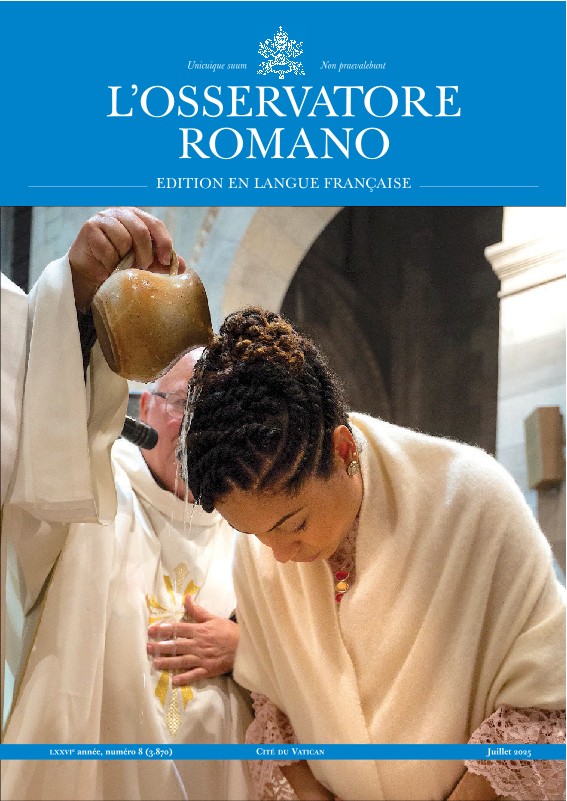



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti