
Charles de Pechpeyrou
Dans le monde d’aujourd’hui, marqué par des crises multiples au niveau social, économique aussi bien qu’écologique, le charisme de saint Vincent de Paul est plus que jamais d’actualité. Notre siècle malade, où règne l’exclusion, a besoin d’être guéri par des figures semblables au bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur des Conférences saint Vincent de Paul au xixe siècle, résolument engagé contre l’exclusion, toujours attentif à intégrer son prochain. L’auteur de cet appel est Mgr Benjamin Marc Balthason Ramaroson, archevêque d’Antsiranana, à Madagascar, membre de la Congrégation de la Mission, comme de très nombreux prêtres de l’île. «Je compare ce que nous sommes en train de vivre avec ce qu’a vécu saint Vincent au xviie siècle avec toutes les crises qui ont marqué son temps — explique le prélat lazariste à notre journal — guidé par l’Esprit Saint, il a réussi à fonder la Congrégation de la Mission dans une situation très critique à ce moment-là». Plus près de nous, poursuit Mgr Ramaroson, le bienheureux Lucien Botovasoa, instituteur et militant catholique malgache, assassiné in odium fidei au cours de la persécution menée contre le clergé durant la décolonisation, «constitue également un exemple de réconciliation». «Malheureusement — note l’archevêque malgache — ce qui se produit actuellement dans le monde interpelle toute la famille vincentienne: nous sommes appelés à être des témoins de ce que j’appelle la “charité intégrale”, dans le même esprit que l’écologie intégrale, des pèlerins de l’espérance».
Né en 1955 à Manakra, sur la côte sud-est de Madagascar, Benjamin Marc Balthason Ramaroson est inscrit pendant deux ans à l’Université d’Etat d’Antananarivo. Il fait profession comme membre de la Congrégation de la Mission en 1980, puis est ordonné prêtre le 15 août 1984. Après avoir été curé à la cathédrale de Farafangana de 1984 à 1989, il étudie à l’Université pontificale grégorienne pour obtenir un doctorat en théologie spirituelle. Le prêtre lazariste est nommé évêque de Farafangana le 26 novembre 2005 et huit ans plus tard, il devient archevêque de Antsiranana. Ces différentes fonc-tions ne l’empêchent pas de garder une attention pastorale toute particulière envers les catholiques vivant dans la brousse: lorsque nous l’interrogeons, le prélat revient précisément d’une visite pastorale en milieu rural.
Se définissant comme un «avorton lazariste», de même que saint Paul se considérait comme un «avorton de Dieu», Mgr Ramaroson ne cache pas son attachement depuis toujours envers sa congrégation. «Dès mon enfance, ma famille côtoyait des prêtres lazaristes, très présents dans le sud-est de Madagascar, ma mère était respon-sable des mouvements mariaux et souvent je l’accompagnais. A la suite de quoi j’ai accompagné également des prêtres en tournée en brousse et c’est ainsi que j’ai vu comment ces derniers évangélisaient, animés par cet amour et cette proximité envers les gens, surtout les plus démunis, qu’ils aident à sortir de la pauvreté. En parlant avec les missionnaires et en lisant l’histoire de saint Vincent de Paul, j’ai pu connaître le charisme des anciens. Pour moi, ce charisme est très important pour l'évangélisation, enracinée dans une pastorale qui va vers les gens, proche du Peuple de Dieu».
L’archevêque d’Antsiranana se plaît à rappeler les liens étroits entre son pays et Vincent de Paul, second saint patron de Madagascar après la Vierge Marie. «De son vivant, déjà, saint Vincent a voulu venir évangéliser la Grande Île, où il a envoyé les meilleurs missionnaires. Ces derniers se sont vraiment intéressés aux traditions, aux coutumes et à la culture malgaches en commençant par la langue. Le premier livre écrit en malgache dans l’alphabet latin n’est autre que le Catéchisme de l’Eglise catholique. Nous l’appelons “Catéchisme de Nacquart”, du nom du premier missionnaire envoyé par saint Vincent lui-même à Madagascar. Nous conservons encore un exemplaire remontant au xviie siècle», précise Mgr Ramaroson. Mais l’élan des premiers missionnaires et leur désir d’enraciner la foi à Madagascar se sont heurtés aux nombreuses maladies, en particulier la malaria, qui ont coûté la vie à nombre d’entre eux. «Au moment de la mort de saint Vincent, parce que il y avait déjà des problèmes de son vivant, les membres de la Congrégation de la Mission s’opposèrent à l’envoi d’autres prêtres à Madagascar, en conséquence de quoi la mission fut fermée après son décès», explique le prélat. Les siècles suivants furent marqués par l’arrivée des jésuites sur l’île, suivis par les pères spiritains, chaque congrégation étant chargée d’une région spécifique. Les pères lazaristes furent de retour au sud de Madagascar à partir de la fin du xixe siècle, accompagnés par les sœurs Filles de la charité. «Cette répartition géographique entre les différentes congrégations n’est plus d’actualité aujourd’hui, puisque je suis moi-même en poste au nord du pays».
Si saint Vincent rêvait de voir ordonnés des prêtres malgaches dès les débuts de l’aventure lazariste — certains jeunes furent même envoyés à Paris pour étudier — il faudra attendre l’indépendance en 1960 pour que des vocations naissent au sein de la population malgache elle-même et que des jeunes soient amenés à entrer dans la Congrégation de la Mission, comme c’est le cas pour Mgr Ramaroson. «Aujourd’hui nous travaillons surtout au niveau social: nous sommes présents dans les centres d’accueil pour les personnes pauvres et essentiellement dans les secteurs les plus difficiles d’accès, dans la brousse, et moins dans les grandes villes. Il s’agit de ce que nous appelons la pré-évangélisation: on ne peut pas avoir une vraie évangélisation et un vrai développement sans une bonne instruction, c’est pour cela que nous mettons le paquet sur l’éducation des enfants. Nous faisons appel pour cela aux Filles de la Charité car à Madagascar les femmes tiennent une place importante dans l’éducation».
Aujourd’hui, l’un des principaux défis que doit affronter la Congrégation de la Mission est celui de l’inculturation. «Il existe ici une valeur fondamentale très importante dans la culture malgache, inscrite dans notre Constitution», explique l’archevêque d’Antsiranana: «Le fihavanana, qui comme l’a rappelé le Pape lors de son voyage apostolique évoque l’esprit de partage, d’entraide et de solidarité et comprend également l’importance des liens familiaux, de l’amitié, et de la bienveillance entre les hommes et envers la nature». «L’Eglise doit chercher à la développer mais il faut que cette valeur soit purifiée par la foi pour qu’elle devienne un moyen d’évangélisation», affirme le prélat, qui ne manque pas de rappeler les similitudes entre le fihavanana et l’Encyclique Fratelli tutti: «Nous sommes tous frères et sœurs, nous formons une seule famille et c’est ainsi que nous pouvons rebâtir la maison commune qui est dégradée. C’est pour cela que cette valeur très chère aux malgaches peut devenir un socle de l’évangélisation».
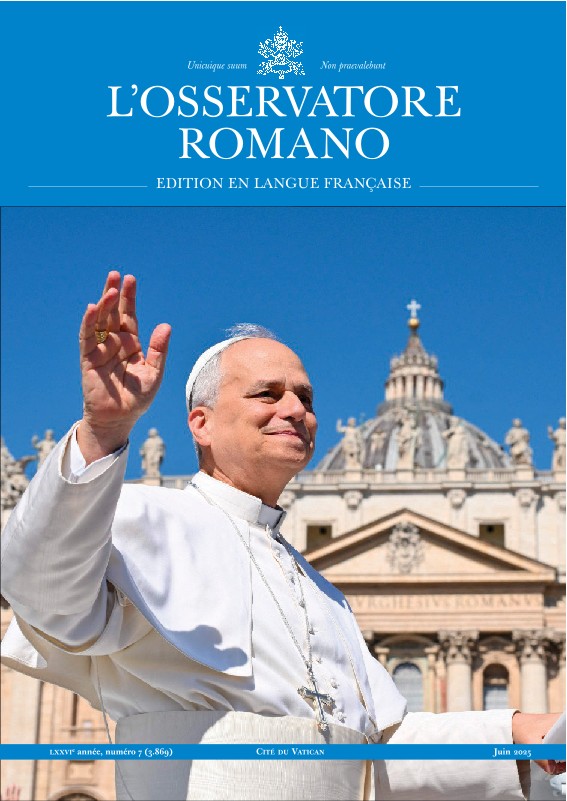



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti