
Denis Dupont-Fauville
Présenté en 2023 par Shin’ya Tsukamoto à la Biennale de Venise, sorti il y a près d’un an en France et aujourd’hui en Italie, L’ombre du feu est un film qui va à l’essentiel, dans un dépouillement revendiqué. D’emblée, à coups de plans fixes et de cadrages serrés se succédant avec une violence quasi mécanique, nous nous retrouvons chez une femme japonaise vivant seule, dans une maison misérable, séparée par une mince cloison d’un monde que l’on pressent ruiné et où la violence rôde. Pas une explication n’est donnée. Nous avons à comprendre, au gré des scènes d’intérieur et des rencontres entre des personnages se sachant menacés, ce qui se passe: en eux mais aussi en nous.
Trois hommes vont franchir le seuil. Un ancien d’abord, apparemment entré apporter un peu d’alcool pour le bar disposé dans la première pièce, en fait un client en quête d’une passe furtive et âpre. Puis un enfant chapardeur qui vient, fuit et revient, ses yeux prenant possession du cœur de la prostituée et du nôtre. Enfin un jeune soldat, tentant de se donner une contenance et promettant à la fois de payer et d’honorer son hôte, ne parvenant en fait qu’à une brutalité impuissante à conjurer ses cauchemars. Trois âges, trois états de vie et d’âme. Trois rencontres, jusqu’à ce que l’extérieur s’invite et emmène le petit garçon au-dehors, dans un -voyage qui lui dira l’horreur du passé, l’impuissance des adultes et la nécessité de grandir. Au terme, échoué dans un marché misérable, l’enfant devra se prendre en main et se perdre dans la foule.
Au long de ces actes contrastés, la mise en scène conserve une qualité d’épure qui évite tant la démonstration rassurante que le discours moralisateur. A l’économie de moyens, parfois frustrante, correspond un déploiement de sens qui déchaîne chez le spectateur une gamme d’émotions intenses, de l’angoisse à la rage en passant par la tristesse et l’espérance. Si bien que cette époque sans repères, qui logiquement correspond au lendemain de l’holocauste nucléaire américain sur le Japon, se révèle aussi la nôtre. Tout semble mort. La femme se découvre condamnée, chaque homme apparaît traumatisé. Seul l’enfant n’a pas de destin fixé, mais d’où vient-il et que pourra-t-il devenir, si personne n’assume sa charge?
Qu’il nous soit permis d’esquisser ici un parallèle avec Anora (Palme d’Or et Oscar). Le début est semblable: une femme vend son corps pour subsister. La fin est proche: pas d’avenir pour ceux qui voudraient se battre. Mais l’approche est inverse: là où l’Amérique nous convie au divertissement pour conclure en un désespoir replié sur soi, le Japon ne nous épargne aucune rudesse pour maintenir, presque indistincte, la flamme de l’espérance. Loin des lumières artificielles, cette calligraphie cinématographique, outre les éléments d’avenir qu’elle énonce sobrement dans les cendres (instruction, justice, compassion, effort…), est seule à montrer un enfant et à faire entendre le nom de Dieu. Peut-être n’est-il pas trop tard.
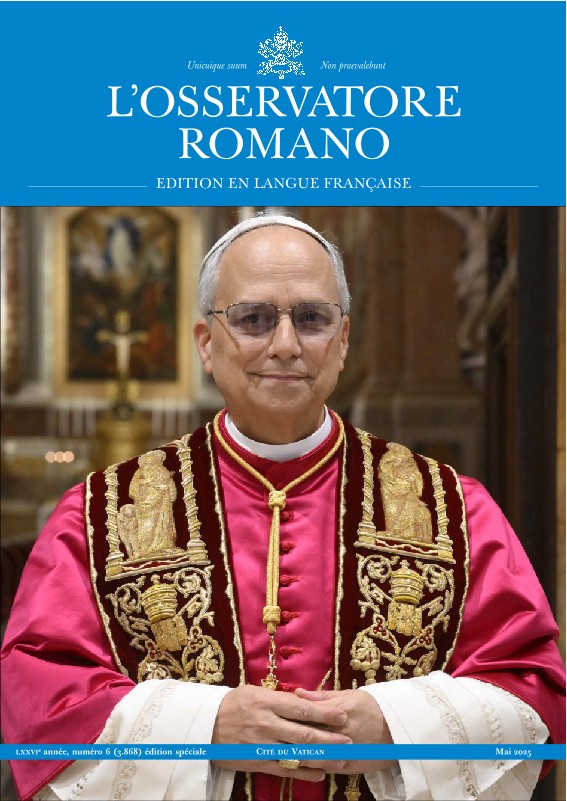



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti