
Charles de Pechpeyrou
C’est un livre important et nécessaire que publie l’historien Philippe Chenaux, professeur émérite d’histoire de l’Eglise moderne et contemporaine à l’Université pontificale du Latran à Rome: une biographie intellectuelle et politique du cardinal Charles Journet, à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa mort. Son projet est de montrer l’engagement du théologien dans la société de son temps, lui qui écrivait à ce sujet dans L’espérance temporelle de l’humanité (1975): «Nous touchons ici au domaine où le chrétien est invité à s’engager temporellement dans le mouvement de la culture. Il le fait alors non pas précisément en tant que chrétien, à savoir en tant que membre du royaume qui n’est pas de ce monde, mais en tant que citoyen d’une patrie, ou membre d’une culture, bref au nom des valeurs des royaumes de ce monde, et cependant il le fera en chrétien, c’est-à-dire avec toutes les énergies de lumière et d’amour dont il dispose».
Théologien thomiste résistant, Charles Journet (1891-1975) a joué un rôle important dans la réflexion sur la lutte contre le totalitarisme, une réflexion qu’il initie dans l’entre-deux guerres et qui doit beaucoup à sa rencontre avec le philosophe Jacques Maritain, qui au lendemain de la condamnation de l’Action française par le Pape Pie xi, écrit Chenaux, «aida le théologien à concevoir progressivement une manière nouvelle d’envisager les rapports du spirituel et du temporel, ouverte aux valeurs de la modernité politique (liberté, pluralisme, démocratie)». En avance sur les penseurs de son temps, Journet a l’intuition que les totalitarismes sont des «mythes collectifs», des «idées-force» portées par des masses «travaillées, suggestionnées, hallucinées par la propagande». Journet, poursuit Chenaux, distingue trois mythes: «le mythe hégélien de l’Etat ou de la nation», «le mythe de la race», «le mythe des classes».
Grande voix de la résistance spirituelle, écrit encore Chenaux, le cardinal Journet peut être consi-déré comme un théologien «gaulliste», «dans la mesure où, comme le chef de la France libre, il croyait à la vocation des Nations, à leur mission particulière dans l’histoire des hommes. Le génie propre de chacune d’elles s’incarnait, à ses yeux, dans la figure d’un saint, Jeanne d’Arc pour la France, Nicolas de Flüe pour la Suisse, Catherine de Sienne pour l’Italie, Stanislas pour la Pologne». Grâce également à l’amitié de Maritain et de sa femme Raïssa, russe d’origine juive, et devant la montée de l’antisémitisme d’Etat en Europe dans les années 30, le cardinal Journet rompt avec une forme d’antijudaïsme chrétien largement répandue encore à l’époque — tout en restant hostile au sionisme politique — jusqu’à avoir une influence dans l’adoption de deux textes majeurs du Concile Vatican ii: la Déclaration Nostra aetate (28 octobre 1965) sur les religions non chrétiennes et la Déclaration Dignitatis humanae (7 décembre 1965) sur la liberté religieuse. Le livre de Chenaux permet de comprendre pleinement le poids des mots de Paul vi, lorsqu’il disait de Charles Journet qu’il était «l’un des grands théologiens de notre temps».
Charles Journet, Un théologien engagé dans les combats de son temps, Philippe Chenaux, Editions Desclée de Brouwer, 336 pages, 23 euros
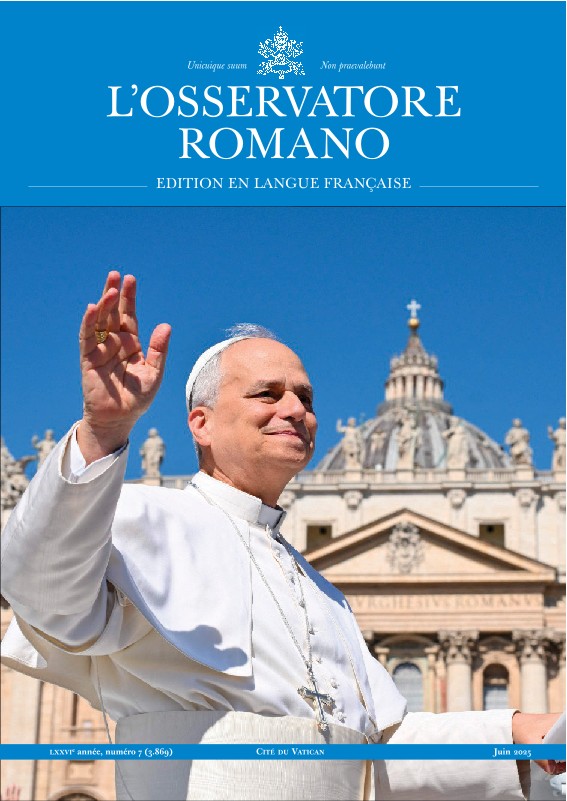



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti