
Parfois, ce sont précisément les problèmes qui suscitent la curiosité, poussent à poser des questions et font découvrir quelque chose de nouveau. Si l'on a une certaine familiarité avec les écrits du Nouveau Testament, même sans être un(e) initié(e), on peut percevoir quelque chose qui laisse perplexe et qui soulève des questions. Par exemple : y a-t-il un lien entre la résurrection du Christ, les femmes et la folie ?
Une comparaison éclairante La comparaison des récits des apparitions Pascales dans les quatre évangiles avec un texte particulièrement connu d'une lettre de Paul est éclairante. Les trois évangiles synoptiques s'accordent sur le fait que les disciples qui ont suivi Jésus de la Galilée à Jérusalem, c'est-à-dire tout au long de sa mission, sont non seulement les témoins oculaires de la mort et de la sépulture, mais aussi les premiers témoins de l'apparition pascale de l'Ange qui leur transmet l'annonce de la résurrection et les charge de la diffuser parmi les disciples. Pour sa part, Jean utilise des traditions différentes, mais le fond est le même : les protagonistes des récits des apparitions ne sont pas les disciples galiléens, mais c'est celle qui en est en quelque sorte la responsable, Marie de Magdala, à qui est réservée l'unique apparition individuelle du Ressuscité et la remise explicite du mandat apostolique aux autres disciples.
En revanche, Paul, dans sa première épître aux chrétiens de Corinthe, accompagne sa déclaration de foi sur la mort et la résurrection du Christ d'une liste de diverses apparitions du Ressuscité, complétée par une liste de noms dont la fonction est d'étayer les faits sur la base du témoignage des protagonistes eux-mêmes, à savoir qu'ils représentent la garantie de ce que la formule déclare : Céphas, les Douze, cinq cents frères, puis Jacques et tous les apôtres ont fait l'expérience des apparitions du Ressuscité, comme, plus tard, l’a fait Paul lui-même. Tous sont rigoureusement des hommes. Paul dit avoir reçu cette formule, ce qui signifie que lorsqu'il a écrit sa lettre dans les années 50, celle-ci devait déjà représenter une pierre angulaire de la catéchèse chrétienne primitive. Ainsi, ce qui est transmis dans les communautés judéo-chrétiennes de l'époque, c'est que l'annonce de la foi pascale et le témoignage de la résurrection ne sont garantis que par des hommes. Comment se fait-il que, comme nous l'avons dit, pour les quatre évangélistes, seuls les disciples galiléens fassent la première expérience de la Résurrection lorsque, au matin de Pâques, ils trouvent le tombeau vide ?
Il n'est pas facile d'interpréter un tel strabisme de la tradition. Surtout à une époque comme la nôtre où nous sommes pris en otage par la prise de conscience de la tension entre le Fait et le Faux (Fact and Fake) et où il est encore plus difficile de reconstituer des événements qui se sont déroulés il y a très longtemps et dont le récit n'est parvenu jusqu'à nous qu'à travers une chaîne d'interprétations. Il existe cependant une indication qui mérite d'être prise au sérieux.
Le fil rouge de la « folie » Il est intéressant de noter qu'une deuxième conclusion est ajoutée au plus ancien des Evangiles, celui de Marc, dans lequel il est fait explicitement référence aux apparitions à Marie-Madeleine et aux deux disciples sur la route d'Emmaüs, mais celle-ci insiste aussi sur le fait qu'aucun des autres disciples n'avait cru à leur témoignage et que cela devient même un motif de réprimande de la part du Ressuscité lui-même, lors de sa dernière apparition décisive à toute la communauté réunie liturgiquement autour des Onze, « parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité » (Marc 16, 9-20). Peut-être peut-on peut comprendre la nécessité apologétique de garantir que la tradition des apparitions n’était pas fondée sur des expériences individuelles qui pouvaient être considérées comme difficilement vérifiables, mais qu'elle était plutôt enracinée dans la réalité de tout un mouvement religieux qui était déjà structuré d'une certaine manière et qui faisait référence à l'autorité morale des disciples historiques de Jésus. Il est toutefois frappant de constater que la force du témoignage prophétique des disciples, si d'un côté s'avère être un élément génétiquement indispensable à la naissance de l'annonce pascale, doit d'un autre côté être tempérée par la conscience de sa crédibilité douteuse : on doit aux femmes la genèse de la foi en la résurrection, mais nous perdons en crédibilité si nous accordons trop d'importance à leur témoignage. Pourquoi ?
De ce point de vue, l'évangéliste Luc est celui qui permet de clarifier au moins un peu les termes de la question. Pour lui, lorsque Marie-Madeleine, Jeanne et Marie mère de Jacques, ainsi que les autres qui étaient avec elles, ont raconté aux apôtres leur expérience des apparitions, « ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas » (24, 11). Selon le troisième évangéliste, on ne prête même pas foi au témoignage des deux disciples d'Emmaüs, mais qui constitue, de fait, une expérience communicable et crédible ( 24, 35), de même que celui de Simon doit être considéré comme un événement faisant autorité (24, 34), alors que seul celui des femmes représente une divagation : les femmes annoncent un kérygme incroyable (24, 9-11) et transmettent une expérience extatique incommunicable (24, 22). Le lien entre vision prophétique et hallucination, entre expérience extatique et folie commence à se dessiner.
Il y a ensuite un épisode raconté dans le livre des Actes des Apôtres qui met à nouveau en relation la résurrection, les femmes et la folie. Lorsque Pierre, après avoir été libéré de prison par un ange, frappe à la porte de la maison de Marie « où beaucoup étaient réunis et priaient », la jeune servante du nom de Rode qui lui ouvre, et qui court annoncer qu'il est à la porte, est jugée folle. Il s'agit peut-être d'un stratagème littéraire pour accroître la tension narrative, mais une fois de plus, c'est un délire féminin qui suscite l'incrédulité. Même Paul, lorsqu'il parle de résurrection devant des philosophes épicuriens ou stoïciens et à l'Aréopage d'Athènes, est traité de charlatan ou moqué (Actes 17, 16-34), mais sa vision du Ressuscité sur le chemin de Damas n'a jamais été taxée de folie.
Les commentateurs s'accordent à reconnaître que la tradition des apparitions pascales à des femmes et, avec elle, l'accusation de fonder la nouvelle foi sur une hallucination, devaient être très profondément enracinées et répandues au début de l'ère chrétienne. Dès la première moitié du IIIème siècle, le docteur de l'Eglise Origène réagit de façon polémique contre un philosophe nommé Celse, qui accusait les chrétiens de fonder leur foi sur le témoignage d'une « femme folle », en affirmant toutefois ne pas connaître Marie-Madeleine et en citant comme autres exemples Pierre et Paul. Misogynie des deux côtés ? Cela est possible. Il s’agit toutefois d’une explication encore insuffisante.
Il est tout à fait raisonnable qu'une nouvelle religion qui voulait se faire une place au sein d'un monde culturellement et religieusement complexe comme celui de l'empire ait dû assumer le principe patriarcal de l'autorité et donc fonder sa légitimité sur l'exclusion des femmes non seulement des rôles et des fonctions, mais même de la construction de la mémoire collective. Cette logique a présidé à la construction de la « grande Eglise » et à son institutionnalisation progressive. Mais la question sérieuse est autre. En effet, la foi en la résurrection du Christ ne pouvait naître qu'en dehors de cette logique, elle ne pouvait être induite que sur la base de phénomènes mystiques, visionnaires et d’élans prophétiques. Seule une foi visionnaire, qui dépasse les limites de la raison stricte et qui est capable d'impliquer tous les sens dans l'expérience d'une dimension du sacré qui n'est accessible qu'en termes mystiques, pouvait enfreindre toutes les règles. Et peut-être pour cela, seules les femmes, depuis toujours sentinelles aux portes d'entrée dans la vie et de la sortie de la vie, sentinelles du secret de la naissance et de la mort, ont pu être les premières à percevoir comme possible une autre façon de rencontrer le Maître, de garder vivante sa mémoire, de ne pas chercher parmi les morts celui qui est vivant.
C'est pourquoi les Evangiles, malgré l'hostilité diffuse à l'égard des témoignages des femmes dans toutes les sphères publiques, ne peuvent s'empêcher de reconnaître que seul leur protagonisme a rendu possible le passage du discipolat à l'égard d'un rabbin et d'un messie à un autre discipolat, celui à l'égard de celui qui « n'est pas ici, il est ressuscité » (Lc 24, 6). Leur foi visionnaire frise-t-elle ce qui, selon la logique du monde, est qualifié de « folie » ? C'est tout à fait possible, et ce n'est pas un hasard s'il est rapidement devenu nécessaire d'activer des processus garantissant à la nouvelle foi la légitimité de figures masculines faisant autorité. Mais pour Marc, Matthieu, Luc et Jean, c'est précisément de leur « folie » qu'est né l’Evangile de la résurrection.
Marinella Perroni
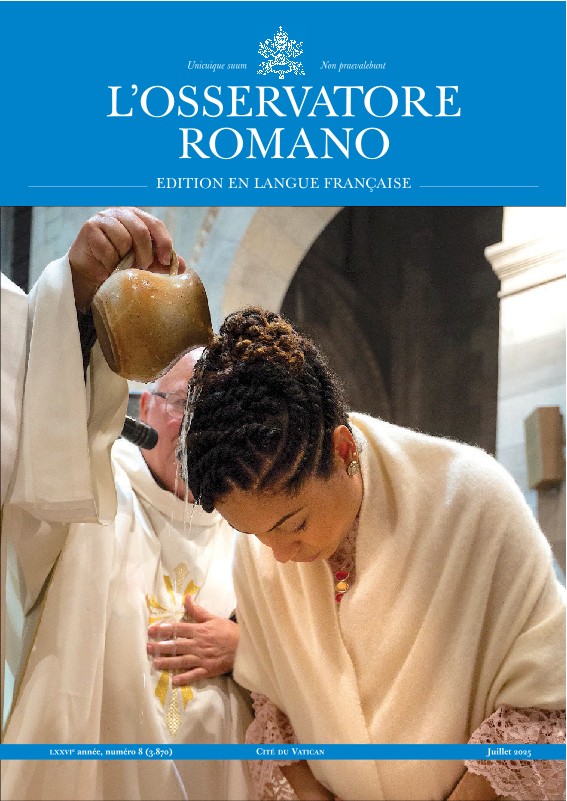



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti