
La pratique synodale récente nous a plutôt habitués à des processus qui avancent à un rythme très lent : espérances et impatiences vont de pair, même si ces dernières sont d’origine opposée, certaines proviennent de ceux qui sont scandalisés par l’innovation, les autres de ceux qui trouvent le rythme insupportablement lent. C’est le cas, par exemple, de la situation dans la communauté catholique des couples qui vivent un second mariage après la fin du premier : y a-t-il un mot plus simple pour le dire ? Oui, divorcés remariés, mais cela me semble moins respectueux.
En effet, il ne fait aucun doute que les « seconds » mariages sont nombreux. Dans un certain sens, on pourrait aussi compter ceux qui interviennent après une première union qui n’est que civile, ou même après la rupture d’une longue cohabitation. Et peut-être même après une déclaration de nullité par le tribunal ecclésiastique, qui décrète que, les conditions de base n’étant pas réunies, le mariage au sens propre n’a pas existé : mais la vie commune, oui. La condition de blessure et ensuite de renaissance dans la seconde relation est en effet commune, parce que le sacrement vit dans les heures, dans les jours, dans les relations d’affection et les peines de tous et de chacun. Parmi les couples recomposés, il y en a plusieurs qui souffrent d’être exclus – de fait – des paroisses ou considérés comme des personnes de série B, par exemple sans sacrements. D’autres couples ne vont pas à l’église et ne semblent pas trop intéressés, mais finalement le sentiment d’exclusion pèse sur tous, il pique la peau même quand il ne semble pas toucher directement. La question se pose donc : est-il possible que des assassins et des criminels, des gens qui fomentent la guerre et appartiennent au monde de la finance, puissent se réconcilier à certaines conditions requises, mais souvent non remplies, mais qu’il faille maintenir une sorte d’excommunication, sans pouvoir participer à la table eucharistique, pour des personnes qui après un échec, peut-être même un abandon subi, veulent tout simplement aimer à nouveau ?
Deux fantômes pourraient alors apparaître, mais nous les écartons immédiatement : on a toujours fait ainsi / nous prenons au sérieux les paroles de l’Écriture. En ce qui concerne l’Écriture – nous sommes moins scrupuleux sur d’autres choses, il faut l’admettre, par exemple sur les biens et la violence – on doit observer que les passages sur le divorce sont insérés dans des textes qui s’opposent à un rejet facile des femmes (Marc 10, 1-12). Par ailleurs, dans la version de Matthieu (19, 9) il y a aussi les soi-disant « exceptions » – sauf le cas d’incorrection, qui est traduit comme « union illégitime », ce qui déplace assez l’optique du texte – qui dans les églises orientales soutiennent la pratique de réadmission des divorcés. En effet, si nous regardons l’histoire, nous devons dire qu’elle est beaucoup plus variée qu’on ne le dit souvent : jusqu’au troisième siècle il n’y avait pas de signe reconnaissable – un sacrement dirions-nous aujourd’hui – pour réconcilier le péché grave des baptisés. Quand on introduit le sacrement de la pénitence, non sans grand débat, en se laissant blesser par la blessure des personnes qui demandaient de pouvoir revenir dans la communauté, les problèmes publics pour lesquels était prévu un parcours de réconciliation étaient : 1) avoir sacrifié aux dieux païens (apostasie), 2) le meurtre étendu jusqu’aux massacres et 3) les secondes noces, qui dans certains documents sont appelées adultère, en citant le texte évangélique. Les églises orientales et orthodoxes – jusqu’en 1054, nous sommes encore une unique église – ont continué à faire ainsi : un second mariage, aussi bien de veufs que de divorcés, a également un ton de demande de pardon, comme pour dire qu’on ne l’aborde pas avec légèreté. Mais c’est un vrai mariage. L’« incorrection » dont parle l’Évangile est par exemple interprétée comme le dommage infligé au « conjoint innocent », étendu par miséricorde aux autres.
Et dans l’Église catholique ? Au Synode 2015/16 sur la famille, on a discuté de cette pratique ancienne et œcuménique, toujours en usage parmi les orthodoxes. Elle a également été mise en relation avec d’autres réflexions, comme celles liées à la primauté de la conscience, au discernement, à la complexité des situations : le débat se retrouve dans le chapitre VIII d’Amoris Laetitia, l’Exhortation apostolique post-synodale du Pape François, qui devrait être mieux connue et méditée. Il y est dit : « Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une miséricorde ‘‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’’. Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! Je ne me réfère pas seulement aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque situation qu’ils se trouvent ».
Le document fait aussi comprendre délicatement que l’option – proposée dans le passé – de vivre comme frère et sœur n’est pas praticable. Il ajoute que les divorcés remariés « ne sont pas excommuniés » (dans un sens radical), ils doivent au contraire être davantage intégrés tant qu’il n’y a pas de « scandale ». Mais le scandale de qui ? Beaucoup de bonnes personnes se scandalisent en effet de l’exclusion, la leur/ou celle des amis remariés. Mais ici on ne parle pas d’eux, mais de ceux qui sont contre leur réconciliation. Qu’est-ce que cela signifie donc ? Qu’ils doivent aller dans une paroisse loin de là où ils habitent ? Nous savons que malheureusement cela est aussi proposé. Et voici que, en disant que ce n’est pas le moment d’avoir une réglementation commune qui régisse la situation, on renvoie au discernement personnel et pastoral, en ajoutant, mais dans une petite note de bas de page (note 336), que cela vaut aussi pour les sacrements.
Le discernement et la conscience sont une bonne chose : il est cependant temps que la question sorte des « notes » et vienne à la lumière du soleil. Un parcours public reconnu et reconnaissable n’élimine pas la complexité, mais permet qu’elle soit vécue dans la justice, à la lumière du jour. Pas en bas de page, mais au centre.
Cristina Simonelli
Théologienne, professeure d’histoire de l’église antique, Faculté de théologie de l’Italie du Nord, Milan
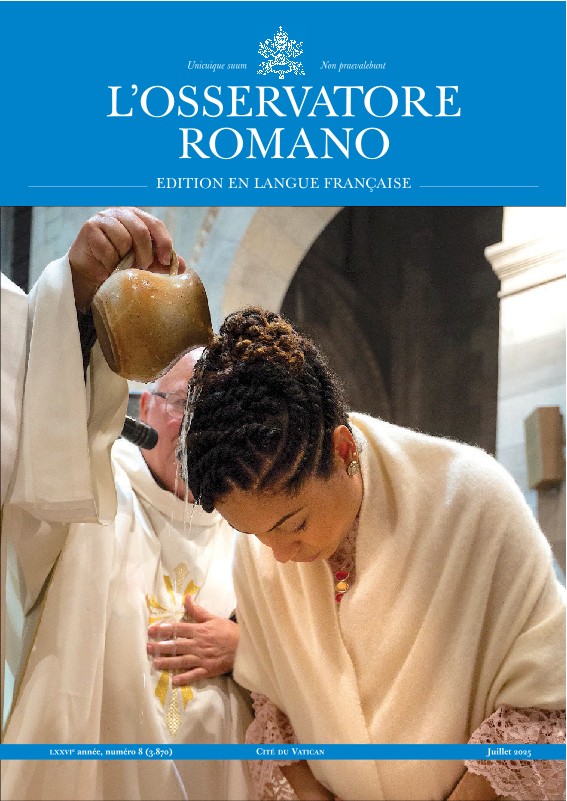



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti