
Les camails et les pèlerines rouges, noires, et blanches. Puis la chapelle Sixtine, « extra omnes », les rites et les mythes : combien un Conclave peut être scénographique. Et le film homonyme d’Edward Berger, tiré du roman de Robert Harris, l’est tout autant. Métaphore du pouvoir temporel, de la chasse aux secrets, de l’échange des voix, du troc politique. Peut-être qu’à Los Angeles, le film remportera beaucoup d’Oscars, peut-être pas, mais il y a un rôle et une interprétation féminine qui resteront. Et c’est pour cela qu’il est apprécié.
Le Pape vient de mourir, le doyen du collège cardinalice, interprété par Ralph Fiennes, doit organiser l’élection du nouveau Souverain Pontife, et surveiller. Tout et tous. Ses collègues cardinaux, tout d’abord, le libéral américain interprété par Stanley Tucci, le traditionaliste canadien de John Lithgow, le possible premier pape noir de Lucian Msamati, et l’impétueux, caricatural et grand conservateur interprété par Sergio Castellitto : « Ici, autrefois, nous aurions parlé latin, et nous nous serions compris. L’Eglise ne tient pas, nous devons revenir en arrière ». Mais il y a un outsider, un cardinal in pectore dont la nomination n’était connue que du Saint-Père, qui veut aller de l’avant, et à qui reviendra le rebondissement final.
Evidemment, tous des hommes. Et pourtant non. Une petite armée de religieuses arrive pour préparer les repas et assurer la propreté des pièces pendant la « ségrégation ». L’habituel rôle de service de la femme. Et pourtant, encore une fois, non. La générale de la petite armée, sœur Agnès, qui est interprétée par Isabella Rossellini, sera la clé de voûte du récit.
Il est beau qu’elle résiste avec une dignité obstinée au cardinal Fiennes qui enquête. Qu’elle défende avec acharnement une sœur catapultée malgré elle au centre d’une intrigue. Qu’elle prononce cette phrase mémorable : « Vous pensez que nous sommes aveugles, sourdes et muettes. Mais nous entendons, nous voyons et nous parlons », et qu’elle dise, tout simplement, la vérité. Bref, c’est à la femme, à la religieuse, à son courage, à l’interprétation intense d’Isabella Rossellini que revient le sens de l’histoire. C’est elle qui permettra à ces cardinaux d’aller de l’avant.
Comme toujours, l’actrice était préparée, mais elle s’est aussi inspirée de sa propre vie, ayant été scolarisée dans un institut catholique à Rome : « J’ai été formée chez les religieuses jusqu’à l’âge de 16 ans – a-t-elle dit – Elles étaient bonnes et gentilles mais avaient une immense autorité. J’ai essayé de me souvenir d’elles en interprétant mon personnage. Sœur Agnès est silencieuse et en même temps stoïque et autoritaire ».
Un rôle de sept minutes et 51 secondes : très petit, mais si grand.
Alessandra Comazzi
Journaliste, critique de télévision
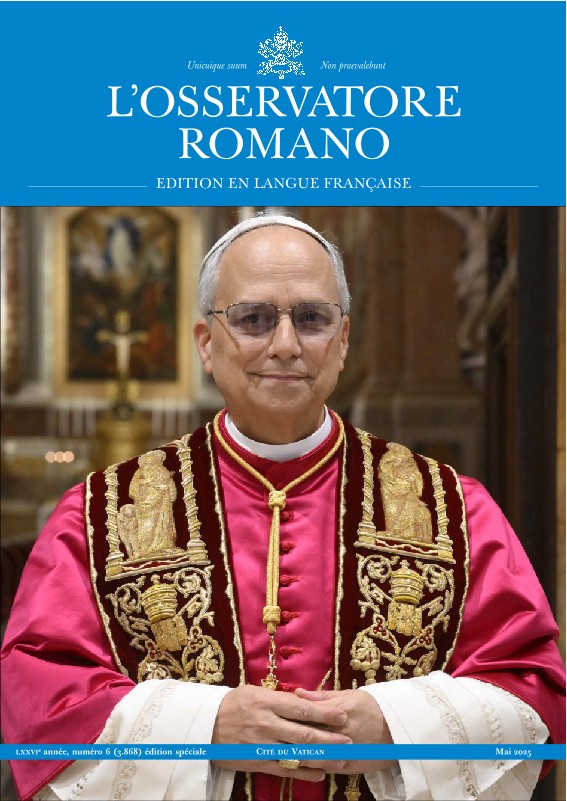



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti