Le Pape, les cardinaux,

« Nous n’avons pas suffisamment écouté la voix des femmes dans l’Église ». C’est de cette (son) observation qu’est né le choix sans précédent du Pape François de demander aux cardinaux de son Conseil, le « C9 », de réfléchir à la question des femmes. Pas seuls, cependant. Mais avec des femmes, appelées à une confrontation libre, franche et authentique avec les plus hautes autorités ecclésiastiques. Avec la conviction que « l’Église a encore beaucoup à apprendre d’elles ». Pendant les mois qui séparent les deux sessions du Synode sur la synodalité, le Souverain Pontife a donc confié à la religieuse salésienne et théologienne Linda Pocher la direction d’un cycle de rencontres de formation sur le thème.
« Nous nous sommes rencontrés en 2022 lorsqu’il m’avait demandé un approfondissement de la pensée de Hans Urs von Balthassar, que j’avais longuement étudiée. Un an plus tard, en juin 2023, il m’a recontactée – raconte Sœur Pocher –. Il m’a laissé une totale liberté dans l’articulation de l’ensemble de la proposition, à commencer par le choix des thèmes et des invités. Le Pape ne m’a donné que trois adjectifs directeurs sur l’approche à développer : fonctionnelle, administrative et ministérielle ». La théologienne les a déclinés dans un cycle en quatre temps, répartis entre décembre 2023 et juin 2024, – dont les comptes rendus sont contenus dans autant de livres publiés par les Paoline – qui, dans une perspective interdisciplinaire, mettent en lumière les différentes facettes du thème et associent les problèmes les plus urgents avec quelques nœuds de base à dénouer. Dans une perspective à long terme, ces derniers – explique-t-elle – pourraient s’avérer être des fruits de nouveauté beaucoup plus fructueux que les premiers ».
Linda Pocher a donc fait appel à huit personnes – sept femmes et un homme – aux compétences, aux biographies et aux sensibilités différentes, offrant une pluralité de perspectives : Regina da Costa Pedro, brésilienne et afro-descendante, de la Congrégation missionnaire de l’Immaculée-Pime, Luca Castiglioni, prêtre et théologien, Giuliva Di Berardino, femme consacrée de l’Ordo virginum et enseignante, Donata Horak, canoniste, Stella Morra, théologienne, Valentina Rotondi, économiste, Lucia Vantini, Présidente de la Coordination des théologiennes italiennes, et Jo Wells, femme évêque anglicane. Le parcours a commencé par une confrontation critique avec le principe marial-pétrinien de von Balthasar, qui a inspiré les pontificats les plus récents, pour affronter sans aucune hésitation le débat sur les ministères, l’influence du facteur culturel et, enfin, ce que Michel Foucault a appelé l’interdit : le thème du pouvoir.
« Je l’avoue, j’étais inquiète lorsque j’ai reçu l’invitation. Sœur Linda m’a répété qu’il s’agirait d’une réunion simple et informelle. Et en effet, contrairement à ce que je pensais, ce fut le cas. À commencer par le lieu : une salle de la Maison Sainte-Marthe – raconte Sœur Regina, la seule non-européenne du groupe, appelée à parler de la culture avec Stella Morra –. J’ai été accueillie avec une extrême cordialité. Contre toute attente, je me suis sentie incroyablement à l’aise. On nous a fait asseoir en face du Pape, de son secrétaire et du Cardinal Pietro Parolin. Les autres cardinaux étaient sur les côtés. On nous a accordé un long temps de parole – environ quarante minutes chacun – et nous avons été écoutés très attentivement : ils étaient vraiment intéressés. Cela a été confirmé par le fait qu’ils nous ont posé de nombreuses questions. François, par exemple, nous a demandé ce que nous pensions être les racines du cléricalisme et les causes de la résistance à une présence plus incisive des femmes. Le Secrétaire d’État nous a demandé si un désir de pouvoir ne se cachait pas derrière cette demande de reconnaissance. Je l’ai trouvé très sincère : il a donné voix à un doute qui serpente chez beaucoup d’hommes d’Église ». « Juste une anecdote pour décrire l’atmosphère – lui fait écho Donata Horak qui, avec Valentina Rotondi, s’est concentrée sur le pouvoir –. À la fin de la réunion, je suis restée dans le couloir pour attendre une collègue ; le Pape, qui était déjà dans l’ascenseur, est sorti et est revenu vers moi parce qu’“il n’est pas bon de se retirer avant que les invités ne soient partis” ». La canoniste a choisi de ne pas faire un véritable discours. « Bien sûr, j’avais écrit mes pensées. Mais j’ai préféré parler en improvisant, pour que ce soit un espace authentique d’écoute et de débat. Les Cardinaux sont différents entre eux, ils ont des positions et des visions différentes, ils appartiennent à des milieux culturels très divers. Nous avons parlé franchement des questions de la réforme du droit canonique et de certaines dynamiques ecclésiales ».
« Je n’oublierai jamais l’émotion que j’ai ressentie en entrant dans cette salle – souligne Valentina Rotondi – j’avais accepté et préparé la rencontre sans me rendre compte de la nature exceptionnelle du moment que j’allais vivre. A ce moment-là, j’ai réalisé. Pour me détendre, le Pape François a plaisanté sur le fait que je lui avais amené un petit-enfant pour le distraire. Il faisait référence à mon bébé de deux mois qui, entre-temps, se trouvait dans une autre pièce, gardé par mon beau-frère. Il m’a tutoyée, comme tout le monde, non pas par manque de respect, mais pour créer une fraternité et une sororité. Je me suis tout de suite détendue ». « Lorsque j’ai reçu l’invitation, j’ai cru à une plaisanterie – ajoute l’évêque femme Jo Wells, convoquée avec Giuliva Di Berardino pour parler des ministères – mais lorsque je me suis retrouvé à Sainte-Marthe, j’ai été frappé par la normalité avec laquelle tout s’est déroulé. Dès que nous avons franchi le seuil, rejoignant une réunion qui avait déjà commencé, le Pape François s’est levé pour nous souhaiter la bienvenue. Après les présentations, il a cédé la présidence à Sœur Linda, signe d’une confiance et d’une liberté extraordinaires. Le modèle jésuite de discernement était très évident, notamment lorsqu’elle a elle-même commencé par un bref moment de prière pour que l’Esprit Saint guide notre écoute et notre apprentissage. J’ai remarqué l’ironie de la situation : une femme dirigeait déjà le culte et les prières ». Ce matin-là, Giuliva Di Berardino n’a pas hésité à plaider devant le Souverain Pontife et le Conseil pour que le diaconat soit ouvert aux femmes. Je ne peux pas nier que j’ai ressenti une grande responsabilité en présentant ma proposition, sachant que plusieurs femmes avaient (et ont) des attentes importantes à cet égard – a-t-elle dit –. Personnellement, dit-elle, je n’en avais aucune, mais le sujet me tenait à cœur, surtout après avoir étudié la situation des femmes telle qu’elle ressortait du Synode de l’Amazonie. La discussion qui a suivi a été animée et constructive ».
Lucia Vantini a en revanche soutenu que le principe marial et pétrinien de von Balthasar, sur lequel elle s’est exprimée avec Luca Castiglioni, n’était pas un bon point de départ pour la coresponsabilité ecclésiale entre les sexes. « La réaction a été plurielle : quelques résistances, quelques étonnements, quelques bonnes complicités » – raconte-t-elle –. Je n’ai pas eu cette angoisse de la performance que l’on ressent parfois quand le travail est uniquement et entièrement personnel. Je suis arrivée là après un parcours d’étude, de formation et de collaboration avec d’autres femmes. Au sein de la Coordination des théologiennes italiennes, j’ai en particulier appris à reconnaître et à réfréner le sentiment de se sentir choisie, la tentation de parler en son propre nom, le désir d’être la “favorite du roi” ».
« Sommes-nous sûrs que la question des femmes n’est pas la “question des hommes”? – demande Luca Castiglioni, l’exception masculine du cycle de formation – La bonne nouvelle est que cette question n’est plus comprise comme une question sectorielle, mais reconnue comme une urgence pour toute l’Église, dont la crédibilité dépend aujourd’hui en grande partie de la qualité des relations entre les ministres ordonnés et les autres baptisés, en particulier les femmes. Une partie du problème a longtemps été son occultation : on n’arrivait pas à entendre le cri des femmes et l’on croyait que l’exaltation du “génie féminin” était la solution. Ces convocations du Pape – et les publications qui ont suivi, avec des préfaces signées par lui – marquent au contraire une prise de conscience et une orientation : il nous demande de réfléchir à la manière de “démasculiniser” l’Église, il favorise le dialogue, également un dialogue critique avec les argumentations traditionnelles, et il écoute diverses femmes. Mais celles-ci, même quand elles étaient trois, étaient cependant en minorité devant lui et les neuf cardinaux ! Ceux-ci ont réagi avec courtoisie, humanité et mesure, mais avec une parole qui avait toujours plus de poids que celle de leurs invitées. En tout cas, ils ont entendu des réflexions inhabituelles dans les “sacri palazzi”. Si l’opération, dans son ensemble, contribue à la construction du consensus sur le thème, ce sera déjà un fruit. Peut-être le premier d’autres. Il serait bon qu’il ne pourrisse pas ». « Ce n’est pas seulement une question d’égalité de genre – dit Regina da Costa Pedro –. Je suis convaincue que l’Esprit a beaucoup à dire à l’Église à travers la parole et l’action des femmes ».
« Au-delà de ses effets immédiats, cette série de réunions a été un événement décisif – conclut Stella Morra –. Que les autorités de l’Église disent qu’elles ont besoin de mieux comprendre et se mettent dans une attitude d’apprentissage, et d’apprentissage par des femmes, est le véritable changement de paradigme ».
Lucia Capuzzi
Journaliste du quotidien «Avvenire»
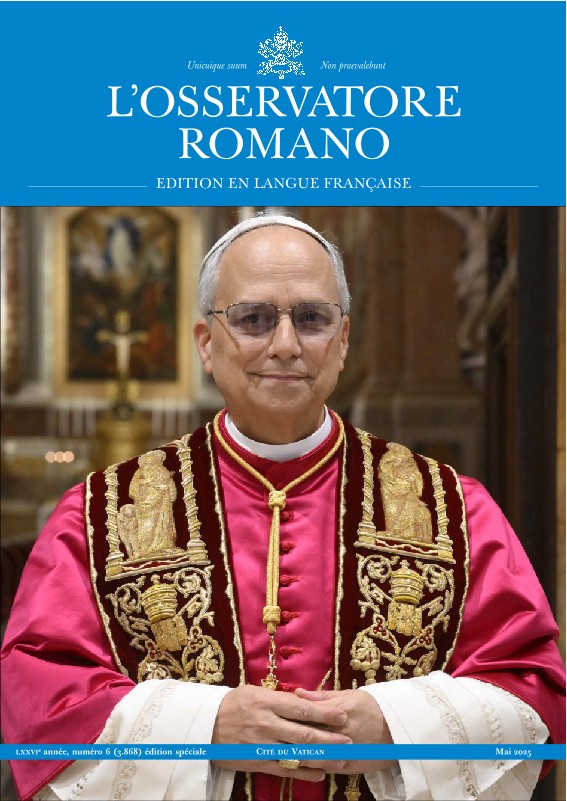



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti