La porte sainte

Le 24 décembre, un Pape âgé franchira la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, non sans effort mais avec détermination. Cette porte est appelée « sainte » et a été murée lors de la clôture du jubilé précédent, le jubilé extraordinaire qui s’est ouvert le 29 novembre 2015, à l’occasion du 50e anniversaire du Concile Vatican II, et qui était dédié à la miséricorde. La force symbolique de ce geste est grande : François abattra ce mur et entrera dans la basilique qui représente tout d’abord aujourd’hui le cœur du catholicisme, mais il ne sera pas seul, car chacun est invité à faire comme lui pendant toute cette année. À y entrer, et si ce n’est physiquement, tout au moins dans la communion d’intentions qui préside à l’année jubilaire.
Cette fois-ci, étant donné qu’il s’agit d’un jubilé ordinaire et non extraordinaire, François ouvrira une autre porte en même temps que la porte sainte de Saint-Pierre et celles des trois autres basiliques romaines, celle d’une prison, d’un lieu qui, précisément parce qu’il ne peut pas être franchi physiquement, évoque avec force la nécessité d’une libération.
D’autre part, à la base de la reprise chrétienne de la pratique jubilaire juive, n’y a-t-il pas les paroles du prophète Isaïe que Jésus, dans le discours par lequel il inaugure sa mission messianique dans la synagogue de Nazareth, réfère à lui-même ? Le prophète avait dit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur » (Lc 4, 18 sq.). Par ce geste et par cette porte, le Pape et avec lui toute l’Église entrent non seulement dans un espace reconnu comme sacré, mais aussi dans un temps reconnu comme saint, une « année de grâce ».
La sanctification du temps
L’année jubilaire est l’un des nombreux héritages que le christianisme doit au judaïsme, en particulier à sa vision grandiose de la sanctification du temps. Pour l’être humain, le temps représente, avec l’espace, la situation de vie par excellence. Mais il représente aussi le grand adversaire, car il érode la vie et nous rapproche de la mort. D’autre part, le dieu du temps, Saturne/Chronos, fils du Ciel et de la Terre mère, qui mange ses enfants, ne fait-il pas partie du panthéon des divinités païennes ? Avec l’« invention » du sabbat, c’est-à-dire de la distinction entre le temps réservé aux œuvres des hommes et le temps réservé à Dieu, Israël réalise une opération décisive : l’homme n’est pas dominé par le temps, mais il le domine lui-même à partir du moment où il reconnaît que Dieu est le maître du temps, parce qu’il a imprimé dans sa création la loi de l’alternance entre l’activité et le repos. Il y a quelqu’un, en somme, qui est plus fort que le temps et qui est même le seul qui peut « racheter » le temps car, par le don de la vie qui ne meurt pas, il arrive à ôter son « aiguillon » à la mort, comme l’écrivait Paul aux chrétiens de Corinthe (1 Corinthiens 15, 55).
Le septième jour, le sabbat, ainsi que l’année sabbatique, qui revenait tous les sept ans, sanctifiaient le rythme des jours, des semaines et des mois. Plus tard, l’institution de l’année jubilaire renforça encore davantage le schéma sabbatique en l’ancrant même à une mesure du temps extrêmement dilatée : « La terre chômera un sabbat pour Yahvé. Pendant six ans tu ensemenceras ton champ, pendant six ans tu tailleras ta vigne et tu en récolteras les produits. Mais en la septième année la terre aura son repos sabbatique, un sabbat pour Yahvé […] Tu compteras sept semaines d’années, sept fois sept ans, c’est-à-dire le temps de sept semaines d’années, quarante-neuf ans. Le septième mois, le dixième jour du mois tu feras retentir l’appel de la trompe ; le jour des Expiations vous sonnerez de la trompe dans tout le pays. Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé : chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire : vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n'auront pas été mis en gerbe, vous ne vendangerez pas les ceps qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte […] » (Lévitique 25, 1-12). En somme, l’année jubilaire devait permettre à toute chose de revenir à son origine, c’est-à-dire être remise entre les mains de Dieu : la terre se reposait, les dettes étaient remises, les esclaves libérés, et le temps de l’histoire était ainsi sanctifié.
La question de savoir si l’ancien Israël a réussi à respecter cette norme ou si elle représentait simplement l’idéal d’un modèle social fait l’objet d’un débat parmi les spécialistes. Il n’en reste pas moins que le christianisme médiéval et plus tard le catholicisme romain ont repris la norme de l’année jubilaire après en avoir spiritualisé les contours : la rémission des conséquences des péchés se substitue à la restitution de la terre et de l’histoire à Dieu, et la médiation indispensable de l’Église en vue de l’obtention du salut, également éternel, est ainsi affirmée avec force. Alors, comme l’annonce le Psalmiste, ce sera Dieu lui-même qui franchira les portes du temps pour venir habiter la terre : « Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le Roi de gloire y fasse son entrée ! » (24,7).
Je suis la porte
Réalité, métaphore, symbole, la porte renvoie avec encore plus de force à l’autre dimension portante du jubilé, celle de l’espace à habiter, qu’il s’agisse de la maison, de la ville, du pays ou de la vie. Nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais dans notre quotidien, nous ne cessons de les franchir, de les ouvrir et de les fermer : sentinelles qui assurent la pluralité des espaces et la détermination des lieux, les portes établissent la cartographie de notre parcours et le balisent, souvent même de manière imperceptible.
Massives ou légères, dorées comme celles du Kremlin ou en tissu comme celles des tentes des camps de réfugiés, les portes sont aussi d’importantes métaphores de la vie et de son ambivalence dynamique, car elles renvoient à des actions vitales dont dépend la qualité des temps et des espaces dans lesquels elles se déroulent : entrer-sortir, ouvrir-fermer ou encore accueillir-éloigner. C’est également pourquoi la porte peut également revêtir la qualité de symbole dans le domaine religieux, comme le montre l’importance qui lui est accordée dans l’un des temps forts de la vie de l’Église catholique, celui de l’année jubilaire.
Il est également possible d’explorer la signification symbolique de la « porte sainte » à partir de la Bible. En effet, en tant que grand livre de Dieu-avec-les-hommes, la Bible est pleine de portes qui, qu’elles délimitent le seuil des maisons ou celui des villes, renvoient à des contenus théologiques clairs. Nous pouvons rappeler ici deux passages de l’Ancien Testament et un du Nouveau, qui nous aident à identifier les significations théologiques possibles de la porte du Jubilé.
Après le célèbre rêve de l’échelle qui reposait sur la terre, mais dont le sommet atteignait le ciel et sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient, le patriarche Jacob reconnaît que le lieu où l’on fait l’expérience de Dieu doit lui être consacré, perdant ainsi son sens ordinaire pour devenir le lieu de la présence de Dieu, c’est-à-dire le lieu d’où l’on accède au ciel : « Que ce lieu est redoutable ! Ce n’est rien de moins qu’une maison de Dieu et la porte du ciel ! » (Genèse 28, 17). La porte de la maison de Dieu nous permet d’entrer dans un espace « autre », là où Dieu devient présent, là où les pensées deviennent des « visions » qui révèlent le sens de ce que nous vivons. Métaphoriquement, la naissance et la mort sont donc les portes par lesquelles on entre dans la vie et par lesquelles on en sort, et pour la Bible elles sont toujours gardées, c’est-à-dire qu’elles ne déterminent pas mécaniquement le passage entre un avant et un après, mais, comme le reconnaît le Psalmiste, Dieu, gardien de la vie, « te gardera quand tu sortiras et quand tu entreras, dès maintenant et pour toujours » (121, 8).
Cependant, les portes gardent aussi le passage entre l’intérieur et l’extérieur, entre le besoin d’appartenance, en nous donnant un sentiment de protection, et le besoin de liberté, d’où tirer sa force vitale. C’est pour cette raison que l’expression la plus théologiquement prégnante de la charge symbolique de la porte est celle qui prend une signification christologique lorsque Jésus l’identifie à lui-même.
Dans un discours de l’évangile de Jean aussi évocateur que complexe, Jésus se définit d’abord comme le véritable berger du troupeau parce que, contrairement aux chefs du peuple qui sont des loups déguisés en bergers, il est le seul à pouvoir entrer dans la bergerie par la porte, mais ensuite, immédiatement après, il en vient à identifier la porte de la bergerie avec lui-même : « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés » (10,7 sq.). Comme toujours, Jésus ne révèle son identité de Messie qu’à ceux qui ont la capacité de comprendre l’image, d’en saisir la puissance symbolique et sa potentialité à se traduire par une réalisation effective : c’est en passant par lui que son troupeau pourra sortir sans crainte de la bergerie et jouir du pâturage qui lui permet de vivre, et c’est en passant par lui qu’il pourra y retourner et se protéger des loups.
Lorsque le Pape, pendant la Messe de la nuit de Noël, inaugurera l’année de grâce jubilaire en franchissant la porte sainte, il demandera aussi à son Église de revenir à Dieu par la seule porte qui donne accès au salut, celle de la révélation du Père par le Fils : « Je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira, et trouvera un pâturage » (10, 9).
Marinella Perroni
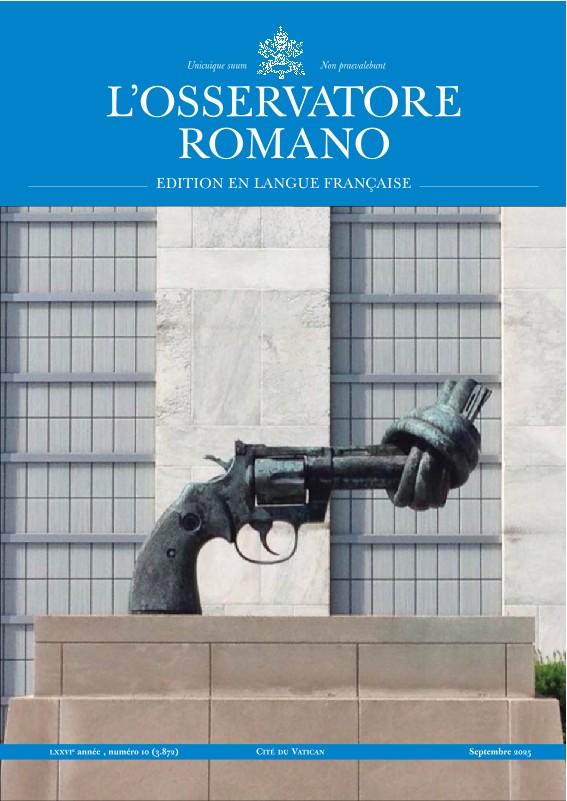



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti