Ce que nous devons

Comme c’est souvent le cas des personnes qui possèdent des talents exceptionnels, Maria Gaetana Agnesi a eu deux vies en une. Elle a été l’une des plus brillantes mathématiciennes de tous les temps, puis, bouleversant son existence en cours de route, elle est devenue une bienfaitrice prodigue pour les pauvres et les exclus.
Il existe un portrait d’elle, une gravure de Maria Longhi, où Maria Gaetana Agnesi est une jeune femme milanaise habillée à la manière aristocratique de l’Europe du XVIIIe siècle, le regard sévère et pénétrant et portant des boucles d’oreilles précieuses. En réalité, elle nourrissait un profond dédain pour la richesse et le beau monde. La vie des salons milanais, que son père Pietro Agnesi aspirait à fréquenter, ne faisait pas partie de ses centres d’intérêt, tout comme elle n’aimait pas les soirées au théâtre, les bals et les passe-temps oisifs de la bonne société. L’oisiveté, à l’époque, convenait aux femmes de son rang, destinées à grandir avec peu d’éducation pour devenir un jour mères de famille. Maria Gaetana Agnesi, née à Milan en 1718, se serait engagée dans cette voie désormais toute tracée si son père n’avait pas mis à profit son extraordinaire intelligence. Pour ce faire, Pietro a dû aller à l’encontre non seulement des préceptes sociaux de l’époque, mais aussi de la volonté de sa propre fille Maria Gaetana.
Aînée d’une famille de 21 enfants, même si, selon certaines sources, ils furent probablement 22 ou 23, dès son enfance, elle surprend sa famille en faisant preuve d’un talent exceptionnel pour l’apprentissage des langues étrangères, y compris le latin. Très jeune, elle apprend l’hébreu, l’anglais, le français, l’espagnol et l’allemand. A l’âge de neuf ans, son précepteur l’aide à rédiger un discours en faveur de l’éducation des femmes, qu’elle déclame devant son père ému.
Pietro Agnesi n’est pas un aristocrate ; devenu riche grâce à l’industrie de la soie, il aspire à devenir un nom important dans les cercles milanais. Sa femme, Anna Fortunata Brivio, est une noble qui mourra après avoir donné naissance à huit enfants, dont beaucoup sont talentueux et ingénieux, comme la deuxième enfant, Teresa Agnesi, une remarquable musicienne. Mais personne dans la lignée n’égale Maria Gaetana, leur viatique dans la haute société. Des dizaines d’intellectuels de la péninsule italienne et d’Europe fréquentent le salon des Agnesi pour connaître cette jeune prodige qui, à dix-neuf ans, maîtrise la philosophie, la physique, l’éthique, la métaphysique et la biologie, au point d’écrire un traité entier – Propositiones Philosophicae – qu’elle illustre avec aisance devant l’assistance, discutant et disputant en latin, tandis que sa sœur Teresa joue du clavecin. Sa renommée est également parvenue au Français Charles Brosses, ami des encyclopédistes des Lumières, qui, après l’avoir rencontrée, admet n’avoir jamais rencontré quelqu’un qui « maniait aussi bien le latin ». Pourtant, Maria Gaetana Agnesi, bien que flattée par les compliments sincères, nourrit un désir radical, à l’opposé de ce qu’elle a vécu jusque-là, celui de devenir religieuse et de s’éloigner du monde qui l’encense.
Elle implore son père de l’exclure de la vie conjugale et de la laisser vivre au couvent. Pietro Agnesi verrait dans le choix de sa fille un gâchis et une insulte, et refuse donc de l’approuver. Pater familias éclairé, il est l’un des rares à soutenir ses filles à cultiver leurs dons intellectuels et artistiques ; l’intelligence de Maria Gaetana joue une fois de plus contre son désir, de façon si intense et si troublante qu’elle décide de se plonger corps et âme dans l’étude des mathématiques, la matière qui la rapproche probablement le plus de Dieu. En peu de temps, elle devient une mathématicienne exceptionnelle, parvenant à démêler les disputes sur le calcul infinitésimal de Newton et de Leibniz, elle est traduite en France et en Angleterre, sa lumière brille partout où l’on parle d’elle. A Cambridge (Grande-Bretagne), déjà à l’époque l’un des centres de connaissance les plus importants du monde, des mathématiciens comme John Colson lisent avec émerveillement l’ouvrage de Maria Gaetana Agnesi, « Institutions analytiques à l’usage de la jeunesse italienne », premier manuel systématique jamais publié sur l’algèbre, la géométrie et le calcul intégral et différentiel, que la jeune femme traduit de l’italien en latin pour une plus grande diffusion et qu’elle fait imprimer dans le salon de son père en convainquant les imprimeurs d’exécuter le travail selon ses directives.
L’ouvrage devient un passage obligatoire pour quiconque désire se familiariser avec les systèmes de Newton et de Leibniz, et il est universellement acclamé. L’Accademia della Crusca, l’institution qui veille sur la langue italienne, reprend les termes mathématiques utilisés par Maria Gaetana Agnesi dans le premier Dictionnaire. La jeune mathématicienne milanaise décide de dédier les deux volumes de son prodigieux ouvrage à Marie-Thérèse d’Autriche, son impératrice, à qui elle écrit qu’elle se sent proche d’elle d’une certaine manière, car toutes deux sont des femmes, et donc habituées à lutter davantage pour gagner la considération des autres. Bien qu’elle soit l’une des souveraines les plus puissantes de l’époque, Marie-Thérèse apprécie ces mots écrits par une femme géniale et envoie à Maria Gaetana Agnesi un petit sac de diamants en guise de remerciement. Le Pape Boniface XIV est encore plus concret et lui offre la chaire de l’université de Bologne, faisant de Maria Gaetana Agnesi la première femme professeure de mathématiques de l’université depuis l’année de sa fondation. A l’époque, la médaille Fields, décernée à partir de 1936 aux meilleurs mathématiciens du monde, n’avait pas encore été instituée, mais l’estime et les honneurs accordés à Maria Gaetana Agnesi alors qu’elle n’avait que trente ans égalent ceux des lauréats du prix Nobel d’aujourd’hui. Dans le palais milanais de Pietro Agnesi arrivent des lettres de savants qui demandent à la jeune femme de commenter leurs questions de géométrie et d’algèbre, l’Académie royale de France inscrit son œuvre parmi les textes les plus avancés de la connaissance humaine. En effet, Maria Gaetana Agnesi se lance également dans la géométrie et baptise un type de courbe encore aujourd’hui connu sous le nom de la courbe d’Agnesi, qui, dans les pays anglo-saxons, en raison d’une erreur de traduction, est appelée « la courbe de la sorcière », un paradoxe si l’on considère l’extraordinaire transformation que Maria Gaetana était sur le point d’imprimer à sa propre existence, afin de suivre cette charité du cœur qu’elle n’avait jamais eu l’occasion de mettre en pratique jusque-là. Son père, seul capable d’imposer sa vision à sa fille, meurt subitement au cours d’une dispute. Si l’autorité paternelle lui a donné la liberté de devenir une femme de science extraordinaire, Maria Gaetana Agnesi trouve à présent le courage de donner corps à sa vocation authentique et, en 1750, elle abandonne les mathématiques, refuse la chaire à l’Alma Mater de Bologne et se consacre entièrement à un projet qui déconcerte toute sa famille. En quelques temps, le palais des Agnesi devient un lieu où les femmes étudient pour devenir infirmières et Maria Gaetana elle-même se consacre aux soins des pauvres et des malades, trouvant le temps de servir d’institutrice à tous ceux qui veulent s’instruire, y compris les serviteurs du palais. Lorsqu’elle comprend que son œuvre pieuse est incompatible avec la vie de famille, elle vent les diamants de l’impératrice Marie-Thérèse et ouvre un hôpital, où elle se réserve une petite chambre, afin de partager ses souffrances avec les malades. A Milan, le nom d’Agnesi est désormais associé à la philanthropie, à tel point qu’en 1771, elle est invitée à présider en tant que prieure le Pio Albergo Trivulzio, un lieu qui accueille les patients les plus indigents et où la jeune femme continue de recevoir des scientifiques et des membres des académies les plus prestigieuses d’Europe, désireux de soumettre à son attention de nouveaux calculs d’algèbre et de nouvelles théories mathématiques. Elle seule, ils en sont convaincus, peut donner un avis autorisé sur les études qu’ils mènent. Tous, sans exception, sont invités à renoncer. Seules les Ecritures Saintes et la vie des saints remplissent les longues heures du soir de la jeune femme désormais démunie. Maria Gaetana, qui aurait pu vivre dans l’aisance, n’a pas même l’argent nécessaire pour s’acheter de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures, ainsi son frère Joseph l’accueille dans son palais milanais, d’où Maria Gaetana Agnesi pourrait poursuivre son engagement désormais proche de la sainteté en prenant soin de sa santé et en bénéficiant de repas adéquats. Toutefois, âgée désormais de soixante ans, elle refuse également ce geste de générosité et continue à passer ses journées au chevet des malades. Elle n’écrit jamais sur elle-même, sur son esprit, sur sa vie exceptionnelle. Elle ne veut pas laisser de commentaires sur sa vie passée, attirer l’attention sur elle est le dernier de ses soucis. Elle profite toutefois de sa célébrité pour entrer de temps en temps dans des banquets milanais afin de faire connaître l’état de besoin des pauvres de la ville et de demander des fonds pour soulager l’indigence. Si elle était bien acceptée et recherchée en tant que scientifique, son insistance à obtenir de l’argent pour les malheureux la conduit toutefois à présent à devenir une visiteuse inopportune. L’un après l’autre, les portiers des riches bourgeois reçoivent l’ordre de ne plus ouvrir leur porte à Maria Gaetana Agnesi. Expulsée et marginalisée, elle travaille sans relâche au Pio Trivulzio pendant vingt-trois ans, jusqu’à ce qu’elle soit atteinte d’une pneumonie. Elle laisse une seule lettre, demandant à être enterrée dans une fosse commune, anonymement, aux côtés des oubliés.
Laura Eduati
Journaliste, enseignante et écrivaine
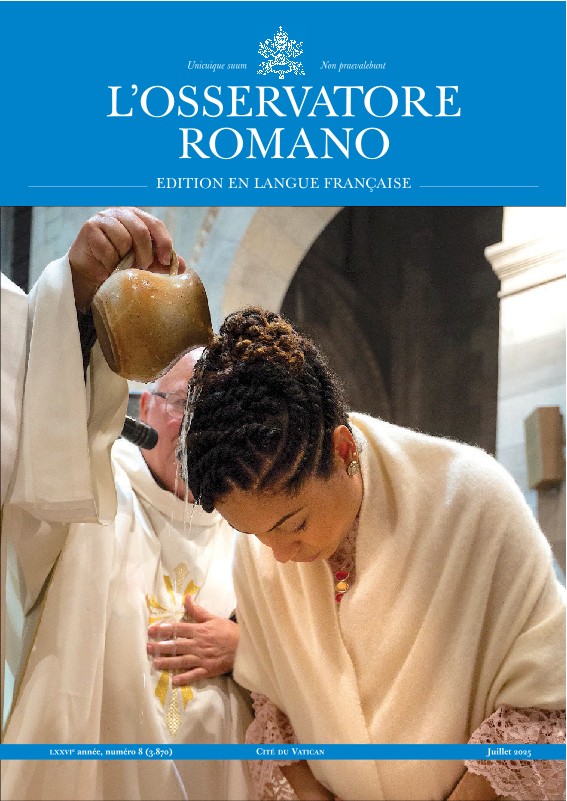



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti