
Dans l’après-midi du dimanche 30 avril, le Pape François a prononcé le dernier discours de son voyage en Hongrie, lors de la rencontre avec le monde universitaire et de la culture à la faculté d'informatique et de sciences bioniques de l'université catholique «Péter Pázmány» de Budapest. Nous publions ci-dessous le texte de son allocution.
Chers frères et sœurs, bon après-midi!
Je salue chacun de vous et je vous remercie pour les belles paroles qui ont été dites et sur lesquelles je m’arrêterai tout à l’heure. C’est la dernière rencontre de ma visite en Hongrie et j’aime penser, le cœur reconnaissant, au cours du Danube qui relie ce pays à beaucoup d’autres. Il les unit géographiquement mais aussi historiquement. La culture, en un certain sens, est comme un grand fleuve. Elle connecte et parcourt les différents lieux de la vie et de l’histoire en les reliant, elle permet de naviguer dans le monde et d’embrasser des pays et des terres lointaines, elle désaltère l’esprit, irrigue l’âme, fait croître la société. Le mot même de culture dérive du verbe cultiver: le savoir suppose une semence quotidienne qui, en s’introduisant dans les sillons de la réalité, porte du fruit.
Il y a cent ans, Romano Guardini, grand intellectuel et homme de foi, alors qu’il était face un paysage unique en raison de la beauté des eaux, eut une intuition culturelle féconde. Il écrivit: «Ces jours-ci j’ai plus que jamais compris qu’il y a deux formes de connaissance [...], l’une conduit à se plonger dans l’objet et dans son contexte, l’homme qui veut connaître cherche à vivre en lui. L’autre, au contraire, rassemble les choses, les décompose, les range dans des cases, en acquiert maîtrise et la possession, les domine» (Lettres du lac de Côme: sur la technique et l’humanité, Brescia 2022, p. 55). Il distingue entre une connaissance humble et relationnelle, qui est comme «une souveraineté qui s’obtient par le service; une création selon la nature qui ne dépasse pas les limites établies» (cf. p. 57), et une autre manière de connaître qui «n’observe pas, mais analyse [...] qui ne s’immerge plus dans l’objet, mais qui le saisit» (p. 56).
Et voici que, dans cette seconde manière de connaître, «les énergies et les substances sont orientées vers une unique finalité: la machine» (p. 58), de sorte qu’ «une technique de l’assujettissement de l’être vivant se développe» (p. 59-60). Guardini ne diabolise pas la technique laquelle permet de mieux vivre, de communiquer et qui offre beaucoup d’avantages, mais il met en garde contre le risque qu’elle devienne régulatrice, sinon dominatrice, de la vie. En ce sens, il voyait un grand danger: que «l’homme perde tous les liens intérieurs qui lui procurent un sens organique de la mesure et des formes d’expression en harmonie avec la nature» et alors que, «devenu dans son être intérieur sans contours, sans mesure, sans direction, il établisse arbitrairement ses fins et contraigne les forces de la nature, qu’il domine, à les mettre en œuvre» (p. 60). Et il laissait à la postérité une question inquiétante: « Qu’adviendra-t-il de la vie si elle finit sous ce joug? [...] Que se passera-t-il [...] lorsque nous nous trouverons face à la primauté des impératifs de la technique? La vie est désormais encadrée par un système de machines. [...] Dans un tel système, la vie peut-elle rester vivante?» (p. 61).
La vie peut-elle rester vivante? C’est une question qu’il est bon de se poser, spécialement en ce lieu où l’informatique et les «sciences bioniques sont approfondies». En effet, ce que Guardini a entrevu apparaît évident de nos jours. Pensons à la crise écologique, avec la nature qui ne fait que réagir à l’usage instrumental que nous en avons fait. Pensons au manque de limites, à la logique du «on peut le faire donc c’est licite». Pensons aussi à la volonté de mettre au centre de tout, non pas la personne et ses relations, mais l’individu centré sur ses besoins, avide de s’enrichir et de s’emparer de la réalité. Et pensons, en conséquence, à l’érosion des liens communautaires sans lesquels la solitude et la peur, de conditions existentielles, semblent se transformer en conditions sociales. Combien d’individus isolés, très «social» et peu sociaux, recourent, comme dans un cercle vicieux, aux consolations de la technique pour remplir le vide qu’ils ressentent. Ils courent encore plus frénétiquement et, succombant à un capitalisme sauvage, ils ressentent comme plus douloureuses leurs faiblesses, dans une société où la vitesse extérieure va de pair avec la fragilité intérieure. C’est là le drame. En disant cela, je ne veux pas engendrer du pessimisme — ce serait contraire à la foi que j’ai la joie de professer —, mais réfléchir sur cette «arrogance d’être et d’avoir» que déjà, à l’aube de la culture européenne, Homère voyait comme menaçante et que le paradigme technocratique accentue, avec une certaine utilisation des algorithmes qui peut représenter un risque supplémentaire de déstabilisation de l’humain.
Dans un roman que j’ai plusieurs fois cité, Le maître de la terre, de Robert Benson, on observe «que la complexité mécanique n’est pas synonyme de vraie grandeur et qu’un piège se cache plus subtilement dans une extériorité plus magnifique» (Vérone 2014, pp. 24-25). Dans ce livre en un certain sens «prophétique», écrit il y a plus d’un siècle, un avenir dominé par la technique est décrit, dans lequel tout est uniformisé au nom du progrès: partout l’on prêche un nouvel «humanitarisme» qui annule les différences, en réduisant à zéro la vie des peuples et en abolissant les religions. En abolissant les différences, toutes les différences. Des idéologies opposées convergent vers une homologation qui colonise idéologiquement. C’est là le drame, la colonisation idéologique; l’homme s’aplatit de plus en plus au contact des machines, alors que la vie commune se raréfie et devient triste. Dans ce monde, avancé mais sombre, décrit par Benson, où tout le monde paraît insensible et anesthésié, il semble évident qu’il faut écarter les malades et appliquer l’euthanasie, abolir les langues et les cultures nationales pour atteindre une paix universelle qui se transforme, en réalité, en une persécution fondée sur l’imposition du consentement, au point de faire affirmer à un protagoniste que «le monde semble à la merci d’une vitalité perverse qui corrompt et confond tout» (p. 145).
Je me suis engagé dans cette sombre analyse parce que, dans ce contexte, les rôles de la culture et de l’université ressortent davantage. L’université est, en effet, comme son nom l’indique, le lieu où la pensée naît, grandit et mûrit, ouverte et symphonique, non pas monotone, non pas fermée: ouverte et symphonique. Elle est le «temple» où la connaissance est appelée à se libérer des limites étroites de l’avoir et de la possession pour devenir culture, c’est-à-dire «cultivation» de l’homme et de ses relations fondatrices: avec le transcendant, avec la société, avec l’histoire, avec la création. Le Concile Vatican ii affirme à ce propos: «La culture doit être subordonnée au développement intégral de la personne, au bien de la communauté et à celui du genre humain tout entier. Aussi convient-il de cultiver l’esprit en vue de développer les puissances d’admiration, de contemplation, d’aboutir à la formation d’un jugement personnel et d’élever le sens religieux, moral et social » (Const. past. Gaudium et spes, n. 59). Dans l’Antiquité déjà, on disait que le commencement de la philosophie était l’admiration, la capacité d’admiration. Dans cette perspective, j’ai beaucoup apprécié vos paroles. Les vôtres, Monsieur le recteur, lorsque vous avez dit qu’«en tout vrai scientifique il y a quelque chose du scribe, du prêtre, du prophète et du mystique»; et encore qu’«avec l’aide de la science, nous ne voulons pas seulement comprendre, nous voulons aussi faire la chose juste, c’est-à-dire construire une civilisation humaine et solidaire, une culture et un environnement durables. C’est le cœur humble que nous pouvons monter non seulement sur la montagne du Seigneur, mais aussi sur la montagne de la science».
Cela est vrai en effet, les grands intellectuels sont humbles. D’ailleurs, le mystère de la vie se révèle à ceux qui savent entrer dans les petites choses. Ce qu’a dit Dorottya est beau: «En découvrant de plus en plus les petits détails, nous plongeons dans la complexité de l’œuvre de Dieu». Ainsi comprise, la culture représente vraiment la sauvegarde de l’humain. Elle immerge dans la contemplation et façonne des personnes qui ne sont pas à la merci des modes du moment, mais bien enracinées dans la réalité des choses. Humbles disciples du savoir, elles sentent qu’elles doivent être ouvertes et communicatives, jamais rigides ni agressives. Celui qui aime la culture, en effet, ne se sent jamais arrivé, mais porte en lui une saine inquiétude. Il recherche, interroge, risque, explore; il sait sortir de ses certitudes pour s’aventurer avec humilité dans le mystère de la vie. Il éprouve l’inquiétude, non l’habitude; il s’ouvre aux autres cultures et il ressent le besoin de partager le savoir. Voilà l’esprit de l’université, et je vous remercie de le vivre ainsi, comme nous l’a dit le professeur Major qui a dit la beauté de coopérer avec d’autres réalités éducatives, à travers des programmes de recherche partagés, et également en accueillant des étudiants d’autres régions du monde, comme le Moyen-Orient, en particulier de la Syrie meurtrie. C’est en s’ouvrant aux autres qu’on se connaît le mieux. L’ouverture, l’ouverture aux autres est comme un miroir: elle me permet de mieux me connaître.
La culture nous accompagne dans la connaissance de nous-mêmes. La pensée classique, qui ne doit jamais disparaître, nous le rappelle. Les célèbres paroles de l’oracle de Delphes viennent à l’esprit: «Connais-toi, toi-même». C’est l’une des deux phrases-guides que je voudrais vous laisser en conclusion. Mais que signifie connais-toi, toi-même ? Cela signifie reconnaître ses propres limites et, par conséquent, limiter sa présomption d’autosuffisance. Cela nous est bon, car c’est avant tout en nous reconnaissant en tant que créatures que nous devenons créatifs; en nous plongeant dans le monde au lieu de le dominer. Et tandis que la pensée technocratique poursuit un progrès qui n’admet pas de limites, l’homme réel est aussi fait de fragilité; et c’est souvent là qu’il comprend qu’il est dépendant de Dieu et relié aux autres et à la création. L’oracle de Delphes invite donc à une connaissance qui, partant de l’humilité, partant de la limite, partant de l’humilité de la limite, découvre ses merveilleuses potentialités qui vont bien au-delà de celles de la technique. En d’autres termes, se connaître soi-même demande de tenir ensemble, dans une dialectique vertueuse, la fragilité et la grandeur de l’homme. La culture naît de l’émerveillement de ce contraste: jamais satisfaite et toujours en recherche, inquiète et communautaire, disciplinée dans sa finitude et ouverte à l’absolu. Je vous souhaite de cultiver cette passionnante découverte de la vérité !
La deuxième phrase-guide se réfère précisément à la vérité. C’est une phrase de Jésus Christ: «La vérité vous rendra libres» (Jn 8, 32). La Hongrie a vu se succéder des idéologies qui s’imposaient comme vérité, mais qui ne donnaient pas la liberté. Et aujourd’hui encore, le risque n’a pas disparu: je pense au passage du communisme au consumérisme. Les deux «ismes» ont en commun une fausse idée de liberté. Celle du communisme était une «liberté» contrainte, limitée de l’extérieur, décidée par quelqu’un d’autre. Celle du consumérisme est une «liberté» libertine, hédoniste, aplatie sur elle-même, qui rend esclaves des produits de consommation et des choses. Et comme il est facile de passer des limites imposées au fait de penser, comme dans le communisme, au fait de se penser sans limites, comme dans le consumérisme. D’une liberté freinée à une liberté sans freins. Jésus, au contraire, offre une issue en disant qu’est vrai ce qui libère, ce qui libère l’homme de ses dépendances et de ses fermetures. La clé pour accéder à cette vérité c’est une connaissance jamais détachée de l’amour relationnel, humble et ouvert, concret et communautaire, courageux et constructif. C’est ce que les universités sont appelées à cultiver, et la foi à nourrir. Je souhaite donc à chaque université, et celle-ci, d’être un centre d’universalité et de liberté, un chantier fécond d’humanisme, un laboratoire d’espérance. Je vous bénis de tout cœur et je vous remercie pour ce que vous faites: merci beaucoup!
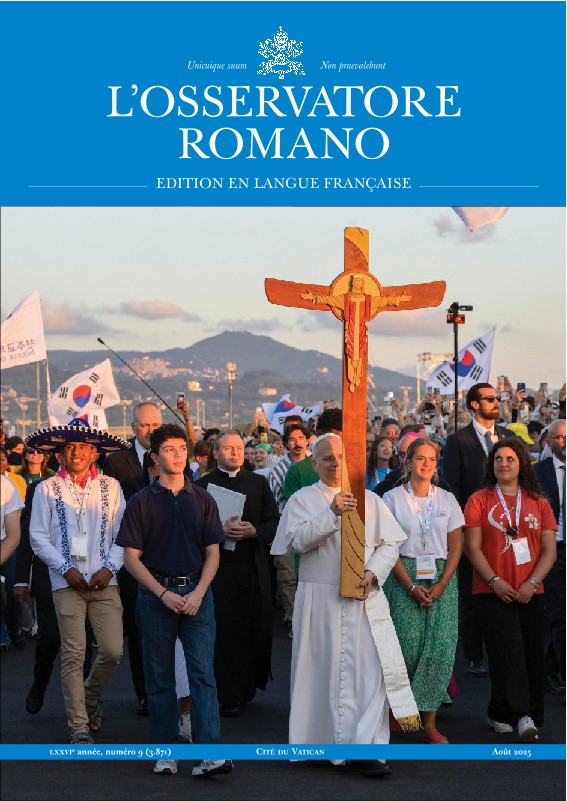



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti