
Ce qui ne change pas
je chante
le nuage la cime la tige
l’offrande le don le fléau
Ce sont des vers de Mariangela Gualtieri tirés du recueil Bestia di gioia [Bête de joie] (Einaudi, 2010) qui représentent une poétique en profonde harmonie avec le fait d'être et de ne pas être, avec les choses, la nature, les animaux. Des vers pacifiés, également avec ce qui pour les autres est source de douleur et de frayeur: la fin, la mort, les abîmes de la sensibilité. Des vers qui cherchent (et trouvent) un point de stabilité dans le fait d'être au monde, une racine qui creuse dans des zones profondes pour arriver au ciel. Des vers remplis de reconnaissance pour la vie. Je lis dans le même recueil:
Au centre de moi-même
une bestiole accroupie se réveille
et respire le silence qui, dans la journée,
a manqué. Elle respire. A sa manière
elle chante
C'est cette capacité de se sentir appartenir à un tout mystérieux, mais qui ne terrorise pas, cette joie affectueuse qui active peut-être les antennes cachées d'une capacité artistique inévitablement prophétique. Si je pense aux poètes d'aujourd'hui, je ne vois pas qui mieux que Mariangela Gualtieri peut incarner la figure du bon prophète, riche d'amour pour la création, pour son mal et son bien, que tant de personnes ont pu reconnaître dans la lecture d'une de ses poésies, Bello mondo, tirée du recueil Le giovani parole (Einaudi, 2015), qui a été faite l'hiver dernier par Jovanotti sur la scène du festival de Sanremo:
Je désire remercier
Car sur cette terre existe la musique
la main droite et la main gauche
Et leur accord intime
pour qui est indifférent à la notoriété
Pour les chiens, pour les chats
Etres fraternels chargés de mystère
Une poésie “franciscaine” que l'autrice elle-même reconnaît comme telle, déjà écrite par les auteurs de son cœur, mais — j'utilise l'un de ses mots — «inépuisable», alors qu'elle me dit: «Depuis toujours, je me sens naturellement faire partie d'un tout très vaste et il me semble, de mon point de vue terrestre, doté d'une beauté stupéfiante. Cette beauté continue à se révéler à mes yeux et me passionne: je suis proche de l'enthousiasme de François d'Assise ou de G.M. Hopkins, plus que de la nature marâtre de Leopardi. Je crois que cela fait partie de mon « être-ainsi-faite ». La frayeur, ou la part d'ombre, appartient à ce qui m'éloigne de cette consonance, de ce sentiment d'être en harmonie avec le reste et, parmi les obstacles, il y a donc en premier lieu mon esprit tourmenté, quand il travaille de manière lancinante, et également la course incessante à laquelle nous sommes tous obligés, agir toujours en vue d'un résultat, le manque de silence».
Ne t'arrive-t-il jamais de ne pas désirer remercier (face aux horreurs du monde et de l'homme, par exemple)? «Tu m'interroges sur la douleur et sur sa signification et c'est vraiment un chapitre qui reste pour moi inexplicable, surtout quand ceux qui souffrent sont les plus fragiles, les plus faibles, les enfants, les vieux, les animaux. Je peux te répondre que non, il ne m'est jamais encore arrivé de ne pas désirer remercier et je comprends combien j'ai de la chance de pouvoir faire une affirmation de ce genre. Je sais qu'il y a des vies insupportables, très dures dans chacun de leurs moments, et cela me peine en raison d'un sentiment naturel de compassion. Il y a une imperfection dans le monde qu'il est difficile d'accepter, mais il y a aussi indéniablement une splendeur quotidienne qui me laisse souvent étonnée, profondément reconnaissante. Pense à Etty Hillesum dans son camp de concentration, quand elle dit que la vie est belle. C'est une manière de sentir qui me semble appartenir à un destin, tu ne crois pas?»
J'essaye de répondre à sa question. J'explique qu'au cours de cette période, je me sens écrasée par la violence et par la douleur, celles des autres, pas les miennes. Que je ne vois pas de lumière pour l'avenir et que j'ai peur. Mais j'ajoute que dans sa poésie je trouve la paix, je trouve une autre possibilité des choses. Dans Quando non morivo (Einaudi, 2019), je lis:
Nous sommes cette translation
changer de place et de nom.
Nous sommes un être ici, une navigation éternelle
de substance de nom en nom. Nous sommes»
Voilà. Selon moi, le fait d'être enracinés dans le changement est la grande force de ces vers, qui ne se remettent pas à Dieu («je ne sais pas l'invoquer ce Dieu qui est le tien / ni le blasphémer. Cela est trop dur pour moi»), mais qui restent dans l'attente suspendue de quelque chose, de quelqu'un, qui a donné forme au monde: «Qui a imaginé les fleurs, / avant, avant les fleurs» (Senza polvere senza peso, Einaudi 2006). Je me dis que l'art est peut-être inévitablement prophétique, visionnaire, et je lui demande: des poètes non prophétiques peuvent-ils exister? La réponse est sage: «Il faudrait avoir clairement à l'idée ce qu'est l'art contemporain, un milieu terriblement pollué par le marché, dans lequel il n'est pas simple de s'orienter. Je crois cependant que l'art est prophétique chaque fois qu'il devient un pont entre l'indicible et le monde, entre l'expérience et le monde en dehors de l'expérience. Chaque fois qu''à travers un signe fini, il nous met en contact avec l'illimité».
«La terre est la substance de mon dire…» soutiens-tu dans une poésie de ce recueil. Mais c'est une terre qui s'enfonce dans l'au-delà, qui te met en contact avec les morts. Au fond, c'est une terre céleste n'est-ce pas? «Comme l'écrivait Anna Maria Ortese la terre est un corps céleste: nous l'habitons et nous sommes faits d'elle. Pour les indiens d'Amérique, nous sommes de la terre qui parle, de la terre qui marche. Dans la Bible, le nom même d'Adam vient de la terre, la Adamà. Plus que voir au-delà, je pense qu'il est décisif de voir maintenant, et c'est peut-être cela qui fait la poésie. William Blake écrivait déjà que «si les portes de la perception étaient purifiées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie». La terre, l’humus dont dérive la parole humilité, me semble miraculeuse, en particulier depuis que j'habite à la campagne. Le secret de la semence devient la verdure du pré, écrit Rumi. Tout paraît receler un secret, tout paraît bien fait et je ne sais pas trouver la frontière entre matière et esprit, entre chair et esprit, entre terrestre et céleste. Les morts sont très présents en moi, depuis toujours. La petite fille que j'étais pensait qu'ils occupaient les pièces vides. Je me souviens de ma peur de les déranger: je chantais à tue-tête en montant l'escalier qui conduisait à ma chambre, pour donner le temps aux “morts” de disparaître. En y repensant à présent, ils ressemblaient beaucoup aux morts de Pascoli, muets, aimants, préoccupés pour nous, ce n'était absolument pas des spectres effrayants, mais plutôt des présences de l'autre monde, mystérieuses, sages, aidantes. J'ai eu la chance d'assister à la mort de mon père et ensuite de ma mère et de pouvoir prendre soin de leurs “chères formes”: la paix remplie de révélation de ces moments-là me semble leur dernier legs, leur dernier enseignement».
Et les rêves? Jouent-ils un rôle dans ta vision? «Les rêves non, ils ne sont pas tellement importants pour mon écriture, tout au moins de façon consciente. Mais parfois je me réveille la nuit et je note un vers qui m'apparaît en songe, ou que quelqu'un prononce dans son sommeil. J'ai toujours mon cahier avec moi, je me réveille et je l'écris. Je me souviens de : “Merci de ces pleurs sans lesquels je serais une chose sèche, immobile” que je disais à mon père qui venait me rendre visite en revenant de la mort… ce sont des mots qui ne me semblent pas les miens…»
Peux-tu me donner ta définition personnelle de prophétie? «Je pense qu'il y a une double définition: d'un côté, justement, la prophétie est garder bien vivant ce qui nous transcende, comme je viens de le dire, permettre d'avoir l'intuition de l'invisible. De l'autre, surtout en poésie, la voix qui est prophétique est celle qui, bien qu'ayant parlé il y a des siècles et des siècles, sait encore centrer ce que nous sentons, l'illumine encore. Et donc toucher avec les mots une profondeur que le temps n'a pas modifiée. Si quelqu'un, en lisant nos vers dans mille ans — si notre espèce est encore là —, éprouvera ce que nous éprouvons aujourd'hui, ce sera parce que ces mots auront traversé le temps sans s'user, sans s'éteindre, et cette lumière me semble prophétie».
As-tu la sensation, quand tu écris, d'être animée par une force mystérieuse à l'intérieur ou à l'extérieur de toi? «J'ai l'impression, à un certain moment, d'être pleine, de devoir vider mon sac, de devoir faire s'écouler quelque chose qui s'est accumulé en moi et qui demande à sortir avec urgence, avec violence. Mais ensuite, dans le moment de la précipitation poétique, l'impression la plus vive est que les paroles arrivent de l'extérieur. Dans ce moment-là tout semble extrêmement simple, presque évident, presque physiologique, il n'y a rien de mystérieux, également parce que le corps participe pleinement à ce qui est en train de se passer. Le mystère apparaît à l'esprit seulement après, quand en relisant ces mots, ils me semblent parfois beaucoup plus sages et complexes que la façon dont je me sens être en réalité. En substance, il me semble vraiment, comme l'affirme Rimbaud, que “je est un autre”, que celle qui a écrit n'est pas le moi que je connais».
A quoi la parole est-elle plus exactement “inadaptée? «Au-delà de la poésie ou de la philosophie, au-delà de la transmission des savoirs, il me semble que la parole est presque toujours inadaptée, décevante. Ou tout au moins, en dehors des vers, mes paroles me déçoivent presque toujours. Malheureusement, nous ne savons pas encore nous parler en vers… cela pourrait être l'un des objectifs auxquels nous sommes appelés, qui sait?».
Sandra Petrignani
Ecrivaine, journaliste culturelle
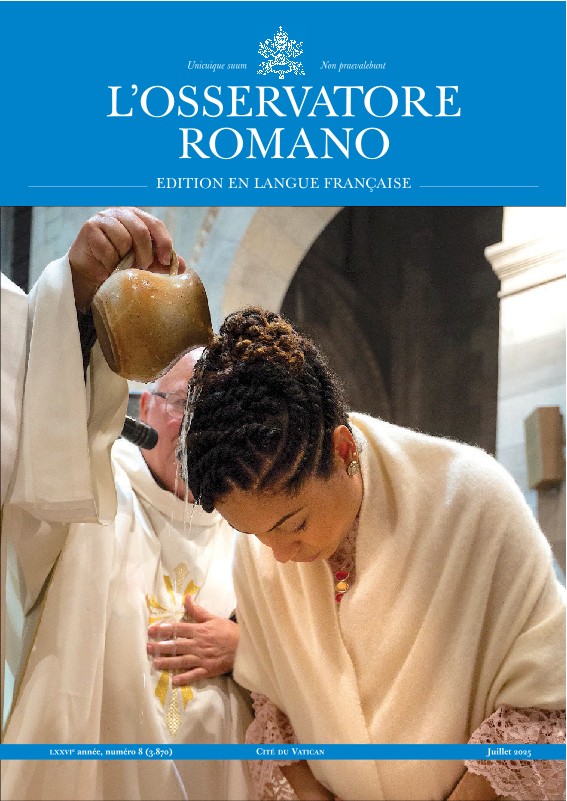



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti