Notre féminisme

Je possède une formation catholique, avec une histoire semblable à tant d’autres. Bien sûr, sur ce parcours ordinaire, il y a eu des figures importantes dès le début : ma mère qui, en tant que catéchiste, m’a fait respirer un christianisme pensant, un professeur de religion au collège, un prêtre revenu depuis peu d’Argentine, qui m’a fait entrevoir le point de vue du Sud du monde…
Par la suite, précisément parce que j’ai toujours été habituée à réfléchir sur le sens des liens et à tenir compte de la qualité des expériences, j’ai connu une période d’éloignement tant de la vie ecclésiale que de la foi et au cours des années du collège, j’ai choisi de ne pas étudier la religion catholique. Mon réveil en tant que croyante est arrivé, je crois, avec la maturité affective. Je devrais le dire avec prudence parce que les relectures, on le sait, arrivent après coup et sont donc toujours soutenues par autre chose. Mon histoire vient sans doute de la familiarité avec les textes de Simone Weil, dans lesquels on apprend qu’il y a deux expériences particulières pour rencontrer Dieu – la souffrance et la joie – même si, de fait, il est plus facile de s’approcher du sacré à travers les blessures. Or, dans mon cas, je crois qu’il s’est agi de bonheur. C’est un mot exigeant, je le sais. Je l’utilise dans le sens de la perception d’un excès affectif qui, dans la relation heureuse avec Alberto, ne pouvait venir simplement de l’humain. Je termine mes études de philosophie et, avec l’exubérance de mes vingt ans, je me marie ; très vite arrivent trois enfants, Matteo, Anna et Chiaro.
Philosophie et théologie
Dans mon histoire, le parcours de philosophie et de théologie se mêlent : il n’y a pas un avant et un après du point de vue des disciplines.
Après la maîtrise en philosophie, je m’inscris à l’Institut de sciences religieuses avec une certaine crainte et scepticisme, mais à ma première leçon de théologie fondamentale, je me passionne immédiatement pour une matière qui vit de questions et de l’obstination d’une espérance dont il faut rendre raison. Au cours de la première année, je me passionne au point que je décide de passer au Studium de théologie, avec les séminaristes. Baccalauréat, licence ; puis le doctorat en philosophie, et après celui en théologie.
Dans mon parcours de philosophie à l’Université de Vérone, je rencontre la communauté féminine Diotima, née en 1983 « sur le défi d’être femmes et penser d’un point de vue philosophique ». Au début, je suis déconcertée par cette modalité imprévue de penser et de parler : le style d’une philosophe qui ne se cache pas dans les livres des autres est une forme de spoliation à laquelle je ne suis pas préparée et je crains d’être absorbée par un jeu de miroirs dans lequel je ne me reconnais pas. C’est pour cette raison que je m’éloigne pendant quelques années, puis j’y reviens avec une force prise sans doute d’ailleurs, du monde théologique. Dans ce nouveau positionnement, je redécouvre la puissance de ce que l’on appelle à Diotima la « politique de la symbolique » : c’est une façon créative de lire la réalité, critique à l’égard des éléments négatifs, mais libre d’intercepter ce qui arrive de bon lorsque l’on n’a pas peur des différences.
La coordination des théologiennes
En étudiant la théologie, j’ai la chance de rencontrer comme professeure Cristina Simonelli et je perçois déjà dans ses leçons une nouvelle façon de présenter les questions théologiques et je perçois immédiatement une théologie accueillante non seulement à l’égard de la différence de sexe, mais également de toutes les autres différences. C’est elle, parmi les membres fondateurs de la Coordination des théologiennes italiennes, qui m’invite à l’un des séminaires annuels et m’introduit dans la trame des relations entre théologiennes, en m’accompagnant savamment dans la recherche de « ma voix », sans essayer de la recouvrir avec la sienne.
C’est cette même hospitalité que l’on respire au CTI, une coordination qui non seulement naît et veut être œcuménique, mais qui est également dirigée par des femmes plongées dans des domaines théologiques différents et avec des clés de lecture hétérogènes. Voilà pourquoi nous sommes une coordination : il s’agit d’une réalité qui se place comme force d’attraction et catalyseur de pensée, de paroles et de positions de femmes engagées dans une théologie capable de valoriser les différences, en critiquant toute lecture qui font d’elles un motif de déséquilibre et d’injustice. Cette pluralité est une richesse, et non le signe d’une absence de rigueur.
Dans notre statut, il est quoi qu’il en soit question d’une « théologie de genre ». Cette spécification indique notre sensibilité commune envers les interprétations du « masculin » et du « féminin » dans les narrations et dans les contextes chrétiens. Il s’agit d’un regard critique envers les stéréotypes explicites mais également envers les résistances patriarcales inconscientes qui déforment silencieusement le discours chrétien.
C’est un travail qui libère les femmes, mais qui porte un fruit également pour les hommes. C’est forts de cette conscience que certains d’entre eux se sont inscrits à la Coordination ou nous soutiennent d’autres façons.
Le féminisme, une révolution de vies réveillées
La révolution féministe est une révolution particulière parce qu’elle ne doit pas compter les morts, mais les vies réveillées. Ce sont avant tout les vies de femmes libérées de cultures qui les inhibent, de formes d’éducation qui les contrôlent, de traditions qui ne se souviennent pas d’elles ou qui, pire, en font des figurantes ou de mauvaises caricatures.
Dans cette révolution, on apprend une autre façon de faire mémoire, parce que l’on ne considère plus comme évidente ni nécessaire la culture traditionnelle déséquilibrée sur le masculin, et l’on va à la recherche de l’expérience réelle des femmes, de leur désir inexprimé, de leurs histoires marginalisées et de leurs rôles effectifs dans l’histoire. Ce déterrement ne ressemble pas à un puzzle à compléter, mais à l’arrivée sur un nouveau continent : la configuration change et il est nécessaire de redessiner les cartes afin qu’il y ait de la place pour tous et pour toutes.
L’adjectif « féministe », dans ce sens, indique une promesse valable également pour les hommes, qui peuvent finalement se libérer d’un malentendu imaginaire viril qui les contraint à renier leur expérience réelle, qui est également émotive, fragile et extraordinairement capable de soin. Ce n’est pas un hasard si la CTI compte également des hommes
Théologie… féministe, des femmes, féminine
Féminisme, féministe : ce sont des termes qui, dans nos contextes, évoquent souvent un imaginaire de revendication. Parce que les féminismes souffrent aussi des mauvaises interprétations. En effet, il ne s’agit pas de se faire restituer quelque chose – on pourrait en discuter – mais d’ouvrir des brèches à travers lesquelles faire passer ce qui a été supprimé, c’est-à-dire pour redécouvrir les expériences féminines que les dispositifs patriarcaux ont tu, marginalisé ou révoqué.
Bien sûr, toutes les théologies des femmes – donc féminines – ne sont pas féministes : toutes les femmes n’ont pas le désir de s’exposer dans ce domaine de la recherche, qui vit de déterrements, de critiques et de créativités rebelles. Pour les théologiennes de la Coordination, en revanche, « féministe » est un adjectif important, même s’il est difficile : ce terme contient des mémoires et des épistémologies précises qu’il est préférable d’expliquer et de sauver des malentendus, que de supprimer par peur d’être mal interprétées.
Théologiser au masculin et au féminin
Les théologies sont-elles sexuées ? Dans la tentative d’apporter une réponse, il faut éviter aussi bien de vider la question en affirmant que les théologies sont neutres, que de la remplir de contenus erronés, peut-être dans la conviction que les femmes viennent de Vénus, la planète de l’amour, et les hommes de Mars, la planète de la guerre. A mon avis, les théologies sont sexuées parce que notre corps laisse toujours des traces dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, mais il faut toujours faire attention à leur singularité et au mélange des différences. Trop souvent, en effet, on tend à mettre sous une unique étiquette les théologies des femmes, comme si elles étaient toutes pareilles et donc superposables les unes aux autres, tandis que l’on fait beaucoup plus attention à enregistrer les différences d’interprétation ou les traits distinctifs dans les systèmes de pensée masculins.
Cela dit, il me semble toutefois possible d’entrevoir également certaines insistances dans les recherches théologiques des femmes, comme si celles-ci suivaient des fils particuliers déterminés de l’expérience. Bien sûr, on ne peut pas généraliser et ce n’est qu’une impression personnelle, mais je pense pouvoir entrevoir qu’un grand nombre de ces théologiennes tendent à être plus attentives à ce qui naît qu’à ce qui meurt, elles se présentent animées par des questions sur la corporéité et sur la physionomie des relations, elles cherchent à fuir les binômes avec lesquels s’est structurée la culture patriarcale, comme par exemple ceux de foi/raison, soin/justice, attachements/concepts, privé/public, intime/politique, sujet/objet, âme/corps…
Il me semble donc que l’on peut percevoir une certaine différence entre les théologies masculines et féminines, mais celle-ci n’est assurément pas définissable ni déterminable à priori, parce qu’elle est mobile, contingente, et en devenir comme les sujets qui l’endurent et qui la symbolisent.
Le devoir des théologiennes aujourd’hui
Dans les moments de crise, on se met souvent à écouter les femmes, comme s’il pouvait venir d’elles une aspiration alternative qui permette d’interrompre les processus d’épuisement de l’histoire. C’est un peu le cas aujourd’hui aussi, par exemple, dans les Eglises engagées dans la recherche d’une synodalité réelle. C’est une occasion de vraie confrontation, qu’il ne faut pas gâcher, mais l’écho des voix féminines ne devrait pas retentir uniquement quand il faut réparer une trame rompue, pour se dissoudre dans le silence quand le pouvoir se recompose. C’est une polyphonie qui est nécessaire, sans crainte des dissonances. On découvre alors, pour reprendre les paroles de Maria Zambrano, que le chant de ce qui est vaincu ne se résigne pas si facilement. Le devoir des théologiennes concerne la transposition en narrations efficaces et fécondes de ce chant qui vient de la marge.
La tâche des théologiennes s’exprime donc de différentes manières et se déverse dans de nombreux ruisseaux de l’histoire, même si elle peut être interceptée là où l’écoute de la douleur du monde marginalisé – féminin mais pas seulement – trouve une alliance avec les possibles dynamismes pascals.
Quel Dieu cherchent les femmes
La philosophe Luisa Murano a écrit un livre qui devrait être constamment relu selon moi, Le Dieu des femmes. J’en reprends l’un des passages les plus cités :
« Un jour s'ouvrit la porte d'une vacance sans fin. Cela arriva pendant que je lisais le livre de Marguerite Porete, Le Miroir des âmes simples, et d'autres textes de ce que l'on nomme mystique féminine. Alors je commençai à entendre les paroles d'une conversation non seulement nouvelle mais inouïe, entre deux êtres que nous appellerons, pour faire bref, une femme et Dieu. Une femme y était certainement, Dieu, je ne sais pas, mais il est certain qu'elle n'était pas seule. Il y avait un autre ou une autre dont la voix n'arrivait pas jusqu'à moi, mais j'entendais tout de même, parce qu'elle faisait une interruption dans ses paroles à elle ou, mieux, un creux qui transformait la lecture, la rendait semblable au geste de quelqu'un qui boit lentement ».
Le travail de coordination se situe au sein de ce domaine de pensée et de vie, même s’il se caractérise par un désir différent : il s’agit de chercher et d’approfondir la liberté évangélique et sa vérité accueillante à travers la Tradition et les traditions chrétiennes, sans les fuir. C’est donc un travail qui se confronte constamment avec les médiations et les narrations de l’histoire ecclésiale qui, certainement blessée dans son attention aux femmes, reste un tissu théologiquement incontournable et encore chargé de promesses.
Quelle Eglise veulent les femmes
Les théologies féministes parlent dans l’Eglise et à l’Eglise. Enracinées dans la promesse de la liberté évangélique, elles mesurent et affrontent l’écart entre la proximité pratiquée par Jésus Christ et l’injustice de liens alourdis par le pouvoir, dont les femmes ont malheureusement une expérience particulière. Au nom de leur baptême, les femmes imaginent et tentent d’engendrer une Eglise qui ne se cache pas dans un langage neutre et faussement universel, qui ne décrit pas Dieu de façon patriarcale, qui ne sacralise pas le masculin au détriment du féminin ; une Eglise qui a le courage d’écouter et de porter à la lumière les histoires plus dures comme celles qui parlent d’abus et de violences, qui se nourrit d’une tradition vivante, qui partage les décisions, qui supporte et soutient la parrhésie de ses membres, qui n’a pas peur d’ouvrir des conflits dans la tentative d’une paix plus profonde, qui n’utilise pas de catégories romantiques pour couvrir le cléricalisme ; une Eglise qui ose tenter des voies nouvelles, qui ne craint pas de perdre le pouvoir, qui ne s’embrouille pas dans des obsessions et de mauvaises formes de communication, qui soit instruite par les bonnes pratiques et qui redécouvre la force également politique du message évangélique.
Ce rêve exige nécessairement un travail théologique sur le pouvoir et sur la forme de la ministérialité. En mai, le CTI a organisé un séminaire sur l’autorité des théologies des femmes, qui donne lieu à des positions, des pensées, des transformations, notamment pratiques. L’événement se situe en amont des débats spécifiques sur les rôles, le leadership, sur l’ordination, sans exclure aucune de ces questions. Je suis toutefois convaincue qu’il est bon de décliner tout cela autour de la devise : plus d’autorité et moins de pouvoir.
C’est à travers cela, je crois, que peut et doit passer une réforme de l’Eglise.
Lucia Vantini
Lucia Vantini dit avoir deux âmes fondues en une seule : celle philosophique et celle théologique, sans solution de continuité. Véronaise, née en 1972, mariée, trois enfants, elle enseigne à Vérone la théologie fondamentale et l’Anthropologie à l’institut supérieur de sciences religieuses San Pietro Martire, d’Anthropologie philosophique et anthropologie théologique au Studium de théologie San Zeno, d’histoire de la philosophie contemporaine à l’université publique, et elle est professeure à l’institut pontifical de théologie Jean-Paul II à Rome. Depuis juin 2021, elle est la troisième présidente, après Marinella Perroni et Cristina Simonelli, de la Coordination des théologiennes italiennes (CTI), créée à Rome en 2003 pour soutenir les femmes engagées dans la recherche théologique et promouvoir les études de genre en théologie. Aujourd’hui, le CTI compte plus de 160 membres hommes et femmes, publie trois collections de livres (« Sui generis », avec les éditions Effatà, « Teologhe e teologie » avec Nerbini, « Exousia » avec San Paolo) et un blog (« Le Royaume des femmes », en collaboration avec la revue « Il Regno »), et est un membre actif des associations théologiques italiennes, le CATI. Le prochain séminaire national CTI se déroulera à Rome le 7 mai 2022 et aura pour thème l’autorité de la théologie des femmes, qui en Italie ont été admises à fréquenter les facultés de théologie en 1965 mais qui depuis, assurent une présence croissante et une voix plurielle et attentive. Nous lui avons demandé une réflexion sur le fait d’être catholique et sur ce qu’a représenté et représente la poussée féministe dans l’Eglise.
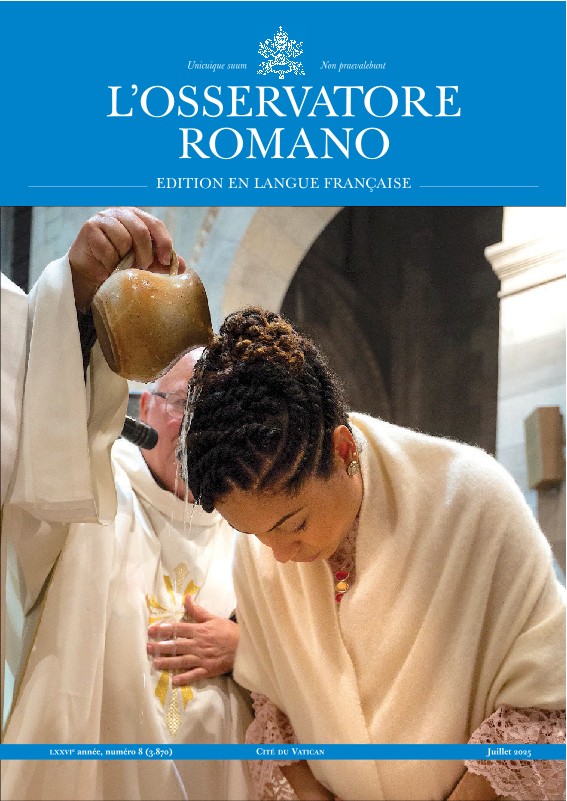



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti