La théologie ?

La première fois que j'ai vu son nom, je ne savais pas que c'était un « nom », un monstre sacré vivant de l'exégèse féministe du XXème siècle. Je cherchais des livres sur l'exégèse biblique et l'histoire de l'église antique, et l'algorithme du catalogue de la « Rete bibliotecaria » m'a suggéré En sa mémoire. Une reconstruction féministe des origines, un livre un peu plus vieux que moi – je suis née en 1994, lui est né en 1983 (mais la traduction italienne est de 1990 aux ed. Claudiana) – hélas introuvable sinon en bibliothèque. L'auteure retrouvait la présence des femmes dans les premières communautés chrétiennes parmi les silences de l'Ecriture et de la tradition. Je l'ai donc réservé et, quelques jours plus tard, j'ai souligné de mon doigt la première phrase de la préface : « Un livre n'est jamais l'œuvre d'un seul auteur, même s'il n'engage que lui. Cela est particulièrement vrai pour un ouvrage de théologie féministe tel que celui-ci ». Je voyais noir sur blanc la théologie collective que j'avais vu pratiquer par certaines théologiennes, l'anti-individualisme que j'avais aimé chez elles, et que j'espère encore savoir reproduire. Il y a une deuxième chose dont je me souviens à propos de ce livre, et c'est un Avertissement dans les pages d'introduction. Il dit, plus ou moins : cher lecteur, chère lectrice, la première partie du livre est difficile, si on entre dans les détails de la méthode critique elle peut être décourageante pour ceux ou celles qui ne sont pas spécialistes du sujet ; si on n’est pas familier avec la théologie, l'auteure elle-même conseille de commencer par les parties II et III. Il s'agit donc d'une œuvre disponible pour des variations, aussi modulable qu'un Lego. C'était la première fois que quelqu'un m'invitait à me demander quel type de lectrice j'étais et, en fonction de la réponse, m'autorisait à mélanger les pièces. Pour les puristes de l'académie, pour qui la rigueur scientifique consiste à faire tout de A à Z sans déviation, ce serait une incitation au désordre. Moi, même si j'étais étudiante en théologie et que j'aurais été capable de lire la première partie, j'ai commencé par le cœur du texte.
En mémoire d’elle
Il est donc bon de raconter l’histoire d’Elisabeth Schüssler Fiorenza à l’envers, et d'avancer obliquement dans sa réflexion pointue de « théologienne catholique qui a su lire les signes des temps », comme la définit Elizabeth Green qui lui a consacré un portrait (ed. Morcelliana). Aujourd'hui âgée de 83 ans, elle occupe depuis trente ans la chaire de Nouveau Testament dans l'une des plus célèbres universités américaines, la Harvard University Divinity School, dans le Massachussetts. Les dates clés de sa carrière se concentrent dans les années 80 : la période des premiers cours universitaires d'« histoire des femmes » et de « théologie féministe », et des premiers rôles publics tenus ou « approchés » par des femmes : Geraldine Ferraro, candidate à la vice-présidence des Etats-Unis, et de l'autre côté de l'océan, en Italie, Nilde Iotti, présidente de l’assemblée nationale. Quelque chose était en train de bouger sur de nombreux fronts et sous de nombreuses latitudes. En 1987, Elizabeth Schüssler Fiorenza a été élue au poste annuel de présidente de la Society of Biblical Literature, une association prestigieuse pour l'étude critique de la Bible, qui, au cours de ses cent sept ans d'histoire, avait connu une direction masculine ininterrompue.
En l'espace de deux ans, de 1983 à 1985, Elizabeth Schüssler Fiorenza atteint une visibilité maximale avec la publication de En mémoire d’elle ; elle entre au comité de direction de la revue internationale de théologie Concilium comme rédactrice de la nouvelle section de théologie féministe ; et elle fonde avec la théologienne juive Judith Plaskow le Journal of Feminist Studies of Religion, aujourd'hui la plus ancienne revue académique féministe interdisciplinaire et interreligieuse en études religieuses. Sa présence, si reconnue et reconnaissable dans un monde universitaire qui était et reste (comme elle le dénonce encore) très majoritairement masculin, contredisait la neutralité présumée de la recherche : une femme faisait comprendre qu'il n'était pas indifférent d'être homme ou femme dans un contexte universitaire, parce que les circonstances socioculturelles rendaient l'objet d'étude disponible de manière différente. De même les universités et les associations académiques étaient – sont ? – empêtrées dans un système patriarcal dans lequel les femmes jouaient – jouent ? – selon des règles établies par d'autres (la terminaison masculine est nécessaire), et hier comme aujourd'hui, le seul antidote à l'étude naïve est de reconnaître son propre conditionnement, sa propre partialité. La provocation sur l’actualité de cette lecture n'est pas vaine. En théologie, il s'agirait de vérifier, par exemple, comment la forme d'une église hiérarchisée – Elisabeth Schüssler Fiorenza dirait kyriarcale, pour souligner les multiples mécanismes de pouvoir qui la tissent – influence la sphère académique. Quel espace les femmes peuvent-elles avoir en tant que spécialistes et disciples du Christ si, comme elle le soutient, l'Eglise s'est progressivement « patriarcalisée », les laissant en marge de son histoire officielle, ou si la masculinité de Jésus finit par coïncider avec l'idolâtrie de la masculinité en tant que telle ?
Bilinguisme et politique
Mais nous étions en 1983. Lorsque son chef-d'œuvre a été publié, Elisabeth Schüssler Fiorenza avait 45 ans et s'était installée aux Etats-Unis quinze ans plus tôt avec son mari, également théologien. Auparavant, elle avait vécu et étudié en Allemagne. C'est peut-être là le fait biographique le plus important pour résumer sa pensée, et le symbole de sa pratique féministe : le bilinguisme. Le bilinguisme est en fait une grande partie de son expérience du monde, non seulement en tant que germanophone naturalisée américaine, mais aussi en tant que théologienne catholique qui, avant Harvard, a eu l'occasion d'enseigner dans une faculté évangélique, et en tant que femme dans un système de type patriarcal.
Toutes les femmes sont comme des bilingues, des « étrangères résidentes », et apprennent une sorte d’« art de la traduction », qui n'est pas leur héritage exclusif, mais un fait commun à toutes les « non-personnes » qui luttent pour trouver une citoyenneté adéquate dans la religion et dans la société, chacune plus ou moins selon son expérience particulière. L'expérience d'une femme blanche est très éloignée de celle d'une femme noire, et ce n'est pas la même chose d'être catholique ou musulmane, ouvrière ou femme riche. L'identité est une imbrication complexe de différents vecteurs de pouvoir : origine sociale, disponibilité financière, nationalité, sexualité, compétences, religion... Elisabeth Schüssler Fiorenza a donc adopté une approche intersectionnelle, c'est-à-dire réceptive aux expériences variées des femmes, les incitant à la même conscience de la partialité qu'elle demandait aux hommes : savoir se situer, chercher « d'interrompre et en même temps de contextualiser les tendances universalisantes de leurs arguments », reconnaître leurs propres privilèges, noter qui est invisible. Il était naturel, avec ces présupposés, d'inscrire la théologie féministe dans la sphère de la théologie de la libération, c'est-à-dire de cette théologie qui prend les marges comme point de départ et la justice sociale comme horizon. Elisabeth Schüssler Fiorenza a souvent rappelé que la recherche académique, qu'elle soit théologique ou non, a toujours des implications politiques, parce que la manière d'étudier, les auteures et les auteurs interrogés, les contenus soulignés ou ignorés, promeuvent inévitablement ou s'opposent à une forme du monde (et de l'Eglise) discriminatoire ou juste. Il y a donc un problème pratique que la théologie devrait se poser : comment éviter de s’enfermer dans l'enceinte académique et religieuse, et comment situer son étude en faveur d’un changement social ?
Il est important, pour la théologie d'aujourd'hui, de s'interroger sur la manière de ne pas prétendre être neutre, et de ne pas sous-estimer les implications politiques de l'étude. Comme ces deux questions sont féministes, elles sont trop facilement disqualifiées dans le halo de suspicion qui entoure encore la théologie du genre, comme si elle voulait en retirer quelque chose. Ce préjugé perpétue la marginalisation des femmes dans le monde universitaire et dans l'Eglise. En revanche, la théologie des femmes, y compris celle d'Elisabeth Schüssler Fiorenza, offre ce qu'elle a développé : sinon des solutions, du moins une méthode de travail non solitaire qui admet les dépendances réciproques de la pensée comme une richesse et non comme une défaite de l'originalité, et qui vise des résultats constructifs plutôt que concluants et autoréférentiels.
Le féminisme, affirme Stella Morra en lisant En mémoire d’elle (son commentaire pour GBPress est à paraître), réside dans « l'inclusion, la tentative de sortir des polarisations » et d'assumer « la complexité de la réalité ». Se poser ensemble les questions de certains/certaines, voilà quelle serait la priorité. Elisabeth Schüssler Fiorenza a posé des questions intéressantes, pour commencer.
Alice Bianchi
Doctorante en théologie fondamentale et « Coordinamento Teologhe Italiane »
ELISABETH SCHÜSSLER FIORENZA est une pionnière dans l'interprétation biblique et dans la théologie féministe. Théologienne, Américaine née dans une petite ville de l'actuelle Roumanie, âgée de 83 ans, elle est diplômée en théologie pastorale et spécialisée dans l'étude du Nouveau Testament. Enseignante à la Harvard Divinity School, elle a été la première femme à être élue présidente de la Society of Biblical Literature. Son livre est considéré comme une pierre miliaire : « En mémoire d’elle – Une reconstruction féministe des origines chrétiennes ». Elle est ici racontée par une jeune théologienne, qui n'était pas encore née lorsque le livre a été publié en 1983.
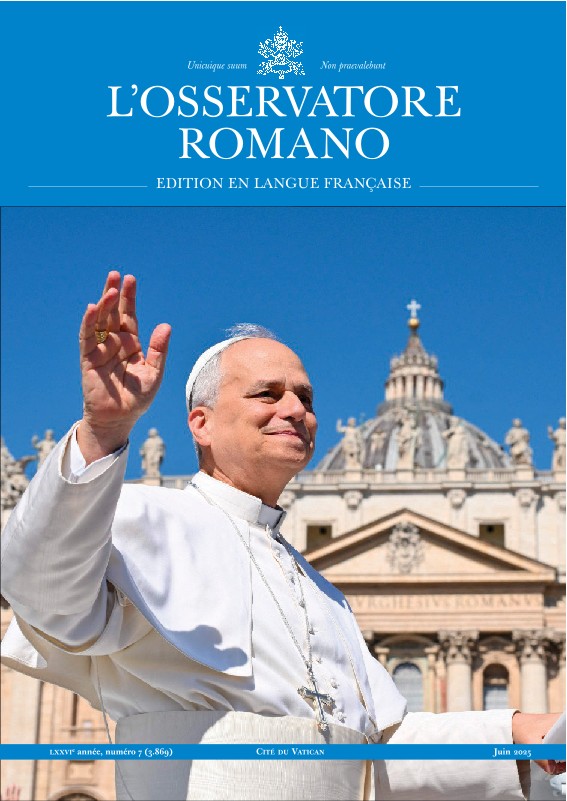



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti