
Il y a cent ans l’épidémie en plein conflit mondial
A Sofia, capitale de la Bulgarie, il existe un petit cimetière militaire qui date de la Première Guerre mondiale. Il renferme les restes de 201 soldats italiens, prisonniers de l'armée austro-hongroise qui avaient été transférés là, loin du front. Lorsque l'épidémie de grippe espagnole est arrivée en 1918, les baraques du camp d'Orlandovtsi, à la périphérie de la ville, se sont transformées en un foyer mortel. Nombre d’entre eux moururent. Parmi eux, trois religieuses italiennes qui avaient été rattachées aux troupes et prêtaient service à l'infirmerie du camp. Il existe encore des pierres tombales qui racontent ce sacrifice et le sauvent de l'oubli.
Il y a un siècle, conflit et pandémie se mêlèrent implacablement. La guerre elle-même contribua à la propagation du virus, avec ces millions de soldats (et de réfugiés) qui voyageaient d'un continent à l'autre, d'un front à l'autre, dans un va-et-vient de personnes et de ravitaillements. Les historiens affirment que le service de santé militaire était parfaitement conscient du danger de la diffusion des maladies infectieuses. Ils craignaient surtout le typhus, le choléra, la variole. Au lieu de cela, arriva une grippe d'une virulence sans précédent : si la guerre provoqua 37 millions de morts, l'épidémie en a tué au moins 50 millions. Et il s'agissait presque exclusivement de jeunes gens âgés de 15 à 40 ans. La majorité des victimes furent des femmes, probablement parce que ce sont elles qui assistaient les malades et ont été infectées en masse. Mais l’histoire de la grippe espagnole est restée en ligne de fond, redécouverte aujourd’hui alors que nous sommes confrontés à une pandémie qui lui ressemble. Entre les deux, s'est écoulé un siècle de découvertes scientifiques, de technologies de plus en plus futuristes, d'avancées médicales. Il y a cent ans, cependant, lorsque s'est matérialisée cette maladie que personne ne réussissait à comprendre et surtout à soigner, on y a fait face comme on pouvait. Et en première ligne se retrouvèrent, hier comme aujourd'hui, les médecins, les infirmier(e)s. Et les sœurs. « Nous devons essayer de nous replacer en 1918 », raconte Eugenia Tognotti, essayiste et professeure d'histoire de la médecine à l'université de Sassari. A la fin du XIXème siècle, la bactériologie avait fait un énorme bond en avant, les noms des « chasseurs de microbes » étaient vénérés, notamment Robert Koch et Louis Pasteur, mais la science n'avait pas encore découvert les virus. Nous tâtonnions donc dans le noir face à cette maladie qui entraînait la toux, de fortes fièvres, des saignements de nez, des difficultés respiratoires, des effets neurologiques et qui, dans de nombreux cas, s'avérait fatale. Comment y remédier ? « N’ayant pas trouvé la cause — répond la professeure Tognotti — et n’étant pas en possession de médicament vraiment efficace, de nombreux traitements furent essayés, mais la seule solution qui fonctionnait étaient les traitements dits non pharmaceutiques, aujourd'hui indiqués par l'acronyme Npi : repos au chaud, alimentation, hydratation, hygiène ». Comme on pensait que la cause pouvait être un bacille niché dans la bouche, on recommandait les gargarismes. Pour combattre la fièvre, l’application de serviettes humides sur le visage et la poitrine. Les religieuses, non seulement celles formées dans les hôpitaux, mais aussi celles qui n'avaient pas de spécialisations, ont joué un rôle fondamental. Les sœurs ministres de la charité de saint Vincent de Paul ont été particulièrement actives dans l'assistance aux malades, qui était une des pierres angulaires de leur congrégation. Il est impossible de donner des chiffres, mais il est certain que les religieuses, par leur présence, freinèrent la diffusion du virus et limitèrent le nombre de décès ». Cela était déjà arrivé, à l’instar des épidémies de choléra qui ont sévi à la fin du XIXème siècle. Sœur Asuncion Riopedre, provinciale de l'Ordre des sœurs hospitalières, une congrégation fondée à Madrid en 1881, sous l'impulsion du saint Benoît Menni, raconte : « A l'origine, nous nous occupions de femmes souffrant de maladies mentales, ignorées de tous. Cependant, quelques années plus tard, se déclara une épidémie de choléra ; les sœurs et les frères furent formés à l'utilisation de l'antidote et, sous la direction du Père Menni, n’hésitèrent pas à s'occuper des familles d'abord à Ciempozuelos, puis dans d'autres localités comme Getafe ou Chinchón ». La diffusion de la grippe espagnole était comme une tempête de vent inarrêtable. Les établissements de santé furent débordés. En Italie, comme dans les autres pays européens en guerre, la concomitance avec le conflit empêcha la mise en place de contre-mesures efficaces. Même parler seulement d'une épidémie était impossible, du moins au début. Imaginons-nous isoler les foyers, imposer des quarantaines, mobiliser les secours. Ce que firent les religieuses est donc une action caritative spontanée dont on trouve des traces éparses dans les mémoires. Des bribes de récits qui révèlent des histoires communes à beaucoup, dans toutes les régions d'Italie, comme celle de sœur Fausta Finco, de l'Ordre des sœurs de la charité de sainte Jeanne Antida Thouret. Dans un vieux livre de l'époque, Opera dell'Ospedale Congregazionale 1915-19, il est rappelé comment « les sœurs de la charité pendant la guerre ont servi comme infirmières dans presque tous les hôpitaux et refuges de Modène et étaient en contact étroit avec les soldats hospitalisés. Sœur Fausta contracta la grippe espagnole et mourut à Modène le 21 février 1919. Elle mourut victime du devoir à cause d'une maladie contractée en service à l'hôpital de Campori, lors de l'épidémie de grippe, après avoir, pendant 14 mois consécutifs, sans un seul jour d'interruption, prodigué des soins sans fin aux soldats qui revenaient du front, soulageant leurs souffrances ».
Aux Etats-Unis, au contraire, où la gestion fut plus rigoureuse et plus organisée, on parla davantage de la contribution des religieuses à la lutte contre l'épidémie. En 1919, la Société historique catholique de Philadelphie, comme l'a récemment rappelé le « New York Times », a publié un livre à la mémoire des sœurs qui s'étaient dépensées courageusement dans cette ville. Titre : Le travail des sœurs pendant l’épidémie de grippe. En 1919, les auteurs écrivaient: « Les forces attachées à l’assistance avaient été réduites par la guerre. Il y avait de graves pénuries dans de nombreux hôpitaux. Mais maintenant, c'était une question de vie ou de mort ».
C'est ainsi que le Conseil de santé de Philadelphie ordonna la fermeture des écoles, des théâtres et même la suspension des services religieux. Mais cela n’était pas suffisant. L'archevêque Dennis Dougherty proposa de loger autant de malades que possible dans les bâtiments de la Curie, et regroupa les forces : prêtres, religieuses, Société de Saint Vincent de Paul. Il demanda à tous de s'occuper des malades. Il demanda en particulier aux religieuses, de sortir de leurs couvents. Bien que n'ayant pas beaucoup d'expérience, deux mille personnes répondirent à l'appel. Blouses blanches et masques de gaze, elles prirent en charge une grande partie de la population, notamment les immigrés d'Italie, d'Ukraine, de Pologne, de Chine, les familles noires, celles de religion juive, les pauvres. Tous ceux qui se trouvaient dans le besoin furent aidés. Les religieuses n'hésitaient pas à entrer dans des appartements sales où les parents gisaient morts dans leur lit et où les enfants pleuraient de désespoir et de faim.
Les religieuses de Philadelphie lavaient le linge, servaient de la soupe chaude, fournissaient de l'eau, de la glace, des couvertures. « On entendait appeler "Ma sœur !" à chaque minute toutes les nuits », raconte l'une d’entre elles. Et une autre : « Au début, j'avais peur. Je n'avais jamais eu de contact direct avec la mort. Mais j'ai réalisé que quelqu'un devait le faire. J'ai pris ma blouse et mon masque et j'ai commencé mon service. Les quarts de travail duraient douze heures. Beaucoup sont tombées malades. Plusieurs sont mortes. L'une d'entre elles a écrit : « A travers cette expérience, j'ai appris à apprécier ma vocation à la vie religieuse comme jamais auparavant ».
Dans le Kentucky, à Louisville, un immense camp militaire avait été installé et portait le nom du douzième président, Zachary Taylor. Il hébergeait cinquante mille soldats revenant du front européen. L'aumônier, le frère Regis Barrett, confronté à la catastrophe d'un soldat malade sur quatre, supplia les sœurs dominicaines du Saint Rosaire de l'aider. Avec des roulements incessants, chacune avait pour tâche d'assister au moins une centaine de soldats contaminés, luttant contre la fièvre, la dysenterie, les vomissements.
Un phénomène similaire se produisit dans le Massachusetts, à Camp Devens : là aussi, les écoles avaient été fermées pour des raisons sanitaires et les sœurs éducatrices se consacrèrent aux soins des malades. Les annales des sœurs dominicaines rapportent des expériences à la Nouvelle-Orléans, à Pittsburgh et à New York. Les sœurs de la miséricorde s’engagèrent dans au moins une centaine d'autres établissements, dont l'hôpital Mary's de San Francisco. Au Canada, on a retrouvé l'éditorial d'un journal local, le « Morrisburg Leader », daté de 1919 : « Personne ne pourra oublier – peut-on lire – le travail magnifique des sœurs qui se prodiguèrent parmi nous. Personne ne connaissait leur nom. Tout ce que l'on sait, c'est que de l'aide avait été demandée et que deux sœurs de la charité arrivèrent dans les meilleurs délais en train de Prescott. Nous pouvons révéler leurs noms : sœur Mary Charles et sœur Mary Ursula ». L’histoire de Morrisburg est une petite histoire emblématique. « L'épidémie de grippe espagnole – commente Eugenia Tognotti – a été l'un des échecs les plus cuisants de la science médicale. La découverte des bactéries avait fait croire qu'il n'y aurait plus de maladie inconnue et qu'il y aurait un remède pour tout. Au contraire, cette grippe, causée par un virus qui ne sera isolé qu'en 1933, a eu raison de l'optimisme avec lequel le vingtième siècle avait commencé. Et cela explique aussi l'oubli qui s'est abattu sur la pandémie, et avec elle le formidable travail des femmes pour assister les malades, y compris les religieuses ».
Francesco Grignetti
journaliste à «La Stampa»
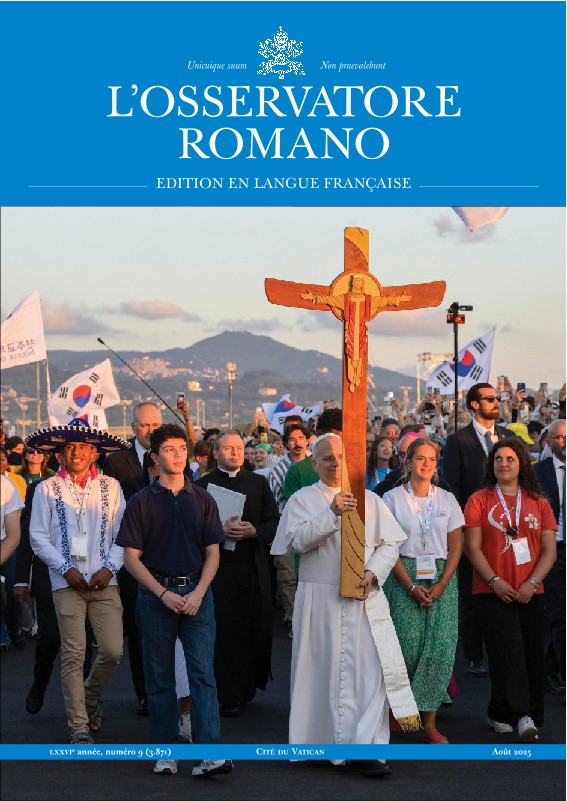



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti