
Ne pas insister dans la douleur, penser aux vivants : c’est ce qu’on nous demande. Mais ne risque-t-on pas de briser le fil avec la seconde vie ?
Elaborer le deuil, revenir à la vie normale. C’est ce qui nous est demandé quand la mort entre dans notre vie. Et on nous invite à nous distraire, à aller de l’avant, à ne pas regarder en arrière ; à penser à ceux qui sont restés. Ceux qui sont partis ne reviennent pas, nous avons le devoir de continuer à vivre et, pour le faire, il n’y a qu’une façon : mettre de côté le passé. La douleur, la mémoire, peuvent bien sûr être acceptées, mais seulement pendant quelques jours. Le deuil – le comportement social qui signe le passage de la mort – est inutile et rétrograde, un ensemble de rites que la modernité repousse. Comme un vêtement démodé, un film en noir et blanc. On ne le dit pas, mais on le pense : une perte de temps. Insister dans la douleur est une folie.
Il m’arrive toujours plus souvent, au cours de ces années où, pour des raisons d’âge, les morts traversent plus souvent ma vie, quand j’assiste à des cérémonies funéraires publiques et privées célébrées de façon hâtive, de penser aux rites de mon enfance.
Ce sont des souvenirs précis, parmi les plus précis d’un temps désormais lointain.
Les femmes qui lavaient et habillaient les morts. L’odeur de fleurs, de cierges et de vinaigre qui se mélangeait. Je ne sais pas encore pourquoi on lavait les morts avec du vinaigre.
Le lit qui les accueillait pour la dernière fois avec les plus beaux draps. Les longues veillées aux côtés du défunt. Le souci de ne pas les laisser seuls.
Puis les funérailles avec les orphelines et les religieuses au premier rang, les femmes vêtues de noir, les hommes portant le bandeau noir autour du bras. Pour les riches, l’orchestre. La cérémonie à l’Eglise, les paroles du prêtre, uniquement du prêtre, la musique, la douleur qui se fondait avec la prière.
Et le début du deuil avec des rites et des temps précis. Un an, voire deux, des vêtements noirs pour la famille la plus proche ; puis le demi-deuil, quand une touche de blanc était permise. Les distractions éliminées, les festivités abolies, les visites réduites aux intimes.
Qui mourait restait présent, on parlait de lui ou d’elle et lui et elle continuaient de nous parler, ils remplissaient les conversations, peuplaient les rêves. Leur portrait avec un cierge et des fleurs était placé dans une partie centrale de la maison. Je me souviens de deux voisines qui, en rentrant à la maison, saluaient et lançaient des saluts dans les pièces vides.
« Il n’y a personne », dis-je un jour alors que je n’avais pas plus de cinq ans. « Il y a les âmes des morts », me répondit-on.
Les âmes : elles continuaient de rester aux côtés de leurs proches, parfois, on leur demandait des conseils, on leur adressait des prières et on espérait qu’elles exaucent nos vœux. Dans un autre royaume, elles avaient de plus grands pouvoirs et continuaient à veiller. Le dialogue pouvait continuer, la mort ne l’interrompait pas, la vie n’empêchait pas le souvenir, mais au contraire, le comprenait et l’alimentait. Les âmes des défunts pouvaient faire peur, parce qu’elles étaient sévères et contrôlaient les vivants, mais ensemble, elles protégeaient, garantissaient un contact avec un monde dans lequel nous serions tous allés un jour.
Ma grand-mère rendait visite à mon grand-père au cimetière deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche. Je l’accompagnais souvent, même si je n’avais jamais connu mon grand-père ; auparavant, nous nous arrêtions pour acheter des fleurs et, une fois arrivées à la petite chapelle familiale, elle nettoyait tout et les arrangeait, et moi j’étais chargée d’aller prendre de l’eau. Puis, quand tout était propre, ma grand-mère parlait avec mon grand-père, elle lui racontait les dernières nouvelles de la famille, puis elle le saluait et nous repartions. Et ce deux fois par semaine tant qu’elle a pu le faire. Quant à moi, être choisie pour l’accompagner était un privilège.
A présent, je comprends pourquoi. Je participais au rite du deuil et cela me faisait entrer dans le monde des adultes. Dans le monde des femmes qui avaient assisté, veillé, puis protégé la mémoire et la vie après la mort de leurs proches.
Parce que – mais je n’y ai réfléchi qu’après – les protagonistes du rite de la fin de la vie étaient toutes des femmes. Il y avait des hommes – le prêtre, les croque-morts, le bandeau noir lors des funérailles – mais ils disparaissaient rapidement, absorbés par leurs affaires, par le travail, par le monde qui ne s’arrêtait pas. La douleur n’était pas une affaire d’hommes. C’est aux femmes que revenait le devoir de ne pas oublier, de relier le présent avec le passé, de ne pas priver l’avenir de ce qui avait été. Elles avaient à nouveau le devoir de donner la vie, une deuxième vie, celle du souvenir et de la mémoire, de l’amour qui ne finit pas avec la mort, qui trouve de nouvelles formes pour rester et continuer d’exister.
Je n’ai pas la nostalgie de cette époque, je ne pense pas que c’était bien ainsi, je n’arrive pas à ne pas voir, notamment dans la division des temps et dans la gestion de la mort, la séparation néfaste entre les rôles qui a tant marqué la condition féminine et je n’arrive pas à sanctifier les devoirs des femmes toujours consacrées au soin, même à celui des morts.
Mais je vois avec lucidité ce qui a eu lieu depuis que les rites des morts ont été abolis, le deuil a été considéré comme inutile et le soin des défunts est délégué à des « spécialistes » ; depuis que l’on meurt généralement à l’hôpital, la douleur, la maladie et le soin sont gérés par l’extérieur et les femmes, comme les hommes, ne sont que spectateurs d’un événement inévitable.
Il est arrivé que le culte de la mémoire, la proximité avec les défunts, le dialogue qui continue même quand le souffle s’est arrêté, ont été réduits ou abolis. D’inutiles digressions sentimentales qui enlèvent du temps à la vie de qui est resté. C’est ce qu’exige de nous la culture de nos pays progressistes et développés, qui vit un paradoxe et une contradiction. Tandis que le discours public invite à rappeler et l’étude de l’histoire, le refus de l’oubli sont un devoir civique, célébré par les institutions et enseigné dans les écoles, la mort des personnes doit être effacée et mise de côté.
Depuis que s’est dissocié le lien entre la femme et la mort – le soin de la mort – s’est brisé également le fil avec la deuxième vie, celle du souvenir et de la mémoire, et s’est éloignée comme inutile la période de deuil.
Mais l’éloignement soudain de nos défunts est-t-il vraiment positif, fait-il du bien à ceux qui restent ? Et ceux qui veulent continuer de souffrir pour ne pas abandonner le souvenir sont-ils vraiment fous ? Est-il vraiment préférable d’oublier plutôt que de souffrir ? Est-ce cela que nous devons enseigner à nos enfants ? Est-ce vers cela que nous devons nous orienter en imaginant l’avenir ? Ou bien – femmes et hommes – devons-nous reconstruire une culture du deuil, de l’acceptation de l’inévitable, de la douleur et du mystère de la mort comme occasion pour nous retrouver nous-mêmes et pour nous retrouver parmi nous ? Pour donner une deuxième vie à ceux qui ne sont plus là et pour espérer la recevoir en don à notre tour ? « Seul qui ne laisse un legs d’affection, songe à l’urne sans joie », disait le poète. Et il avait raison.
Ritanna Armeni
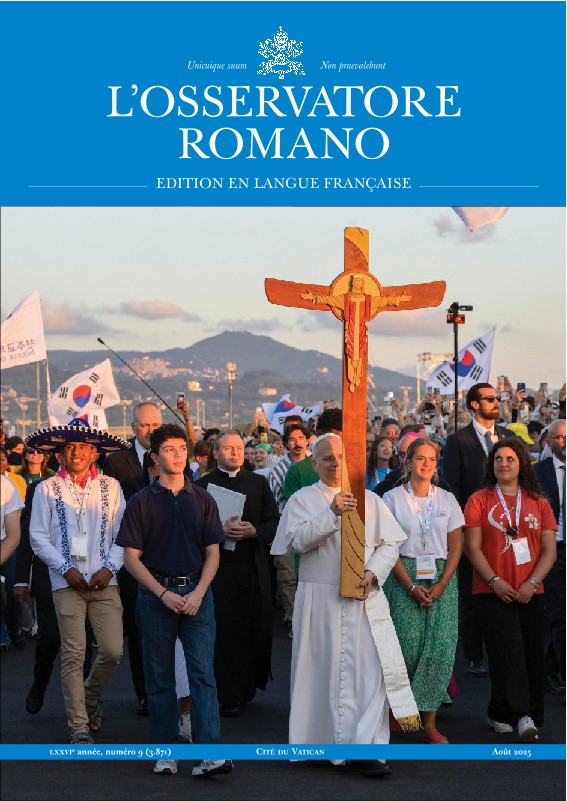



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti