
Genèse, les chapitres 2 et 3 racontés par une écrivaine
Le récit des origines possède la richesse des occasions de réflexion et d’imagination qu’ont les mythes. Au cours de ces années, toujours plus fréquemment, des théologiennes et des biblistes sont allées à la source, pour voir ce que le récit n’a jamais cessé de nous raconter sous les stratifications et les incrustations. Dans cette lignée, à travers les moyens propres à la littérature, j’ai essayé de raconter les chapitres 2 et 3 de la Genèse en donnant la parole à Eve.
J’étais tellement nouvelle ici. Et lui aussi était aussi nouveau que moi, ou tout au moins c’est ainsi qu’il se sentait : ce n’est pas comme s’il m’avait fait les honneurs de la maison, là bas, dans le jardin de l’Eden. Nous étions faits de terre modelée par le souffle, nous venions là comme des nouveaux-nés, nous étions des créatures. Tout était déjà vie, quatre fleuves entouraient et irriguaient l’Eden, il y avait Pichôn, qui contournait le pays de Havila, où l’on trouve de l’or, de l’ambre parfumée et la pierre d’onyx. Il y avait Guihôn, qui parcourt toute l’Ethiopie, et il y avait le Tigre et l’Euphrate. Connaissais-je ces noms, ou les ai-je connus plus tard ? Je ne me souviens pas qu’il m’ait dit : bienvenue, tu es née de moi dans mon sommeil, comme d’une mère endormie pour une césarienne. Nous ignorions tout des mères, des pères, des fils, des filles. Bienvenue, je te montre l’eau qui humidifie la terre, le jardin : ceux-là, les oiseaux du ciel, ceux-là, les animaux de la terre, et les poissons aux écailles brillantes qui nagent ; je ne me souviens pas qu’il me les ait énumérés un par un en les nommant, il n’a pas dit lièvre, ou lion, il n’a pas dit loup ou serpent.
Lorsque je me suis retrouvée si nouvelle devant lui, mon compagnon a chanté, il ne chantait pas pour moi, il chantait exalté par moi, il chantait parce que j’existais. Il chantait que j’avais été tirée de lui et, oui, il a prononcé un nom, un nom qui nous unissait. Mais nous n’étions pas unis, il y avait un espace entre nous. L’espace entre nous, il ne l’a pas nommé. Mais l’espace était bien là. Cet espace était une fête, c’était le lieu dans lequel nous jouions, nous nous lancions des cailloux qui dessinaient des paraboles et qui finissaient dans ma main, dans la sienne, nos mains se serraient et se quittaient, l’espace était très beau, mais c’était aussi une douleur, une question. Et lui, tout comme moi, le percevait.
Entre-temps la vie m’entraînait, je regardais, je touchais les arbres et les fruits, je caressais le poil des bêtes, je buvais l’eau dans le creux de mes mains, j’en sentais la fraîcheur sur la plante des pieds. J’aimais courir, sauter, sentir la chaleur se répandre dans mon corps après l’effort, j’aimais aussi la fraîcheur, la brise qui me caressait en séchant la sueur. Parfois, je surprenais mon compagnon me regardant, mais je n’attachais pas toujours d’importance à son regard. Je le saluais, je lui souriais. Mon corps et le jardin me semblaient une rencontre parfaite, de joie : avec quel plaisir je l’ai prononcé ce mot, joie, ô que j’aimais les noms. Sans doute connaissais-je déjà ces noms, ils me venaient, joyeux, à l’esprit dès que j’en avais besoin parce que je les avais inventés, nous les avions criés quand lui et moi n’étions qu’un, quand je n’avais pas encore été façonnée de sa côte, de sa partie entièrement terrestre. Ainsi, je savais comment appeler le pinson, le loup, la tortue, la chenille, mais aussi l’arbuste, et l’herbe. Parfois je m’amusais avec eux, j’inventais des adjectifs, un langage enfantin agréable – me semblait-il – au jardin nouveau-né. Et puis, bien sûr, parfois, nous étions ensemble, lui et moi, et je l’aidais. Si une plante de mauve était si loin du fleuve qu’elle ne pouvait pousser par manque d’eau, nous nous indiquions l’un l’autre des façons de creuser un sillon, un mince filet d’eau qui lui apporterait de quoi se revigorer. Travailler était une joie et une découverte, et ne nous pesait pas.
Ce n’est que parfois, quand l’ombre descendait, que les arbres ne brillaient plus et que l’obscurité s’épaississait, d’abord douce et agréable, puis plus étrange, qu’il m’arrivait de trembler. Mais le Créateur était toujours dans mon esprit et dans mon cœur. Je savais que nous n’étions pas seuls, je savais que toute la joie, la vie, nos corps, nos êtres tout entiers étaient un don de Celui qui allait et venait dans le jardin. Mais ce n’est que lorsque les ombres descendaient que je sentais la question grandir dans mon cœur. Combien d’espace il y avait entre nous et le Créateur. Parfois, cela semblait un espace intolérable, un éloignement. Alors, je cherchais mon compagnon et ensemble, nous élevions des paroles de question et d’amour au Créateur, nous lui demandions de venir avec nous dans le jardin et il descendait. C’était l’enfance heureuse du monde. Nous sentions l’espace s’épaissir, devenir plus petit entre nous et Lui. Je ne peux pas oublier l’espace qui se resserrait à cause des mots que nous lancions, à cause de sa proximité. Alors nos yeux étaient reconnaissants et le mouvement interrogateur de mon cou et de celui de mon compagnon ne contenait aucune anxiété, uniquement de l’émerveillement. Et nous dansions l’un devant l’autre parce que Dieu était là, dans le jardin, avec les oiseaux nocturnes, leur tu-hu, le chant entêtant des grillons, le clapotis. Qu’est-ce qui pouvait nous troubler ? Nous célébrions alors la séparation qui permettait le chant, la danse, l’élan la dévotion, la présence, la question.
Ce n’est pas de nuit que m’a parlé le serpent. Cela a été en plein milieu d’une journée parfumée et humide de chaleur. L’air était comme de l’eau. A cette époque, tous ces animaux parlaient, et nous les comprenions facilement. Le serpent, nu et rusé, vint à moi. Mais cela me semblait normal, les habitants du jardin aimaient les caresses, appréciaient ne serait-ce que la proximité avec nous. Ainsi, je pensais que lui aussi était comme les autres, qu’il venait pour cela. Je posai ma main sur sa tête, le serpent était froid, malgré la chaleur de l’air. Alors, il me dit cette phrase : Dieu vous a interdit de manger les fruits des arbres. Je m’indignais. Bien sûr que nous pouvions en manger, de tous ces arbres, nous pouvions manger chaque fruit, nous pouvions en manger de tous, sauf d’un. Nous ne devions pas en manger et ni même le toucher, lui dis-je, ainsi, croyant mieux défendre le Créateur qui n’en avait pas besoin. Je savais très bien depuis toujours ce que le Créateur nous avait expliqué. A présent, beaucoup de temps s’est écoulé. Les souvenirs s’embrument. Etait-ce mon compagnon qui me l’avait dit ? Ou est-ce que je le savais auparavant, depuis que j’étais unie à lui sous une autre forme ? En tout cas, je le savais, pas comme une interdiction, ou tout au moins, je ne le considérais pas comme une interdiction, mais comme un fait : comme quand ta mère te dit : ne vas pas dans la mer là où tu n’as pas pied, ne saute pas dans le vide, ne mange pas de poison. Ainsi, je savais qu’il y avait cet arbre au centre du jardin, l’arbre de la connaissance du bien et du mal qui était à côté de l’arbre de la vie, et qu’il ne fallait pas manger du fruit de cet arbre, mais je n’y avais pas vraiment réfléchi, jusqu’à ce que le serpent me dise que non, je ne serais pas morte, mais que j’aurais eu la connaissance de tout. J’écarquillais les yeux, mes pupilles se dilatèrent. Ce serpent me connaissait. Il avait dû m’épier dans le jardin, tandis que je courrais et que je grimpais, il devait avoir saisi le mouvement du cou, l’interrogation évidente quand, les yeux écartés, je restais un moment seule, suspendue. Vous connaissez ces moments qui changent le cours d’une vie, auxquels vous revenez toujours avec effroi en pensant : il aurait été si naturel de l’éviter, si davantage naturel. Pour moi c’est cela. Aujourd’hui encore, j’y retourne, mais je ne divague plus en imaginant réagir de façon différente : mon corps se détacher du serpent, mon visage le dédaigner, changeant le cours de tout. Aujourd’hui, je voudrais seulement pendre dans les bras la créature que j’étais, la serrer délicatement : quelle merveille j’étais. Oh, que le serpent me connaissait. Il ne m’a pas proposé de châteaux, d’animaux volants, de tapis, il ne m’a pas proposé de dominer le monde, il ne m’a pas non plus proposé la paix, l’union, il savait que j’aimais tout, toute la vie, toute la joie, y compris l’espace et la douleur de la séparation entre nous et le Créateur, y compris la brûlure : j’avais déjà dit oui. Je voulais seulement savoir pourquoi. J’avais seulement besoin de savoir, et en lui aussi, mon compagnon, j’avais vu parfois cette question entre deux courses, à l’instant du silence ou du vol. Et j’ai pensé : est-ce ici, à portée de main ? Ainsi j’avais touché ce fruit et je l’avais cueilli et j’en avais mangé, en gardant au fonds de ma conscience la trahison de la voix de Dieu. Il était bon, et je ne suis pas morte. Pas tout de suite. Je l’ai donné à mon compagnon. Il en a mangé lui aussi (lui aussi demandait). Puis il est arrivé ce que vous savez, si auparavant, nous étions protégés par quelque chose de doux, un amnios raréfié, l’air dense du jardin d’Eden, tout à coup, nous nous sommes reconnus sans défense, séparés de tout, et si exposés. Le serpent m’avait trompé, la question demeurait en suspens, l’espace abyssal et en plus, il y avait une peur nouvelle. Mais Dieu nous a cherchés et nous a parlé. Alors, mon compagnon a dit que c’était moi qui lui avais tendu le fruit, et moi je lui ai dit que le serpent m’avait trompée et que, c’est vrai, j’avais mangé. Nous avons connu la douleur, l’accusation, la rancœur. Ainsi commençait l’histoire de notre labeur. Puis, Il nous a vêtus, et ce n’est que là que j’ai ressenti l’urgence de pleurer, parce que dans la douleur, il y avait le réconfort de savoir qu’il était encore prêt à se préoccuper, à prendre soin. Mon compagnon m’a appelée par ce nom que je porte encore, Eve, votre mère. Et nous sommes partis, à présent, j’avais besoin de mon compagnon, comme j’étais fragile, c’était un besoin nouveau, à présent je voulais au moins guérir la fracture qui me séparait de mon compagnon, la fracture de la création et, niant l’espace entre nous, j’inclinais la tête face à la domination. Notre soif de tout nous poussait, la fatigue et les grossesses, la douleur, et la beauté qui toutefois ne semblait pas finir. Vous qui, dans le temps m’avez appelée la porte du mal, je voudrais l’espace d’un instant vous conduire là-bas, dans le jardin, et vous montrer la créature que j’étais.
Carola Susani
----
J’ai été guidée par certains livres, et dernièrement l’ouvrage collectif «Non sono la costola di nessuno – letture sul peccato di Eva, par Paola Cavallari (Gabrielli 2020). Je dois beaucoup à la conversation avec la bibliste Marinella Perroni (c.s. ).
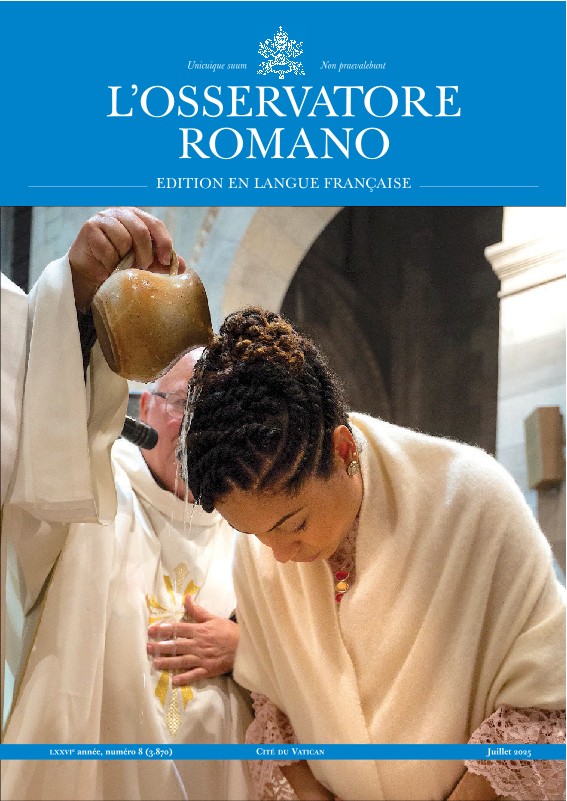



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti