
Femmes et Inquisition: une relecture en dehors de la légende noire
« La sorcière ! La sorcière ! A mort ! Au bûcher ! Préparez le feu ! Allumez la cheminée !
« La sorcière ! ». C’est ce qu’hurlaient des rues, des maisons et des balcons, les habitants de Zardino, dans le beau roman de Sebastiano Vassalli La chimère, en voyant arriver la charrette transportant la jeune femme qui sera brûlée au bûcher. Un jour comme tant d’autres, au dix-septième siècle, et Antonia est une jeune femme comme tant d’autres, dont la seule faute est d’être belle, intelligente et de montrer, dans sa vie pourtant simple, des signes d’un anticonformisme non accepté. Il n’en faut pas plus pour le prêtre et les habitants du pays pour la définir de sorcière et la faire brûler sur le feu.
Combien d’Antonia y a-t-il eu dans l’histoire ? Combien de femmes ont-elles été définies de sorcières et ont subi une mort atroce ? On en trouve de très nombreuses dans la littérature. Des histoires dramatiques et bouleversantes qui sont racontées par Vassalli, Manzoni, Eco, Sciascia (les premières qui viennent à l’esprit de l’auteure de ces lignes).
Il y en a eu de nombreuses aussi au cinéma. Vous souvenez-vous de la sorcière du merveilleux Dies Irae de Theodor Dreyer ? Les sorcières font partie de l’imaginaire, de l’histoire, et reviennent souvent également dans les faits divers. Récemment, le diocèse d’Eichstatt en Bavière a demandé pardon pour la chasse à des femmes innocentes qui avait eu lieu en Allemagne entre le quinzième et le dix-huitième siècle. Accusées de conspiration avec le Diable, 25.000 personnes, en majorité des femmes, avaient été frappées. « Une blessure sanglante dans l’histoire de notre Eglise », a dit l’évêque, Gregor Maria Hanke.
Les plus récentes études du Vatican rapportent aujourd’hui toutefois d’autres chiffres et d’autres jugements. La Commission historique théologique instituée pour le jubilé, dont les résultats ont été rendus publics en 2004, a démystifié chiffres à la clé la « légende noire » qui avait entouré pendant des siècles l’Inquisition, le tribunal ecclésiastique voulu par Paul III. Seulement quatre ans auparavant, à l’occasion du jubilé, Jean-Paul II avait demandé solennellement pardon pour les péchés commis par l’Eglise mais les experts, qui entre temps étaient au travail, ont fait savoir que les données sur les actions de l’Inquisition n’étaient pas celles que l’on croyait, que la chasse aux sorcières ne correspondait pas aux chiffres qui avaient été publiés pendant des siècles. Il est vrai qu’au cours de ces années, il y eu des dizaines de milliers de procès, mais 1,8 pour cent uniquement se conclut par le bûcher, et les recours à la torture ne furent pas si fréquents. Un exemple : sur 125.000 procès de l’Inquisition espagnole, 59 uniquement débouchèrent sur la condamnation au bûcher. L’Inquisition portugaise a brûlé 4 personnes et celle italienne 36.
Dans l’ensemble, le nombre de bûchers n’ont pas dépassé la centaine.
Ce ne furent donc pas – comme on l’a cru pendant des siècles – les magiciennes, les fournisseuses de potions magiques, les adoratrices de Satan, les protagonistes de sabbats ou, comme c’est probable, les femmes expertes d’herbes et de médicaments qui exerçaient la médecine populaire, et les sages-femmes, qui furent l’objet des craintes de l’Eglise. Ce ne sont pas de ces femmes-là qu’a eu peur l’Eglise entre le seizième et le dix-huitième siècle.
Et alors ?
La lutte aux sorcières, les bûchers, la violence contre des femmes innocentes – qui a eu lieu et qui a certainement été sanglante – a bien eu lieu, mais surtout au Moyen-Age et non pas dans les siècles suivants, ceux de l’Inquisition, qui ont été l’objet d’une étude de la commission vaticane. Et il y a peu de documentation sur le Moyen-Age. Ou peut-être les données n’ont-elles pas été suffisamment étudiées. Quoi qu’il en soit, elles sont moins claires que celles des siècles qui suivirent et qui révèlent d’autres peurs, d’autres luttes, d’autres discriminations.
C’est ainsi qu’au moment où un rideau s’est abaissé, racontant une vérité différente sur l’Inquisition, un autre rideau s’est levé, dévoilant une scène encore plus surprenante et racontant une histoire encore plus tragique et plus intéressante. Alejandro Cifres, directeur des archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui, en juin 2014, a organisé une journée d’étude sur l’Inquisition et les femmes, décrit à travers des paroles claires le nouveau scénario. « A l’époque moderne, c’est-à-dire au seizième au dix-huitième siècle – dit-il – les sorcières, les bûchers ont été des épisodes isolés et périphériques. Les préoccupations de l’Eglise étaient alors toutes autres ». Et toutes autres furent les femmes dont l’Eglise eut peur et qu’elle réprima. L’Inquisition était un organe « rationaliste, prudent, modéré ». Bien loin donc, de l’image qui en a été donnée au cours des siècles, et elle ne se préoccupait pas de quelques figures marginales de femmes mais « de la réforme protestante qui se répandait en Europe et conquérait de grands pays ». Elle était donc surtout engagée dans la lutte contre l’hérésie. Et elle était attentive et préoccupée à limiter le phénomène de la sainteté maniérée, des mystiques, du pouvoir des monastères, de la liberté d’expression amplement exercée par les femmes qui confinait avec l’hérésie et pouvait empiéter sur l’hérésie. Le tribunal ecclésiastique s’engagea donc non pas contre des femmes du peuple expertes d’herbes ou ayant mauvais caractère, mais « contre le charisme féminin qui influençait fortement la société, l’église et la politique ».
Le génie féminin – reconnu quelques siècles plus tard par Jean-Paul II – se développait au cours de ces siècles de façon imprévue, l’Inquisition était méfiante, enquêta, condamna et, surtout, le soumit à un contrôle rigoureux.
« Je n’utiliserais par le terme "peur" – affirme Alejandro Cifres – mais plutôt "domination". L’Eglise, au cours de ces années, pensait tout contrôler, elle avait une confiance excessive en elle et se méfiait de ceux qui avaient du pouvoir. Les femmes avaient le pouvoir, les couvents l’exerçaient, les religieuses étaient nombreuses et étaient protagonistes. C’est pour cela qu’il fallait les freiner ».
La peur des femmes – ou la domination de l’Eglise à leur égard – fut ample et sérieuse au début de l’ère moderne. La scène de ces siècles est peuplée de protagonistes peu connues que l’on commence à découvrir et à étudier depuis quelques années seulement. Le tribunal ecclésiastique accusa surtout « les fausses saintes, les femmes porteuses de prophéties et de nouvelles valeurs – confirme Gabriella Zarri, historienne, auteure de la recherche Les saintes vivantes – des femmes qui jouissaient d’un prestige religieux et politique, jugées capables d’événements miraculeux et bénéficiant d’un grand suivi populaire ». Nous les retrouvons, racontées avec soin et attention, dans le texte Femmes et Inquisition, l’ouvrage rédigé par Marina Caffiero et Alessia Lirosi. Et elles sont si nombreuses, elles ont une mentalité si flexible et élastique, allant jusqu’à la transgression ouverte et répétée que, écrit Marina Caffiero, « les archives de la répression sont aussi celles qui témoignent de la liberté. La force plus que la faiblesse des femmes ».
On se perd dans les centaines d’histoires, de biographies, de narrations. Mais le cadre général se délimite avec suffisamment de clarté. Qui sont donc les êtres féminins que l’Inquisition veut contrôler et réprimer ? Au seizième siècle, les saintes vivantes ou les « bienheureuses du prince » ou les saintes de cour qui, dans l’Italie du centre et du nord, confèrent à travers leur charisme un prestige aux régnants. Elles interviennent ensuite avec force dans le domaine politique et déterminent les décisions du pouvoir.
La contre-réforme les emporte, le modèle des hiérarchies ecclésiastiques n’admet pas de charismes ni de prophéties, elles les associent à la faiblesse naturelle des femmes, les regardent avec méfiance et, surtout, les contrôlent dans les cloîtres où la religiosité féminine et sa transgression est soumise aux règles rigides exercées par les confesseurs. Qui veulent tout contrôler mais qui n’y arrivent pas. Ils ne réussissent pas, par exemple, à surveiller l’écriture dans laquelle – raconte Marina Caffiero – demeure forte l’aspiration au prestige et au pouvoir ainsi qu’un modèle de sainteté entièrement féminin qui, au dix-septième siècle également, réussit à trouver la voie pour s’imposer. « L’Esprit prophétique dépasse les murs du couvent », explique l’historienne et les visionnaires et les prophétesses continuent de s’affirmer « comme figures de la vénération locale, du pèlerinage populaire, de dévotion également de la part de religieux ». Elles gagnent dont une fois de plus de l’autorité et du pouvoir. Encore des histoires méconnues et fascinantes, de nobles et filles du peuple, qui proposent leur idée de sainteté, qui affirment des dons prophétiques et des pouvoirs charismatiques.
Que l’Eglise les craigne et veuille quoi qu’il en soit les contrôler et les réduire au silence. Qu’au moment où l’hérésie de Luther se répand, elles puissent être considérées comme dangereuses pour la hiérarchie et usurpatrices du sacré masculin est plus qu’évident. Ce qui est moins évident est la résistance qui continue dans les siècles, l’opiniâtreté avec laquelle la transgression d’une religiosité et d’un charisme féminin se repropose. « A la fin du dix-septième siècle, le prophétisme – affirme encore Marina Caffiero – est la voie obligée de l’expression religieuse des femmes, étant donné l’exclusion du sacerdoce et de la parole publique et officielle ».
Il résiste également au siècle des lumières, au rationalisme du dix-huitième siècle qui met en scène, dans le théâtre où, depuis des siècles se déroule la lutte entre charisme et hiérarchie, de nouvelles protagonistes. Ce sont les convulsionnaires, les femmes qui, à travers le langage du corps, une fois de plus, veulent influencer les choix et prétendent orienter la vie et les valeurs. Ce sont elles qui cherchent à freiner le retard de l’Eglise face à la modernité. Mais ce n’est pas pour autant que le soupçon s’atténue à leur égard. Même attaquée par une modernité qui veut la marginaliser, l’Eglise continue d’avoir peur des femmes. Qui au dix-huitième siècle, puis également au dix-neuvième, continuent de rester des « sorcières », c’est-à-dire des femmes subversives réelles ou potentielles d’un ordre qui ne les prend pas en considération. Et qui, même si elles ne sont pas conduites au bûcher, sont tenues à l’écart.
Précisément à la lumière de l’histoire et des histoires, il n’est pas incongru de se demander : combien de cette peur reste encore aujourd’hui ? Dans quelle mesure détermine-t-elle encore les comportements et les décisions ?
Ritanna Armeni
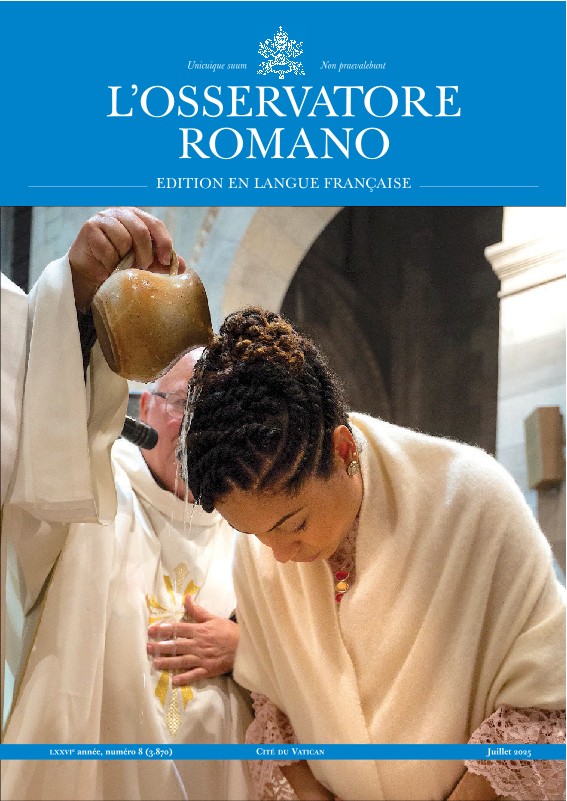



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti