
Coordinatrice pour l’Avsi dans un pays martyrisé par le djihad et les ouragans. «Ma fille est née ici»
Il y a des lieux, le Mozambique est l'un d'entre eux, où les urgences sont la norme. Et pas au rythme d'une à la fois. Mais beaucoup, toutes ensemble. Cet immense pays de l'Afrique du sud-est, 800 mille kilomètres de superficie pour presque 30 millions de personnes, fait actuellement les comptes avec la faim et la pauvreté, l’assaut des djidahistes au nord (depuis octobre 2017, le terrorisme a causé entre 350 et 700 morts et 150 mille personnes déplacées), les effets dévastateurs des cyclones et, naturellement, le Covid-19.
C'est dans ce contexte que vit et travaille Martina Zavagli, 36 ans, mère depuis cinq mois. Sa petite fille est née ici, au Mozambique, où elle est arrivée au début d'avril 2017, provenant de sa ville natale d'Imola. «En réalité, je suis en Afrique depuis 2011, presque trois ans au Soudan et deux au Rwanda», raconte-t-elle. Ella a choisi de partir «poussée par la curiosité de connaître des mondes différents. J'ai effectué mon service civil à l'étranger, au Rwanda, là-bas j'ai connu le monde de la coopération, j'ai vu ce que signifie mettre à disposition ses propres compétences pour des contextes difficiles».
Elle vit à Maputo, capitale du Mozambique et coordonne les projets d'Avsi, qui sont 15 et concernent les provinces de Maputo, Cabo Delgado et Zambezia. Les problèmes à affronter sont énormes. Tout d'abord l'immensité du pays. Ensuite, la condition de vie de la plus grande majorité des personnes: presque la moitié, 46,7% de la population, vit au-dessous du seuil de pauvreté. Une personne sur deux vit avec moins de 0,50 dollars par jour. Un peuple de pauvres. Et de pauvres jeunes. 60% de la population a moins de 24 ans. Comme si cela ne suffisait pas, un enfant sur quatre est victime du travail des mineurs.
Avsi est présent dans le pays depuis 2010. «Nous sommes engagés — raconte Martina — dans trois secteurs: éducation, environnement, agriculture. En ce qui concerne les premiers, nous suivons tout le parcours d'instruction de l'enfant, de la maternelle à l'école primaire, secondaire, jusqu'à l'université». Un travail qui part des murs pour arriver aux livres: «Nous restructurons les écoles, nous donnons de leçons aux enseignants et nous fournissons du matériel scolaire. Nous suivons plus de 20 mille enfants, car nous travaillons dans diverses régions et avec plusieurs écoles». Le premier «problème» à affronter est le nombre énorme d'enfants. «Chaque école — explique-t-elle — est surpeuplée». L'école élémentaire, pour faire un exemple, a des classes formées d'une cinquantaine d'élèves. «Et chaque structure a environ 2-3 mille étudiants». Un problème qui devient gigantesque dans les périphéries, dans les bidonvilles où Avsi travaille. «Les structures ne sont pas suffisantes pour les accueillir tous», explique Martina. Au point que pour garantir la possibilité de fréquenter les leçons, on fait des tours: «On commence avec les premièes classes, ensuite pendant la deuxième partie de la matinée il y a les enfants plus grands. Car il n'y a pas la capacité d'accueillir tout le monde». D'où le travail qu'ils accomplissent: «Nous cherchons à construire de nouvelles écoles et à restructurer celles qui existent pour les rendre en mesure d'accueillir plus de classes».
L’autre secteur d'intervention est l'environnement et l'énergie. «Dans les bidonvilles nous proposons la vente de plaques de cuisson améliorées». C'est-à-dire des plaques électriques. En effet, la plupart des familles cuisinent avec des fourneaux à charbon, qui comportent une émission importante de CO2. «Le résultat est que l'on crée beaucoup de pollution domestique. Et cela provoque de nombreux morts à cause de maladies respiratoires. En plus cela coûte très cher et ici les gens n'ont même pas d'argent pour acheter la nourriture nécessaire. Les plaques de cuissons que nous essayons de diffuser font économiser et réduisent les émissions de carbone, de cette manière la pollution diminue et la santé s'améliore, en particulier celle des mères et des petits enfants qui sont toujours avec elles».
Et ensuite, il y a l'agriculture, l'un des seuls secteurs qui donne du travail, mais qui doit faire ses comptes avec un climat capable d'anéantir en un jour le labeur de plusieurs mois. L'année dernière, deux ouragans, l'un dans la zone centrale du pays, l'autre au Nord, ont détruit une partie du Mozambique. «De nombreuses familles ont retrouvé leurs maisons détruites et les semences plantées complètement ravagées pour toute la saison. Depuis ce moment, nous avons décidé de nous en occuper. Nous avons commencé à travailler avec les agriculteurs pour reprendre les cultures et comprendre quelles sont les problématiques dans leurs zones, de manière à diminuer les risques dûs au changement climatique». Les dommages provoqués par les cyclones ne sont pas encore terminés. «De nombreuses familles sont encore déplacées». Ensuite, il y a le djihad. Dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, c'est la guerre depuis trois ans: d'un côté les rebelles de matrice islamique, de l'autre les forces gouvernementales. Au milieu, les civils qui voient leurs maisons détruites, leurs proches décapités. Selon les données des Ong, depuis 2017 mille personnes sont mortes et 100 mille ont été obligées de fuir. Martina vit à Maputo avec sa famille. Elle a connu celui qui est maintenant son mari au Soudan du Sud. Il y a cinq mois, ils ont eu une petite fille. De ces années en Afrique, elle a appris «à être patiente, à comprendre qu'il peut y avoir des vies très différentes de la mienne, mais dignes de respect, à ne rien tenir pour acquis, à respecter des rythmes qui sont différents de ceux que nous pouvons avoir en Italie, à vivre et à apprécier les choses simples: il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux».
Elisa Calessi
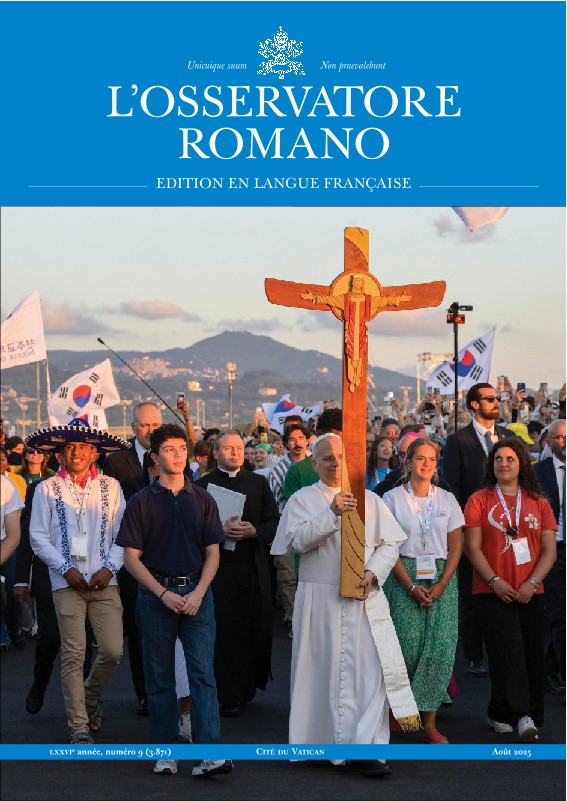



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti