
« Nous adorons la perfection, parce que nous ne pouvons pas l’atteindre ; et elle nous répugnerait si nous l’atteignions. Le parfait est inhumain, parce que l’humain est imparfait ». C’est ce qu’écrivait le tourmenté et génial Fernando Pessoa, des paroles qui retentissent aujourd’hui comme une prophétie et un avertissement.
Un avertissement, parce que jusqu’à présent, nous avons avancé à l’aveuglette sur la voie de la faisabilité technique. La science et la technique nous disent ce que l’on peut faire, pas ce qui est mieux de faire. Et les deux choses ne coïncident pas nécessairement, au contraire. On est parvenu à la scission de l’atome, et cela a été une conquête grandiose, mais lancer des bombes atomiques n’a pas été une bonne chose, bien que techniquement possible.
Mais faisons un pas en arrière, pour ne pas tomber dans un moralisme stérile.
L’être humain, à la différence des animaux, naît incomplet. On dit qu’il est « néoténique », dit-on, parce que le processus de différenciation des organes et de réalisation de la forme définitive est lent et tardif par rapport à celui d’autres êtres vivants. C’est pourquoi il est également plastique et, à la différence des (autres) animaux, il ne se limite pas à s’adapter, mais il prend forme en donnant forme au monde. C’est sa « nature » : intervenir sur soi et sur le monde, notamment à travers la technique, qui est un développement des capacités typiquement humaines de fabriquer, former, produire, faire être. Pour qui croit, un signe de la ressemblance avec Dieu, qui a donné la mission au genre humain de porter à terme la création.
Pour l’être humain, en tout cas, la nature existe uniquement en tant qu’« habitée », c’est-à-dire revêtue de sens et façonnée dans des formes toujours nouvelles, écrivait Romano Guardini. La « loi de nature » est la capacité de l’être humain à intervenir sur la nature même. Nous sommes des êtres symboliques, c’est-à-dire culturels. Aujourd’hui, le débat nature/culture ne peut plus être lu en termes ingénus, et surtout dualistes. Le dualisme, selon Romano Guardini, est un « péché originel métaphysique ». Dire que l’homme doit être uniquement nature, ou qu’il doit s’émanciper de la nature pour être uniquement culture sont deux partis-pris tout aussi absurdes et destructeurs. Le dualisme, qui signifie rompre ce qui est uni, finit par légitimer des séparations monstrueuses : si je peux séparer le corps et l’esprit, et si le corps dans cette séparation est sous-valué, je peux également le réduire à un instrument de la volonté, à une matière pouvant être manipulée selon les intentions. Le dualisme platonique du corps-prison de l’âme, que le catholicisme a, de façon paradoxale, également avalisé par certains aspects, avec la perte des horizons religieux devient corps-matière à disposition.
L’homme est l’unique animal qui ne se contente pas d’être ce qu’il est, écrivait Albert Camus. Nous sommes des êtres poussés au-delà de nous-mêmes, désirant, auto-transcendants. Mais cette tension à aller plus loin peut revêtir des formes pleinement humaines et des formes inhumaines.
Post-humain, transhumain, sont des termes relativement récents, porteurs d’une ambivalence qui ne peut être affrontée uniquement dans une perspective technique. Post-humain peut indiquer le dépassement d’un « anthropocentrisme despotique », comme l’appelle le Pape François, où la supériorité de l’homme s’est traduite en exploitation inconsidérée de la nature et du monde, qui se retournent à présent contre nous. Mais tomber dans l’excès inverse, c’est-à-dire dans l’équivalence de l’être humain par rapport à des animaux, des plantes, des artéfacts techniques signifie être victimes de l’erreur dualiste : soit tu es tout, soit tu n’es rien, soit tu es souverain, soit tu es un quelconque serviteur. Oblitérer les limites entre personnes et choses est dangereux, nous rappelle Jürgen Habermas, et ce n’est pas un égalitarisme zoocentrique qui rendra le monde plus vivable.
Il en est de même pour le transhumain : aller au-delà de l’humain est, paradoxalement, typiquement humain. De quelle façon et jusqu’à quel point aller au-delà, et si tout « au-delà » est légitime, cela aussi est une affaire humaine : nous ne pouvons l’abandonner aux lois autopoiétiques de la faisabilité technique.
Il faut donc faire des distinctions. Je pense, pour donner un exemple que tous connaissent, à Bebe Vio et à la façon dont la technique s’est alliée avec la vie contre la mort. Cela s’appelle healing, cela signifie soigner pour régénérer, et ainsi faire renaître. Mais la technique fait beaucoup plus que « réparer » : elle renforce. Cela s’appelle enhancement (élévation, accroissement) et c’est une dimension fondamentale du transhumain. Je pense ici au rêve de fabriquer la vie dans une éprouvette, en l’étendant à tous (ceux qui pourront payer) le droit à la parentalité, sans aucune autre considération : l’être humain est entré dans l’ère de sa reproductibilité technique. Comme l’écrit Sylviane Agacinski, aujourd’hui, « la médecine dépasse sa mission thérapeutique pour assumer une fonction anthropotechnique, qui nous permet non seulement de réparer, mais de rectifier le corps humain et même de le produire à partir de zéro ». Hannah Arendt parlait déjà de l’effort pour fabriquer l’être humain dans une éprouvette comme de la tentative d’échanger la vie reçue contre un produit issu de ses propres mains. Transformer le « générer » (qui est relation : avec qui nous a précédé, avec le partenaire, avec la progéniture) en « fabriquer » (qui est l’extension de la volonté du moi absolu, séparé des liens) signifie considérer la limite uniquement comme un empêchement, plutôt qu’une occasion, de liberté.
Mais qu’est-ce que la limite ? C’est la porte d’accès à la réalité : où tout est possible et rien n’est réel, écrit Miguel Benasayag. Est-ce vraiment en éliminant les limites que l’on devient plus libres ?
La technique fait des merveilles, mais elle procède à travers des lois propres et quand elle se fond avec le système technoéconomique, elle nous rend esclaves en vendant une liberté qui n’est qu’apparente.
La différence de genre est également une limite. Ivan Illich soutenait que la science est doublement sexiste : parce que c’est une activité dominée par les hommes et parce qu’elle se fonde sur des catégories et des procédures « neutres » (pour lesquelles le féminin est un point de résistance gênant).
La thèse que j’essaie d’exprimer est que la voie de l’abstraction radicale, à travers le dépassement de toute limite, comme celle que la technique suggère comme condition de liberté, est en réalité une voie d’aliénation, de transfert de domination à d’autres (au système technocratique) et donc d’esclavage. Et que l’antidote à cette dérive ne vient pas d’une bataille de principes, mais de reconnaître et de savoir vivre de façon consciente (et antidualiste) le caractère concret des tensions qui caractérisent l’existence humaine, comme celle entre la vie et la mort, ou entre soi et l’autre que soi, ou entre activité et passivité. Et également entre masculin et féminin, qui ne sont pas des dimensions biologiques, mais symboliques entre lesquelles il n’y a pas de dualisme, mais une réciprocité. Tout dualisme qui oppose ; tout refus de la différence qui l’assimile à une domination ; toute tentative de s’émanciper de la limite de la nature au nom d’un prétendu « neutre » que la technique propose et impose, sont autant de voies destinées à produire des inégalités nouvelles et plus fortes, des formes de domination inédites et plus subtiles.
« Aller au-delà » ne signifie pas effacer la limite, mais l’assumer. La limite est donnée par la réalité qui fait résistance au moi ; elle est donnée par l’autre, et c’est une limite bénéfique. Elle nous rappelle le sens de notre précarité et interdépendance. Mais également que nous n’avons pas un corps, nous sommes un corps. Et ce corps ne peut pas être aliéné (conformément à la Déclaration des droits de l’homme).
Dans un contexte où le neutre est un masculin masqué, la féminité devient dangereuse : « Le désir d’être libéré de la chair peut être lu comme un désir masculin, le désir de se libérer de cette chair féminisée », écrit Sylviane Agacinski.
Le dernier rêve de la technique, fabriquer la vie, est le rêve de rendre pléonastique la contribution de réciprocité du féminin. Et c’est précisément de là que peut venir aujourd’hui un noyau de résistance à la toute-puissance de la technocratie, et de réhumanisation. Afin que le code maternel porte inscrit l’altérité (et donc la limite) dans sa propre matrice. Vouloir se libérer de la « dictature du ventre » signifie vouloir effacer toute limite, pour disposer de tout. Et si nous embrassons cette logique, nous nous remettons à un pouvoir plus grand que nous et nous acceptons d’être traités comme des objets. L’autre nous place face à notre limite et dans le même temps nous ouvre à autre que nous. Cela est le mouvement de la relation féconde et également de la foi : il n’y a pas de prière sans le sens de notre précarité (ce n’est pas un hasard si la racine est la même).
Mais la citation initiale de Fernando Pessoa est également une prophétie, parce que le temps que nous vivons est une gifle à notre hybris, au fait que nous prétendons être maîtres de la vie et artisans d’immortalité. Précisément au cœur de l’Europe très développée, un minuscule organisme se déplace à une vitesse instantanée sur les infrastructures connectives que nous avons construites et il apparaît presque impossible à vaincre au moyen des armes techniques. Au contraire, les hôpitaux deviennent des lieux de contagion du Covid-19. De dispositifs de guérison, ils deviennent des foyers de diffusion, de structures dans lesquelles on va pour guérir, ils deviennent des lieux où l’on va pour mourir, seuls.
Sans aucune diétrologie apocalyptique, nous ne pouvons pas manquer d’être interpellés par l’époque à laquelle nous vivons. La technologie est une arme tranchante sans la responsabilité des personnes, sans le dévouement de qui est en première ligne pour soigner les malades, sans la solidarité à l’égard des plus fragiles, sans la réciprocité entre hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, sains et malades. Il faut un miracle aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas le fabriquer. L’unique miracle que nous pouvons faire sera celui de continuer à vivre, de défendre la fragilité de la vie jour après jour (José Saramago).
Chiara Giaccardi
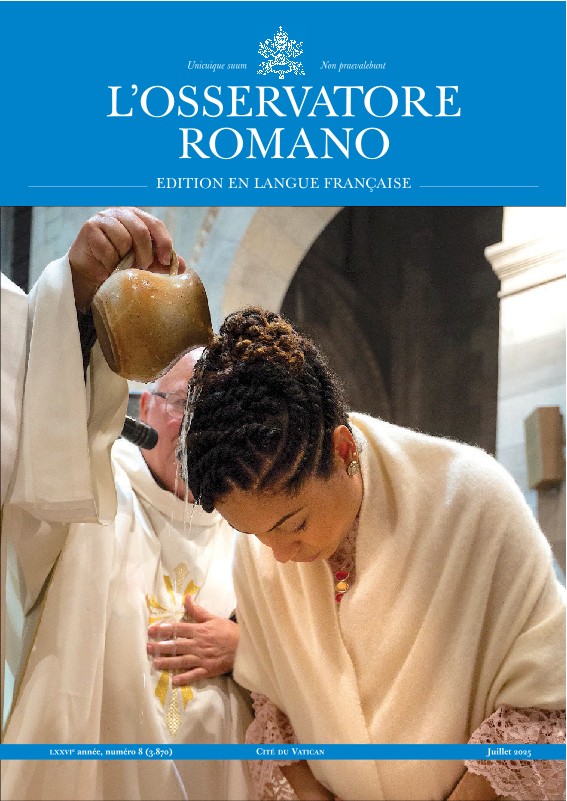



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti