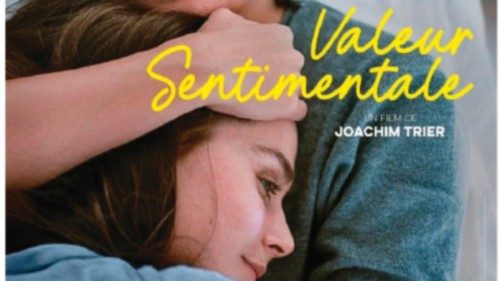
Denis Dupont-Fauville
Chanoine de la basilique Saint-Pierre du Vatican
L’art n’est pas sans rapport avec la religion: chaque artiste est appelé à assumer une forme de symbolisation du monde, qu’il transmet en essayant de la vivre. Toute œuvre s’adresse à d’autres, mais quelle trace laisse-t-elle en chacun? Dans les arts de la scène, cette question est redoublée par la dimen-sion d’incarnation: où se situe la frontière entre un rôle et son interprète? L’acteur phagocytera-t-il son personnage ou se laissera-t-il manger par lui? Le metteur en scène lui-même transmet-il la vie en la montrant aux autres ou doit-il sacrifier le paraître au profit de ceux qu’il a réellement engendrés? Dans la grande famille du spectacle, une vraie famille peut-elle éclore? Chacun n’en vient-il pas à jouer son propre personnage, pour s’abriter du regard d’autrui tout en recherchant ceux qui ne s’y laisseront pas prendre? Finalement, l’enfant est-il voué à porter l’empreinte du père ou seul capable de s’en affranchi?
Ces questions classiques, entre vocation publique et filiation intime, sourdent avec une inten-sité particulière du nouvel opus de Joachim Trier, Valeur sentimentale. Gustav Borg, grand cinéaste norvégien dont la carrière semble achevée, médite un ultime film. Pour ce faire, il reprend contact avec ses deux filles, dont sa carrière l’a séparé. Il voudrait les intégrer dans sa dernière œuvre. Mais comment reprendre le dialogue après l’avoir interrompu? Face au vieux monstre suppliant, un binôme de sœurs, l’une actrice renommée et l’autre médecin psychologue, tente de se protéger sans savoir comment renouer la trame. Deux voire trois générations, qui cherchent à se dire à travers les artifices propres à chacune. Exposer ses failles conduit-il à la ruine? Qui peut transmettre quoi à qui?
Un tel résumé pourrait faire craindre un film de réalisateur, éclipsant la densité humaine des interprètes. Or, c’est le contraire qui se produit. Joachim Trier ne parvient guère à s’affranchir de sa propre construction thématique. Malgré quelques réussites, de la scène de trac initiale aux deux lectures parallèles du même monologue par une starlette américaine et une actrice européenne, sa mise en scène est si explicite qu’elle n’évite pas les lourdeurs, depuis les interventions récurrentes en voix off jusqu’à un dénouement surprise aussi artificiel que prévisible. En revanche, les acteurs sont simplement prodigieux, à commencer par les trois principaux. Une infinité de nuances passe à chaque instant, si riche qu’elle pallie souvent le manque de point de vue du cinéaste. Sourires, hésitations, regards, autant d’enchantements.
A trop se fier au «sentimental» sans creuser assez la «valeur». Trier, en dépit des allusions, échoue à égaler Bergman. Ne tourne pas Sarabande qui veut. Mais la facticité même de sa conclusion met en garde contre l’illusion des happy ends et des larmes faciles. En ce sens, il faut s’abandonner au plaisir de contempler ses acteurs, pour laisser les vraies questions résonner profondément en nous.









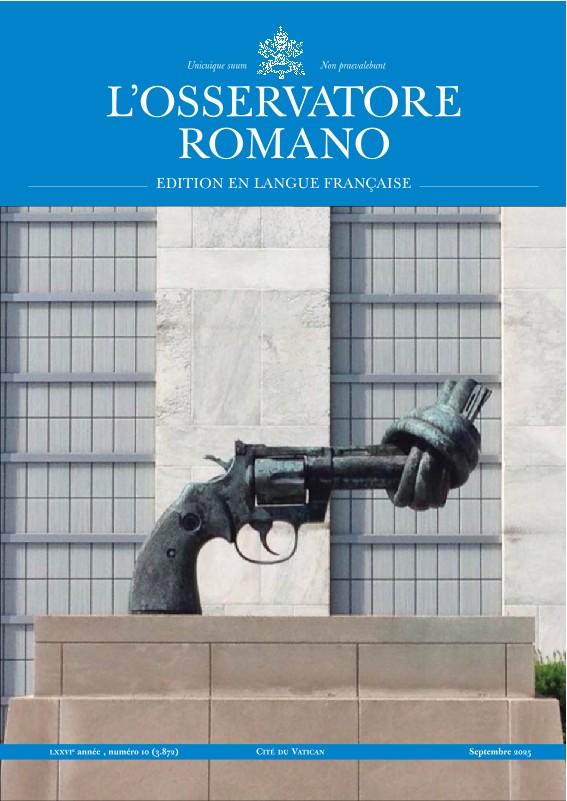



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
