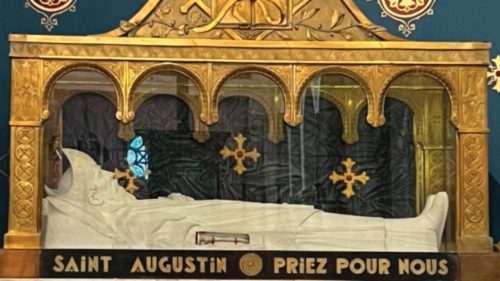
Pierre-Yves Fux
Ancien ambassadeur de Suisse près le Saint-Siège et en Algérie, auteur du livre
«Paix et guerre selon saint Augustin»
«La pace sia con voi!». Les premiers mots de Léon XIV à la foule romaine et au monde correspondent à la salutation liturgique des évêques. Ils reprennent ceux du Ressuscité apparaissant aux apôtres. «La paix soit avec vous»: ainsi se saluent, au quotidien, les habitants de Terre Sainte. Salam aleikum, shalom aleikhem. Là comme ailleurs, la paix n’a pourtant rien de banal. Rare, fragile, la paix ne se laisse pas réduire à une banale formule de politesse. La paix marque un fil conducteur dans la vie et la pensée de saint Augustin, père spirituel de la famille religieuse du nouvel évêque de Rome, élu par le Conclave de 2025.
Espérer et définir la paix
Jusqu’à sa mort le 28 août 430, dans Hippone assiégée par les Vandales, Augustin aura éprouvé toutes sortes d’inquiétudes et de souffrances: les grandes invasions, le violent schisme donatiste, une vie familiale mouvementée et très tôt une maladie qui faillit l’emporter. Ses Confessions racontent sa longue sortie d’une crise spirituelle. «Notre cœur est sans repos, jusqu’à ce qu’il commence à reposer en Toi», lit-on au début de cet extraordinaire dialogue avec Dieu. Cette paix si désirée, saint Augustin la contemple comme une espérance. «Là où se trouve encore la mortalité, comment y-a-t-il une paix complète?», se demande-t-il, avant d’affirmer que «quand la mort aura été absorbée dans la victoire, il y aura une paix complète et éternelle».
Avant la béatitude auprès de Dieu, des formes de paix existent ici-bas. Le 19e livre de la Cité de Dieu développe la réflexion augustinienne sur la paix. L’auteur la résume en neuf définitions, correspondant aux divers niveaux de l’existence, et les fait aboutir à une dixième, celle de la paix en tant que «tranquillité de l’ordre» (voir encadré).
Ici-bas, aussi bien la «tranquillité de l’ordre» que toute forme de douloureux désordre ne sont que partiels et temporaires. La paix échappe à qui pense la posséder mais elle n’a rien d’inaccessible. «Là où tu te trouves, aime la paix, et ce que tu aimes est déjà avec toi». Mieux encore: à la manière de la flamme d’une bougie, la paix ne diminue en rien lorsqu’on la partage. S’adressant aux évêques catholiques d’Afrique du Nord, à la veille d’une conférence décisive qui les confrontera au clergé donatiste, saint Augustin déclare: «Si tu veux qu’un petit nombre soit en paix avec toi, tu auras une petite paix. Si tu veux que cette propriété s’agrandisse, ajoute-y un nouveau propriétaire! Je vous l’ai dit, mes frères: il est bon d’aimer la paix, et le fait même de l’aimer revient à la posséder». Cette quête exige un effort voire une conversion. «Qui se veut un vrai ami de la paix se comporte en ami des ennemis de la paix», avertit Augustin, dans ce même sermon prononcé à Carthage en 411.
Paix, justice, miséricorde
Dans une autre homélie sur la paix, l’évêque d’Hippone commente un verset du Psaume 84: La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Par conséquent, dit-il, «si tu n’aimes pas la justice, tu ne possèderas pas la paix». Augustin se réfère à une réalité que chacun constate dans sa vie quotidienne comme en politique internationale: «il n’y a personne qui ne veuille la paix, mais tous ne veulent pas mettre en œuvre la justice».
Outre la justice, la miséricorde ne doit jamais être évacuée — même dans la conduite de la guerre. Ecrivant à Boniface, un général romain, saint Augustin exprime un principe qui, un jour, fondera le droit international humanitaire: «De même qu’on répond par la violence à celui qui se rebelle et résiste, de même à celui qui a été vaincu ou capturé on doit désormais la miséricorde». Il rappelle que l’«on ne cherche pas la paix pour susciter la guerre, mais on mène la guerre pour acquérir la paix» et adresse cette exhortation à Boniface: «Sois pacifique même dans la guerre, afin que ceux que tu assailles, tu les conduises par ta victoire aux avantages de la paix!».
De la guerre à la paix
Dans l’œuvre immense de saint Augustin, en plus d’un enseignement structuré sur la paix, se trouvent les éléments de ce qu’on appellera la doctrine de la guerre juste. Nourri par l’exigence chrétienne, cet héritage gréco-romain inspirera d’autres pen-seurs et continue d’être invoqué par des dirigeants, des diplomates et des juristes. Une formulation actuelle de cette doctrine est intégrée dans le Catéchisme de l’Eglise catholique (n. 2309). L’expression «guerre juste», qui n’est pas augustinienne, ne doit pas laisser penser qu’il s’agit là de célébrer le recours à la force. Orientée vers la justice et la paix, cette doctrine vise à écarter la menace de la guerre, en énonçant des conditions strictes et cumulatives à l’usage des armes.
«La paix doit relever de la volonté, la guerre de la nécessité», écrit saint Augustin. La guerre n’est jamais désirable; elle peut devenir l’ultime recours pour éviter une submersion par la cruauté et la méchanceté. Les autres moyens restent préférables. Un an avant sa mort, Augustin écrit à Darius, un envoyé impérial qui, par sa médiation, venait d’éviter une guerre civile: «Il y a une plus grande gloire à tuer les guerres elles-mêmes, par la parole, plutôt que de tuer des hommes par le fer — à gagner ou à préparer la paix par la paix, non par la guerre. En effet, également ceux qui combattent, s’ils sont bons, recherchent sans aucun doute la paix, mais pourtant dans le sang; toi, tu as eu pour mission d’empêcher que soit versé le sang. C’est pourquoi, aux autres incombe une nécessité, à toi une félicité».
«Une paix désarmante et désarmée»
Saint Augustin appelle à suivre le chemin d’une paix que Léon XIV qualifiera de «désarmante et désarmée, humble et persévérante». La parole peut suffire à faire advenir la paix. Augustin l’a essayé sans relâche, en prononçant des homélies, en envoy-ant des lettres, en écrivant La Cité de Dieu et en allant à la rencontre de tel évêque schisma-tique, de tel général rebelle. Cet engagement atteint son point culminant lors de la Conférence de Carthage, lorsqu’il s’agit de rendre l’unité à l’Eglise de l’Africa, déchirée par un schisme.
En 393 déjà, moine et prêtre, saint Augustin avait même composé une chanson populaire pour encourager les donatistes à mettre fin aux divisions et controverses. On a perdu sa mélodie mais conservé le rythme et le texte de ce psaume alphabétique, dont le refrain souligne les liens de la paix avec la justice et la vérité: Vos qui gaudetis de pace, modo verum iudicate! «Vous qui vous réjouissez de la paix, ayez au moins un jugement véridique!». Tous sont appelés à rechercher et à aimer cette «tranquillité de l’ordre».
Africanité et universalité de saint Augustin
En 2001, dans une Algérie ensanglantée par une «décennie noire», quarante savants du monde entier se retrouvèrent sur les lieux où vécut Augustin. Entre eux et avec les Algériens, ils parlèrent de l’africanité et de l’universalité de saint Augustin: colloque scientifique, expositions, débats. On mit en exergue la «charte de la paix». Les chrétiens algériens et d’outre-Méditerranée se retrouvèrent alors pour une Messe dans la basilique d’Hippone. Ces événements s’inscrivaient dans l’année dédiée par l’ONU au dialogue des civilisations. Les pèlerins qui visitent aujourd’hui cette basilique y voient encore les panneaux multilingues de 2001 qui égrènent les définitions augustiniennes de la paix. Chacun y trouve une invitation à la cohérence dans sa vie personnelle, familiale, civique et religieuse: car des liens existent dans la paix à chaque niveau, du corps jusqu’à la cité céleste, en passant par la maison et la cité.









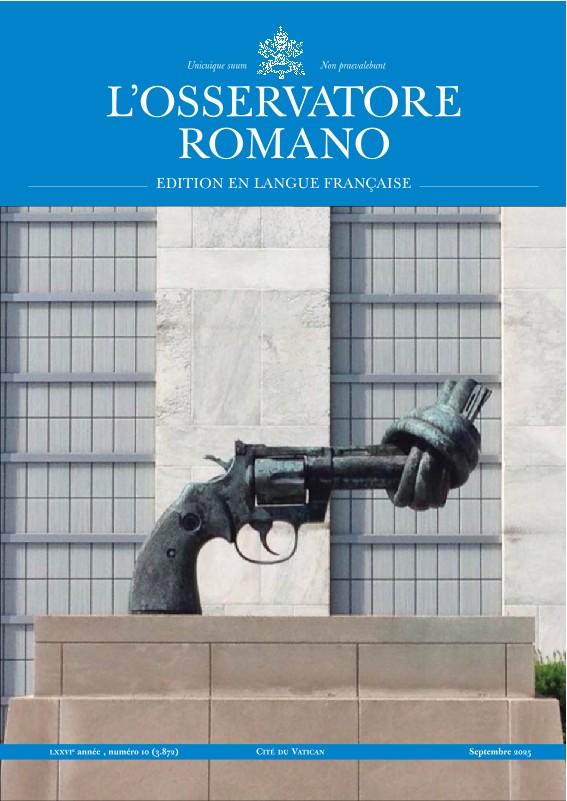



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
