
Bien moins connue que la Garde suisse, la Garde corse fut, elle aussi, une unité militaire au service du Pape. La date exacte de sa création est méconnue. Celle retenue est l’année 1603, sous Clément VIII. Etant donné que l’entrée de Corses au service du Pape remonte au XIVe siècle, il s’agirait en réalité d’une réorganisation des unités déjà existantes. En effet, en 1595, il est rapporté que 600 Corses étaient en service. Ils étaient chargés de la sécurité dans les rues de Rome et dans les campagnes. L’église San Crisogono dans le quartier Trastevere devint l’église nationale des Corses, où de nombreux soldats furent enterrés. Des Messes en langue corse y sont célébrées encore aujourd’hui.
Un évènement tragique provoqua une rupture entre la France et les Etats pontificaux. Le 20 août 1662, aux abords du palais Farnèse, à Rome, une grave rixe éclata entre des soldats corses et des hommes de l’ambassadeur de France de l’époque — et cousin de Louis XIV — Charles III de Blanchefort-Créquy. Cet évènement mena à un réel incident diplomatique puisque le roi de France, très en colère, expulsa le nonce apostolique en France, Celio Piccolomini, annexa des territoires pontificaux français d’Avignon et menaça d’envahir Rome si la Garde n’était pas dissolue.
C’est le traité de Pise, signé le 12 février 1664 entre le Roi Soleil et le Pape Alexandre VII, qui sonna le glas de l’unité militaire corse. L’article XII indique que «toute la Nation corse sera déclarée incapable à jamais de servir, non seulement dans Rome, mais aussi dans l’Etat ecclésiastique, et le barigel [capitaine des archers, ndlr] de Rome sera privé de sa charge, et chassé». A part des excuses publiques, le traité apporte en réalité peu à la France. Le Roi souhaitait montrer que personne ne pouvait rivaliser avec la Cour de France. Il affirmait ainsi sa devise: «Nec pluribus impar» («A nul autre pareil») au monde.









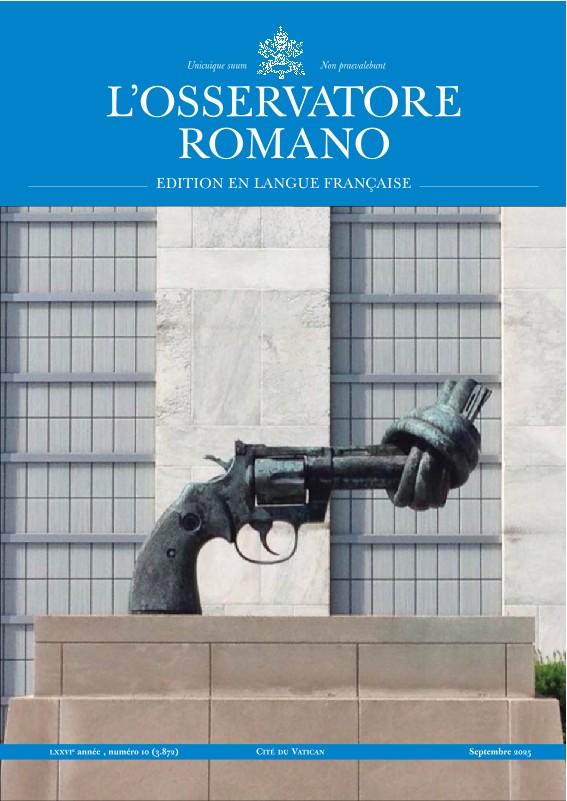



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
