
Pierre de Lauzun
Dans la tradition biblique, le jubilé est l’année où, après 49 ans, les dettes sont annulées, et les propriétés rendues à ceux qui les détenaient. La pratique effective a pu en être débattue, mais l’intention est claire: c’est l’occasion de revoir les liens que crée la dette et d’en libérer ceux qu’elle enchaîne. Dans la précédente année de Jubilé au sens chrétien du terme, en 2000, le Pape Jean-Paul II avait lancé un appel à la remise des dettes des pays les plus pauvres, qui avait été suivi d’un certain effet.
La question se repose toujours aujourd’hui. Le Pape François avait demandé à Jo-seph Stiglitz et Martin Guzman de diriger une Commission du Jubilé, conduisant à un rapport sorti le 20 juin 2025. Ce dernier souligne d’abord le fait que la charge de la dette obère les finances de ces pays: en proportion de leurs recettes fiscales, les intérêts de la dette ont doublé depuis 2011 et 54 pays payent à ce titre plus de 10% de leurs recettes. Il en résulte pour nombre de pays des dépenses plus élevées sur la dette que pour la santé ou l’éducation. En outre, les flux financiers tendent à devenir négatifs, l’argent sortant de ces pays plus qu’il n’en entre.
Le rapport fait de nombreuses propositions de réforme en profondeur. D’un côté, pour résoudre les crises: remises de dettes; prêts en cas de difficulté. De l’autre, pour la prévention de ces crises: mise en place des procédures collectives comme pour les entreprises, comportant la possibilité de réduire les encours (et non de les reporter comme dans les dispositifs existants); intervention sur les pratiques des banques pour les responsabiliser sur leurs prêts, en quantité et en qualité; encouragement des dispositifs de prêt à long terme. En soi raisonnables, ces mesures supposent des changements considérables dans les pratiques, hélas peu probables. Le plus immédiatement faisable est l’annulation de dettes — qui sont d’ailleurs de toute façon en partie irrécouvrables.
Plus profondément, la dette est une des addictions majeures de notre époque. Elle affecte toutes les zones, riches ou pauvres, et tous les emprunteurs, et notamment les emprunteurs publics; et elle croit sans cesse. Le système financier, marchés ou banques, regorge de liquidités, et les mécanismes de prêt sont simples et faciles. Parallèlement, les emprunteurs trouvent là le moyen de reporter à l’avenir les décisions difficiles (baisse des dépenses ou augmentation des impôts).
Dans les cas des pays pauvres, toutefois, ceci se combine avec un problème structurel: ils n’ont en effet que très peu de ressources financières, et un grand besoin d’argent pour se développer. A défaut de dons ou d’investissements directs suffisants, solutions plus saines, le recours à l’emprunt est inévitable. Mais comme le rappelle le rapport cité, les crédits classiques, marché ou banques, ne sont pas adaptés à leurs besoins: trop courts, trop chers. Et donc effectivement il faudrait limiter ces crédits, et étoffer les autres voies: investissements directs et dons, crédits multilatéraux; les crédits publics aussi, mais on rencontre alors la question de la dette des pays avancés eux-mêmes. D’ici là, les annulations peuvent apporter un soulagement bienvenu.









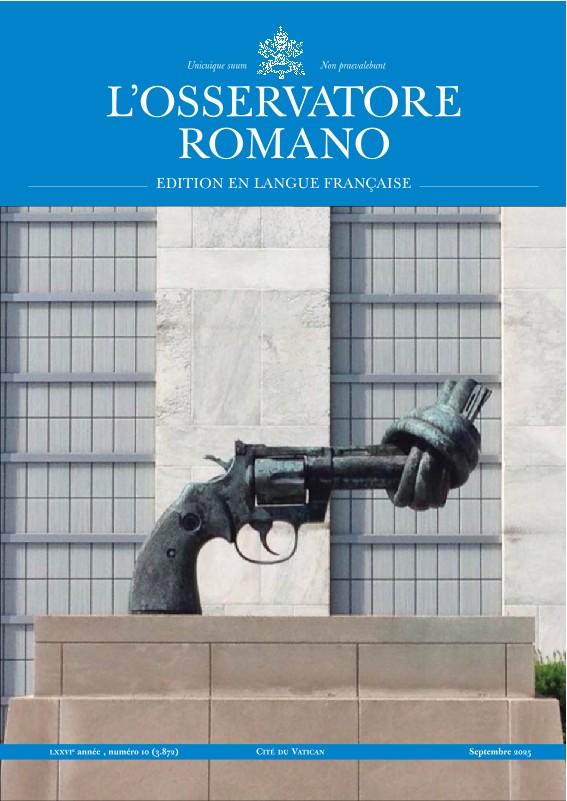



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
