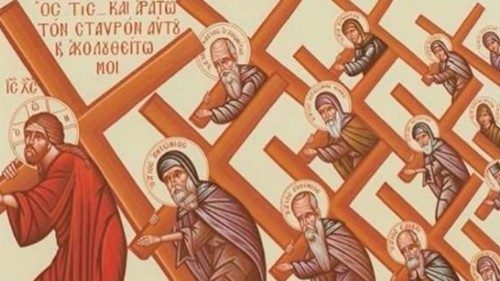
Philippe Lefebvre
Faculté de théologie
de l’Université de Fribourg
La traduction liturgique — c’est compréhensible — adoucit les paroles de Jésus. Que dit-il, en effet, si l’on veut traduire mot à mot le début de son enseignement? Eh bien, il lance ceci: «Si quelqu’un vient à moi et qu’il ne hait pas son père, sa mère...» etc. Oui, il s’agit bien de haine! Dans la Bible, comme dans le monde ancien, le verbe traduit en français par « haïr » (sana en hébreu; miseïn en grec) désigne d’abord le fait de ne pas entretenir de relations bilatérales avec une personne ou un groupe; le sens plus «émotionnel» — concevoir de l’animosité contre un ou plusieurs — ne vient qu’ensuite. Dans les sociétés antiques, on établit des alliances entre individus et groupes; les générations qui suivent se transmettent ces dispositions: avec tel peuple, nous avons un rapport d’amour — c’est-à-dire d’alliance, de reconnaissance mutuelle, avec tel autre groupe, à la suite d’un combat ou d’un problème de frontière, ou même parce que nous n’avons jamais eu affaire avec ces gens, nous n’avons pas ou plus de relations: nous les haïssons. Même si les termes «aimer» et «haïr» ainsi entendus entraînent souvent dans leurs sillages des connotations d’affections ou de répulsions, ils définissent d’abord une sorte de «géographie relationnelle» objective. Le roi Abimelek a chassé Isaac et les siens qui s’installaient dans son territoire: il l’a haï, rendant impossibles toutes relations ultérieures, avant de revenir sur sa décision (Genèse 26, 26-30). Le roi de Tyr, Hiram, félicite le jeune Salomon devenu roi, au nom de l’amour qu’il avait pour son père David (1 Rois 5, 15): Hiram entretenait une bonne entente avec David et son royaume (2 Samuel 5, 11).
Dans notre Evangile, haïr sa parenté et même sa propre vie, comme Jésus le préconise, c’est donc annuler en quelque manière les relations que l’on entretient avec les siens et avec soi-même — les annuler parce qu’elles ne sont pas premières. Même si la famille peut être le premier lieu où l’on découvre Dieu — bien des passages bibliques le suggèrent d’ailleurs, il ne faudrait pas que ladite famille se pense désormais comme la seule source ou le seul horizon de la foi. La foi n’est pas «quelque chose» qui se reçoit et se transmet, comme on transmettrait un bien foncier ou un tableau de maître; elle est à tout moment une aventure personnelle, une expérience à vivre qui peut décontenancer, un trajet imprévu.
Le Christ l’affirme de manière décisive: il faut prendre sa croix et le suivre, Lui seulement. Avant qu’on ne parle de la croix de Jésus lors de la Passion, Jésus lui-même parle de notre croix, à chacun, dont on fait l’expérience avec Lui. C’est pourquoi il faut «haïr» tous ses proches, parce qu’Il est notre Proche le plus intime, notre Parent qui va dévoiler notre ressemblance avec Lui.
Haïr ses proches, c’est donc, au sens biblique, ne vouloir ressembler qu’au Christ, n’avoir que Lui comme parent qui nous mène vers notre Père. «Haïr» tous, pour, avec tous, marcher au pas du Christ vers le Père.









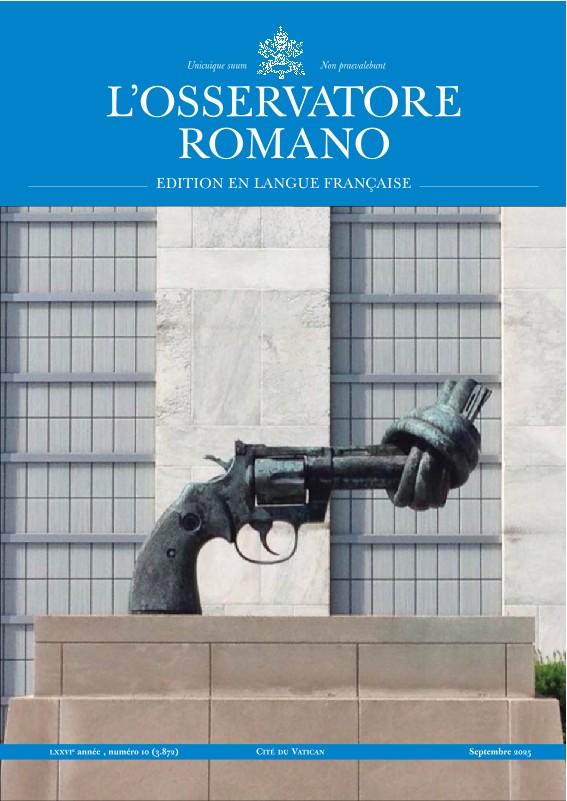



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
