
Pino Esposito
Au cours de la première bénédiction apostolique Urbi et Orbi, le soir de son élection, Léon XIV s’est défini comme «fils de saint Augustin». Il a repris les paroles de ce dernier sur la dignité de la charge, en répétant: «Avec vous, je suis chrétien, et pour vous, je suis évêque» (Sermon 340, 1). Ce thème, lié à l’une des périodes les plus illustres de la pensée patristique, laisse entrevoir les bases théologiques du nouveau pontificat.
Dès les premières interventions du Pape apparaît l’idée d’une autorité assumée selon cette logique de relation. A la suite de son tout premier message, s’adressant cette fois-ci aux professionnels de la communication, le Saint-Père incite à partager l’histoire qui nous relie. Tous se plaignaient des temps difficiles et Augustin les exhortait: «Et vous direz encore: les temps sont mauvais, les temps sont durs, les temps sont malheureux! Vivez sagement, et en vivant de la sorte vous changez les temps; vous changez le temps et vous n’avez plus sujet de murmurer» (Sermon 311, 8). Léon, reprenant les paroles du saint d’Hippone, invite à un «assainissement» introspectif de l’époque dans laquelle nous vivons, «Vivons bien, et les temps seront bons» puisque «nous sommes les temps».
Le 18 mai, dans l’homélie de la Messe pour le début du pontificat, après avoir spécifié l’intention et le bénéfice («pour vous») du ministère pétrinien, le Pape précise la valeur eschatologique de la destination de ce qui lui a été confié. Il cite les Confessions: «Tu nous as faits pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en Toi» (1, 1.1). Il présente ensuite un projet pastoral dans lequel sotériologie et -proximité entrent en relation. Le Pape revient au Docteur de la Grâce pour définir l’accord sur lequel repose cette union sur le plan humain: «L’Eglise est constituée de tous ceux qui sont en accord avec leurs frères et qui aiment leur prochain» (Sermon 359, 9).
Le 19 mai, s’adressant aux représentants d’autres Eglises et religions, Léon XIV parle de confluence, non de conversion. C’est sa devise même empruntée à l’évêque d’Hippone qui la redéfinit: «dans l’Unique [in Illo] — c’est-à-dire le Christ — nous sommes un» (Enarr. in Ps., 127, 3). Notre «communion» se réalise à partir du moment où «nous convergeons vers le Seigneur Jésus».
Le 22 mai, à l’assemblée des Œuvres pontificales missionnaires, il reprend sa réflexion sur la nature pluraliste, éminemment trinitaire et intrinsèquement non monolithique de la communauté chrétienne qui, si elle est une — en reprenant la formule In Illo uno unum — l’est comme «famille» («famille de Dieu»).
Le 20 mai, en visite auprès de la tombe de saint Paul, le Pape réfléchit sur la grâce de l’appel, où l’amour de Dieu précède celui pour Dieu: «Que pouvons-nous choisir, si nous n’avons pas d’abord été choisis?» (il cite le Sermon 34, 2). Saint Augustin indiquait déjà dans l’image maternelle de l’allaitement de l’enfant le signe de la condition originelle de l’homme incapable de se nourrir seul (selon (Enarr. in Ps., 130, 9). Et il n’apparaît pas non plus admissible de penser que ce qui nourrit depuis le début puisse un jour s’épuiser («panis qui reficit, et non deficit» [Sermon 130, 2], dans l’homélie du 22 juin).
Dans son Message aux participants à la commémoration des 500 ans du mouvement anabaptiste, le 29 mai, Léon XIV perçoit la grandeur d’un Dieu qui prédispose à l’obéissance selon ce qui est soutenu dans les Confessions: «Donnez-moi [ô Seigneur] ce que vous m’ordonnez, et ordonnez-moi ce qu’il vous plaît» (X, 29.40).
Le 31 mai, après la récitation du Rosaire dans les jardins du Vatican, à la manière de saint Augustin, le Saint-Père distingue de possibles désaccords dans la louange à Dieu, les identifiant à des paroles qui ne mettent pas d’accord «la langue avec la vie, la conscience avec les lèvres» (Sermon, 256, 1). Dans la forme dialogique de la litanie mariale, il enseigne à invoquer pour nous préparer à répondre.
Le 4 juin, lors de l’Audience générale, il cite le Sermon 87 pour méditer sur la procrastination spirituelle: «Pourquoi donc tardes-tu à suivre celui qui t’appelle[…]?» (6.8). «Qu’attendons-nous?» est la question augustinienne évangélique que Léon XIV pose à l’Eglise d’aujourd’hui. Il la pose également à l’occasion du cycle de catéchèses consacrées à la guérison du paralytique: «L’homme qu’il fallait est donc venu, pourquoi retarder encore la guérison?» (Homélies 17, 7 à laquelle il se réfère le 18 juin).
Reconnaissant nos fragilités («dans le cours de cette vie [nous avons] en nous comme des ouvertures qui donnent entrée au péché»: je reproduis la citation papale du Sermon 278 13.13), le Souverain Pontife ne propose pas une attitude «protectionniste», mais de libération. Elle correspond au pardon qui relie, pas à la fermeture qui isole (salle du Consistoire, 6 juin).
Le 12 juin, devant le clergé romain, le Pape répète l’appel de saint Augustin: «Aimez cette Eglise, vivez en elle […]» (Sermon 138, 10), en soulignant sa nature de participation. Il utilise la locution déjà mentionnée, «avec vous» («je vous assure de ma proximité, de mon affection et de ma disponibilité à marcher avec vous»), un élément qui s’insère dans le binôme plus ample — en Toi et pour Toi — qui revient dans ses discours, et qui compose une formule relationnelle supérieure d’amour intérieur, orienté et partagé.
Le 17 juin, devant les évêques italiens, il fait l’éloge de la complexité, de la complémentarité, du pluralisme, en somme de la synodalité: «Si le corps n’était qu’œil, où est l’oreille? […]» (avec une référence au Enarr. in Ps. 130, 6). L’Eglise n’est telle que si, et seulement si, elle crée des liens.
Dans le message vidéo aux jeunes, le 14 juin, le Saint-Père exhorte à «commencer par notre vie, par notre cœur» (Sermon 311). C’est encore à saint Augustin qu’il emprunte les paroles sur la réforme intérieure — qu’il avait déjà reprises et que j’ai citées au début: «Notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en Toi» (Confessions 1, 1.1).
Le 24 juin, s’adressant aux séminaristes à l’occasion de leur jubilé, il relance l’invitation augustinienne à «revenir au cœur», au lieu de la rencontre avec Dieu.
L’empreinte de saint Augustin apparaît dans les dis-cours comme dans le nom même du Pape, pris en hommage à l’héritage de Léon XIII. Ce fut précisément le Pape de Rerum novarum, à la fin du XIXe siècle, qui appela l’augustin Antonio Pacifico Neno, œuvrant alors en Pennsylvanie, à superviser la reprise de l’Ordo Sancti Augustini, après les multiples suppressions subies en Europe. Aujourd’hui, un augustin américain guide l’Eglise: un fait qui témoigne des flux et des reflux par lesquels les énergies spirituelles d’Amérique contribuent aux anciennes traditions chrétiennes.









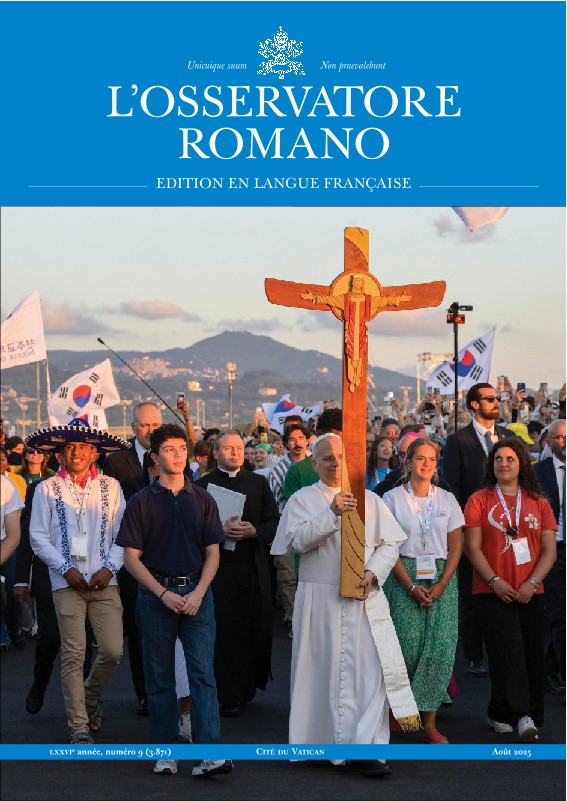

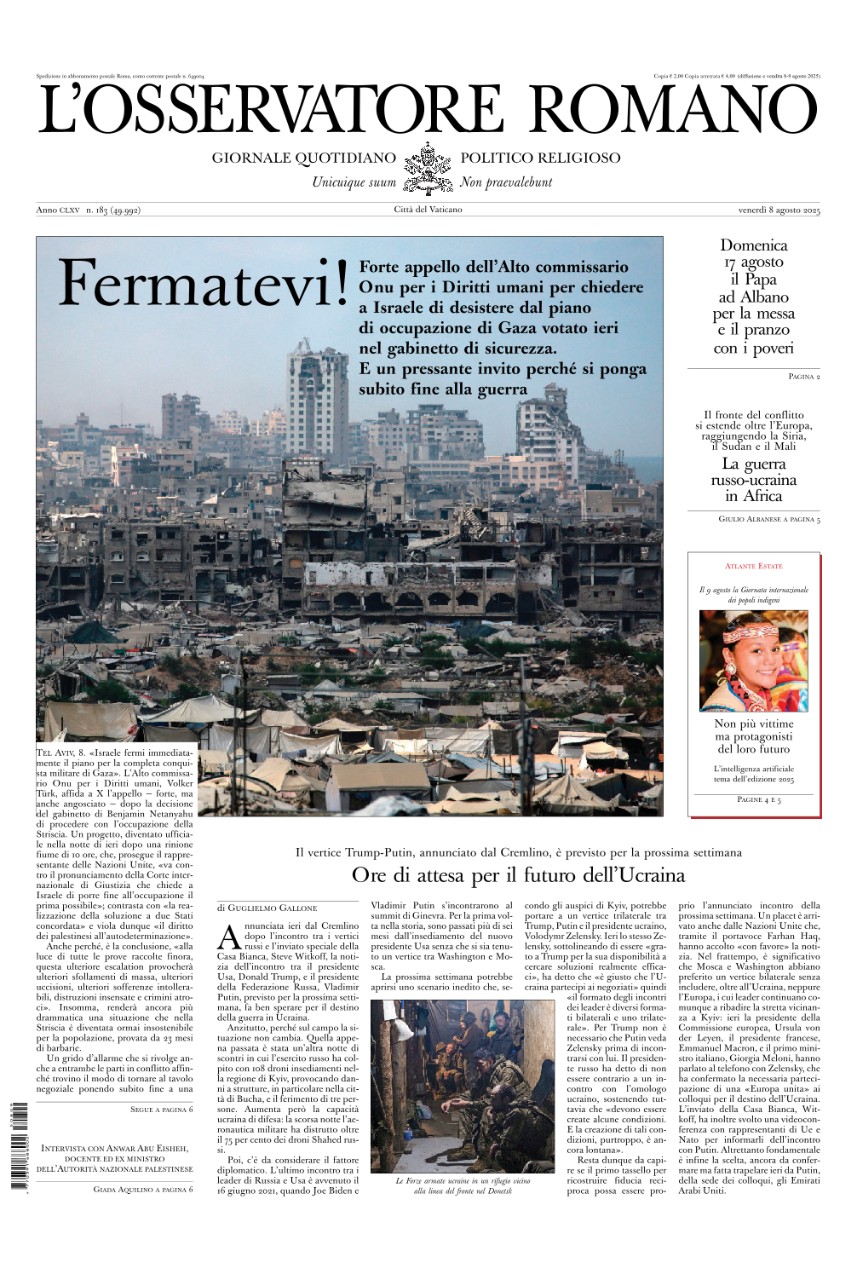

 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
