
Message aux participants au séminaire promu par le dicastère pour les laïcs,
la famille et la vie
Devenir «pêcheurs» de familles
Chers frères et sœurs!
Je suis heureux qu’au lendemain de la célébration du Jubilé des familles, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées, un groupe d’experts se soit réuni au Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie pour réfléchir sur le thème: Evangéliser avec les familles d’aujourd’hui et de demain. Défis ecclésiologiques et pastoraux.
Ce thème exprime bien la sollicitude maternelle de l’Eglise à l’égard des familles chrétiennes présentes dans le monde entier: membres vivants du Corps mystique du Christ et premier noyau ecclésial auquel le Seigneur confie la transmission de la foi et de l’Evangile, en particulier aux nouvelles générations.
La recherche profonde d’infini inscrite dans le cœur de tout homme donne aux pères et aux mères la mission de rendre leurs enfants conscients de la Paternité de Dieu, selon ce qu’écrivait saint Augustin: «La source de la vie est auprès de toi, comme c’est dans ta lumière que nous verrons la lumière» (Confessions, XIII, 16).
Notre époque est caractérisée par une recherche croissante de spiritualité, perceptible surtout chez les jeunes, désireux de relations authentiques et de maîtres de vie. C’est pourquoi il est important que la communauté chrétienne sache porter son regard au loin, devenant gardienne, face aux défis du monde, de cet élan de foi qui habite le cœur de chacun.
Il est particulièrement urgent, dans cet effort, de prêter une attention spéciale aux familles qui, pour diverses raisons, sont spirituellement plus éloignées: celles qui ne se sentent pas concernées, qui se disent désintéressées, ou encore qui se sentent exclues des parcours ordinaires mais qui aimeraient malgré tout faire partie d’une communauté dans laquelle grandir et avec laquelle marcher. Combien de personnes aujourd’hui ignorent l’invitation à rencontrer Dieu!
Malheureusement, face à ce besoin, une «privatisation» de plus en plus répandue de la foi empêche souvent ces frères et sœurs de découvrir la richesse et les dons de l’Eglise, lieu de grâce, de fraternité et d’amour!
Ainsi, bien qu’habités par des désirs sains et saints, tout en cherchant véritablement des appuis pour gravir les beaux sentiers de la vie et de la pleine joie, beaucoup finissent par s’en remettre à de faux soutiens qui, ne supportant pas le poids de leurs aspirations les plus profondes, les laissent retomber vers le bas, les éloignant de Dieu et faisant d’eux des naufragés dans un océan de sollicitations mondaines.
Parmi eux se trouvent des pères et des mères, des enfants, des jeunes et des adolescents, parfois éloignés par des modèles de vie illusoires où il n’y a pas de place pour la foi, et à la diffusion desquels contribue dans une large mesure l’usage déformé de moyens en eux-mêmes potentiellement bons — comme les réseaux sociaux — mais qui deviennent nuisibles lorsqu’ils véhiculent des messages trompeurs.
C’est précisément ce désir d’aller «pêcher» cette humanité qui pousse l’Eglise dans son effort pastoral et missionnaire, pour la sauver des eaux du mal et de la mort à travers la rencontre avec le Christ.
Il se peut que de nombreux jeunes, qui aujourd’hui préfèrent le concubinage au mariage chrétien, ont en réalité besoin de quelqu’un qui leur montre, de manière concrète et compréhensible, surtout par l’exemple de la vie, ce qu’est le don de la grâce sacramentelle et quelle force en découle; qui les aide à comprendre «la beauté et la grandeur de la vocation à l’amour et au service de la vie» que Dieu confie aux époux (saint Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 1).
De même, de nombreux parents, dans l’éducation à la foi de leurs enfants, ont besoin de communautés qui les soutiennent pour créer les conditions permettant à leurs enfants de rencontrer Jésus, «des lieux où se réalise cette communion d’amour qui trouve sa source ultime en Dieu lui-même» (François, Audience générale, 9 septembre 2015).
La foi est avant tout une réponse à un regard d’amour, et la plus grande erreur que nous puissions commettre en tant que chrétiens est, selon les paroles de saint Augustin, «de prétendre faire consister la grâce du Christ dans son exemple, et non dans le don de sa personne» (Contra Iulianum opus imperfectum, II, 146). Combien de fois, dans un passé sans doute pas si lointain, avons-nous oublié cette vérité, et présenté la vie chrétienne principalement comme un ensemble de préceptes à observer, remplaçant ainsi l’expérience merveilleuse de la rencontre avec Jésus, Dieu qui se donne à nous, par une religion moralisante, lourde, peu attirante, et par certains aspects irréalisables dans la vie quotidienne concrète.
Dans ce contexte, il revient d’abord aux évêques, successeurs des apôtres et pasteurs du troupeau du Christ, de jeter les filets en mer et de devenir «pêcheurs de familles». Mais les laïcs sont eux aussi appelés à s’impliquer dans cette mission, devenant, aux côtés des ministres ordonnés, des «pêcheurs» de couples, de jeunes, d’enfants, de femmes et d’hommes de tout âge et de toute condition, afin que tous puissent rencontrer Celui qui seul peut sauver. En effet, chacun de nous, dans le baptême, est constitué Prêtre, Roi et Prophète pour ses frères, et devient «pierre vivante» (cf. 1 P 2, 4-5) pour la construction de l’édifice de Dieu «dans la communion fraternelle, dans l’harmonie de l’Esprit, dans la coexistence des diversités» (Homélie, 18 mai 2025).
Je vous demande donc de vous unir aux efforts par lesquels toute l’Eglise part à la recherche de ces familles qui, seules, ne s’approchent plus; afin de comprendre comment marcher avec elles et comment les aider à rencontrer la foi, pour qu’elles deviennent à leur tour «pêcheuses» d’autres familles.
Ne vous laissez pas décourager par les situations difficiles que vous rencontrerez. Il est vrai qu’aujourd’hui, les foyers familiaux sont blessés de nombreuses manières, mais «l’Evangile de la famille nourrit également ces germes qui attendent encore de mûrir et doit prendre soin des arbres qui se sont desséchés et qui ont besoin de ne pas être négligés» (François, Exhort. apost. Amoris laetitia, n. 76).
C’est pourquoi il est urgent de promouvoir la rencontre avec la tendresse de Dieu, qui valorise et aime l’histoire de chacun. Il ne s’agit pas d’apporter des réponses hâtives à des questions difficiles, mais de se faire proches des personnes, de les écouter, en cherchant à comprendre avec elles comment affronter les difficultés, prêts aussi à nous ouvrir, si nécessaire, à de nouveaux critères d’évaluation et à différentes modalités d’action, car chaque génération est différente des précédentes et présente des défis, des rêves et des interrogations propres. Mais, au milieu de tant de changements, Jésus Christ demeure «le même hier, aujourd’hui et à jamais» (He 13, 8). C’est pourquoi, si nous voulons aider les familles à vivre des chemins joyeux de communion et à être les unes pour les autres des semences de foi, il est nécessaire, avant tout, que nous cultivions et renouvelions notre propre identité de croyants.
Chers frères et sœurs, je vous remercie pour ce que vous faites! Que l’Esprit Saint vous guide dans le discernement de critères et de modalités d’engagement ecclésial capables de soutenir et de promouvoir la pastorale familiale. Aidons les familles à écouter avec courage la proposition du Christ et les appels de l’Eglise! Je vous porte dans ma prière et je vous donne de tout cœur à tous la Bénédiction apostolique.
Du Vatican, le 28 mai 2025
Léon PP. XIV
Audience générale
Place Saint-Pierre, 4 juin 2025
Jésus ne fait pas de classements
Chaque vie compte
Chers frères et sœurs, bonjour!
J’aimerais m’arrêter à nouveau sur une parabole de Jésus. Il s’agit à nouveau d’un récit qui nourrit notre espérance. Parfois, nous avons l’impression de ne pas parvenir à trouver de sens à notre vie: nous nous sentons inutiles, inadaptés, comme les ouvriers qui attendent sur la place du marché que quelqu’un les fasse travailler. Mais il arrive aussi que le temps passe, que la vie s’écoule et que nous ne nous sentions pas reconnus ni appréciés. Peut-être ne sommes-nous pas arrivés à temps, d’autres se sont présentés avant nous, ou des soucis nous ont retenus ailleurs.
La métaphore de la place du marché est également très adaptée à notre époque, car le marché est le lieu des affaires, où malheureusement s’achète et se vend autant l’affection que la dignité, en essayant d’en tirer profit. Et quand on ne se sent pas valorisé, reconnu, on risque même de se vendre au premier venu. Le Seigneur, au contraire, nous rappelle que notre vie a une valeur et qu’il désire nous aider à la découvrir.
Toujours dans la parabole que nous commentons aujourd’hui, il y a des ouvriers qui attendent que quelqu’un les prenne pour une journée. Nous sommes au chapitre 20 de l’Evangile de Matthieu et là aussi nous trouvons un personnage au comportement inhabituel, qui étonne et interroge. Il s’agit du propriétaire d’une vigne, qui se déplace en personne pour aller chercher ses ouvriers. Il veut évidemment établir avec eux une relation personnelle.
Comme je le disais, c’est une parabole qui donne de l’espérance, parce qu’elle nous dit que ce patron sort plusieurs fois pour aller à la recherche de qui cherche à donner un sens à sa vie. Le patron sort dès l’aube et revient ensuite toutes les trois heures pour chercher des ouvriers à envoyer dans sa vigne. Selon ce schéma, après être sorti à trois heures de l’après-midi, il n’y aurait plus de raison de sortir à nouveau, car la journée de travail se terminerait à six heures.
Au lieu de cela, ce patron infatigable, qui veut à tout prix valoriser la vie de chacun d’entre nous, sort pourtant à cinq heures. Les ouvriers restés sur la place du marché avaient sans doute perdu tout espoir. Cette journée s’était déroulée en vain. Et pourtant, quelqu’un a cru encore en eux. Quel sens cela a-t-il de prendre des ouvriers uniquement pour la dernière heure de la journée de travail? Quel sens cela a-t-il d’aller travailler pour une heure seulement? Pourtant, même lorsqu’il nous semble de ne pouvoir faire que peu de chose dans la vie, cela en vaut toujours la peine. Il y a toujours la possibilité de trouver un sens, parce que Dieu aime notre vie.
Et l’originalité de ce patron se manifeste aussi à la fin de la journée, au moment de la paie. Avec les premiers ouvriers, ceux qui vont à la vigne dès l’aube, le maître s’était mis d’accord sur une somme d’argent, qui était le coût typique d’une journée de travail. Aux autres, il dit qu’il leur donnera ce qui est juste. Et c’est précisément ici que la parabole vient nous interpeller: qu’est-ce qui est juste? Pour le propriétaire de la vigne, c’est-à-dire pour Dieu, il est juste que chacun ait le nécessaire pour vivre. Il a appelé les travailleurs personnellement, il connaît leur dignité et il veut les payer en fonction de celle-ci. Et il leur donne à tous de l’argent.
Le récit dit que les ouvriers de la première heure sont déçus: ils ne voient pas la beauté du geste du patron, qui n’a pas été injuste, mais simplement généreux, il n’a pas seulement considéré le mérite, mais aussi le besoin. Dieu veut donner à tous son Royaume, c’est-à-dire une vie pleine, éternelle et heureuse. Et c’est ainsi que Jésus fait avec nous: il ne fait pas de classement, à qui lui ouvre son cœur il Se donne tout entier.
A la lumière de cette parabole, le chrétien d’aujourd’hui pourrait être tenté de penser: «Pourquoi commencer à travailler immédiatement? Si la rémunération est la même, pourquoi travailler plus?». A ces doutes, saint Augustin répondait ain-si: «Pourquoi donc tardes-tu à suivre celui qui t’appelle, alors que tu es sûr de la rémunération mais incertain du jour? Prends garde de ne pas te priver toi-même, à force de repousser ce qu’il te donnera selon sa promesse»1.
Je voudrais dire, surtout aux jeunes, de ne pas attendre, mais de répondre avec enthousiasme au Seigneur qui nous appelle à travailler dans sa vigne. Ne pas tarder, retrousse les manches, car le Seigneur est généreux et tu ne seras pas déçu! En travaillant dans sa vigne, tu trouveras une ré-ponse à cette interrogation profonde que tu portes en toi: quel est le sens de ma vie?
Chers frères et sœurs, ne nous décourageons pas! Même dans les moments sombres de la vie, quand le temps passe sans nous donner les répon-ses que nous cherchons, demandons au Seigneur de sortir à nouveau et de nous rejoindre là où nous l’attendons. Le Seigneur est généreux et il viendra aussitôt!
1Discours 87, 6, 8.
A l’issue de l’Audience générale, le Saint-Père a prononcé les appels suivants:
J’adresse une cordiale bienvenue aux pèlerins. Chers frères et sœurs, ne vous lassez pas de vous confier au Christ et de l’annoncer avec votre vie en famille et dans chaque contexte. C’est ce que les hommes, aujourd’hui encore, attendent de l’Eglise.
Dans le climat de préparation de la Solennité de la Pentecôte, qui est désormais proche, je vous exhorte à être toujours dociles à l’action de l’Esprit Saint, en en évoquant la lumière et la force.
Je vous accorde à tous ma bénédiction!
Parmi les groupes ayant assisté à l’Audience générale étaient présents les groupes francophones suivants:
De France: Motards chrétiens Notre-Dame, de Solliès-Pont; et de Lyon.
Du Tchad: Groupe de pèlerins du diòcese de Doba, avec S.E. Mgr Martin Waingue Bani.
Du Cameroun: groupe de pèlerins.
Je salue cordialement les personnes de langue française, venues de France, du Tchad et du Cameroun, en particulier les pèlerins du diocèse de Boba et le groupe des Motards Chrétiens Notre-Dame. Notre monde peine à trouver une valeur à la vie humaine, même en sa dernière heure: que l’Esprit du Seigneur éclaire nos intelligences, pour que nous sachions défendre la dignité in-trinsèque de toute personne humaine. Que Dieu vous bénisse.
Discours à la Secrétairerie d’Etat
Salle Clémentine, 5 juin 2024
Incarnés dans le temps
avec un regard universel
Eminence Monsieur le cardinal Parolin,
Excellences, chers frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce,
chères sœurs et chers frères!
Je remercie tout d’abord le secrétaire d’Etat pour ces paroles introductives et pour la collaboration constante qu’il m’offre alors que je fais les premiers pas de ce pontificat.
Je suis très heureux d’être parmi vous qui offrez un service précieux à la vie de l’Eglise en m’aidant à mener à bien la mission qui m’a été confiée. En effet, comme l’affirme Praedicate Evangelium, la Secrétairerie d’Etat, en tant que secrétariat papal dirigé par le secrétaire d’Etat, assiste étroitement le Pontife Romain dans l’exercice de sa mission suprême (cf. art. 44-45).
Je suis réconforté de savoir que je ne suis pas seul et que je peux partager avec vous la respon-sabilité de mon ministère universel.
Ce n’est pas dans le texte, mais je dis très sincèrement qu’au cours de ces quelques semaines — cela ne fait pas encore un mois que je suis au service du ministère pétrinien —, il est évident que le Pape ne peut pas aller de l’avant seul et qu’il est indispensable et absolument nécessaire de pouvoir compter sur la collaboration de nombreuses personnes du Saint-Siège, mais d’une manière spéciale sur vous tous, membres de la Secrétairerie d’Etat. Je vous en remercie de tout cœur.
L’histoire de cette Institution remonte, comme nous le savons, à la fin du XVe siècle. Au fil du temps, elle a pris un caractère de plus en plus universel et s’est considérablement développée, acquérant progressivement de nouvelles fonctions, en raison des nouvelles exigences tant dans le domaine ecclésial que dans les relations avec les Etats et les organisations Internationales. Actuellement, près de la moitié d’entre vous sont des fidèles laïcs. Et les femmes, laïques et religieuses, sont plus de cinquante.
Cette évolution a fait que la Secrétairerie d’Etat reflète aujourd’hui le visage de l’Eglise. Il s’agit d’une grande communauté qui travaille aux côtés du Pape: ensemble, nous partageons les questions, les difficultés, les défis et les espérances du Peuple de Dieu présent dans le monde entier. Nous le faisons en exprimant toujours deux dimensions essentielles: l’incarnation et la catholicité.
Nous sommes incarnés dans le temps et dans l’histoire, car si Dieu a choisi la voie de l’humain et les langues des hommes, l’Eglise est appelée elle aussi à suivre cette voie, afin que la joie de l’Evangile puisse atteindre tout le monde et être transmise dans les cultures et les langages actuels. Et, en même temps, nous cherchons toujours à garder un regard catholique, universel, qui nous permette de valoriser les différentes cultures et sen-sibilités. Nous pouvons ainsi être un centre moteur qui s’engage à tisser la communion entre l’Eglise de Rome et les Eglises locales, ainsi que les relations d’amitié au sein de la Communauté internationale.
Au cours des dernières décennies, ces deux dimensions — être incarnés dans le temps et avoir un regard universel — sont devenues de plus en plus constitutives du travail de la Curie. C’est dans cette voie que nous a orientés la réforme de la Curie romaine menée par saint Paul VI qui, s’inspirant de la vision du Concile Vatican II, ressentit avec force l’urgence que l’Eglise soit attentive aux défis de l’histoire, compte tenu de «la rapidité de la vie d’aujourd’hui» et des «mutations de notre temps» (Regimini Ecclesiae universae, 15 août 1967). En même temps, il réaffirma la nécessité d’un service qui exprime la catholicité de l’Eglise, et à cette fin, il disposa que «ceux qui sont présents au Siège apostolique pour le gouverner soient appelés de toutes les parties du monde» (ibid.).
L’incarnation nous renvoie donc à la réalité concrète et aux thèmes spécifiques et particuliers traités par les différents organes de la Curie; tandis que l’universalité, en rappelant le mystère de l’unité multiforme de l’Eglise, exige ensuite un travail de synthèse qui puisse aider l’action du Pape. Et le maillon de liaison et de synthèse, c’est précisément la Secrétairerie d’Etat. En effet, Paul VI — grand connaisseur de la Curie romaine — voulut donner à ce service une nouvelle structure, en le constituant de fait comme point de liaison et en lui conférant son rôle fondamental de coordination des autres Dicastères et Institutions du Siège apostolique.
Ce rôle de coordination de la Secrétairerie d’Etat est repris dans la récente Constitution apostolique Praedicate Evangelium, parmi les multiples tâches confiées à la Section pour les affaires générales, sous la direction du Substitut avec l’aide de l’assesseur (cf. art. 45- 46). A côté de la Section pour les affaires générales, la même Constitution identifie la Section pour les Relations avec les Etats et les Organisations internationales, dirigée par le secrétaire avec l’aide des deux sous--secrétaires, qui est chargée des relations diplomatiques et politiques du Siège apostolique avec les Etats et les autres sujets de droit international dans cette période délicate de l’histoire. La Section pour le personnel diplomatique, avec son secrétaire et son sous-secrétaire, s’occupe quant à elle des représentations pontificales et des membres du Corps diplomatique ici à Rome et dans le monde.
Je sais que ces tâches sont très exigeantes et qu’elles peuvent parfois être mal comprises. C’est pourquoi je tiens à vous exprimer ma proximité et, surtout, ma vive gratitude. Merci pour les compétences que vous mettez au service de l’Eglise, pour votre travail presque toujours caché et pour l’esprit évangélique qui l’inspire. Et permettez-moi, précisément en raison de ma reconnaissance, de vous adresser une exhortation en me référant encore à saint Paul VI: que ce lieu ne soit pas pollué par des ambitions ou des antagonismes; soyez au contraire une véritable communauté de foi et de charité, «de frères et de fils du Pape», qui se dépensent généreusement pour le bien de l’Eglise (cf. Discours à la Curie romaine, 21 septembre 1963).
Je vous confie tous à l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, et, tout en vous remerciant de prier chaque jour pour moi — je l’espère — je vous bénis de tout cœur, ainsi que vos proches et votre travail. Merci!
Message aux prêtres de la Province ecclésiastique de Paris
réunis pour le Jubilé des prêtres
Toucher le cœur de ceux
qui sont au plus loin
Je salue fraternellement S.Exc. Mgr Laurent Ulrich ainsi que tous les évêques de la Province de Paris. Et je vous salue tous, chers prêtres qui vous réunissez en cette cathédrale Notre-Dame à l’occasion de votre «Jubilé des prêtres» et du 60e anniversaire de la Constitution Presbyterorum ordinis sur laquelle vous allez réfléchir.
Je suis heureux de pouvoir vous manifester ma paternelle affection et de vous transmettre mes meilleurs encouragements pour la poursuite de votre ministère au service du Peuple de Dieu qui vous est confié. Pour y parvenir dans les conditions ecclésiales et sociales difficiles — et bien souvent éprouvantes — que vous connaissez, je vous invite à enraciner votre vie et votre ministère dans un amour toujours plus fort, personnel et authentique de Jésus qui a fait de vous ses amis et qui vous a configurés à Lui pour l’éternité; et dans un amour généreux et sans réserve pour vos Communautés, un amour empreint de proximité, de compassion, de douceur, d’humilité et de simplicité, comme l’a si souvent rappelé le regretté Pape François. De cette manière, vous serez crédibles même si vous n’êtes pas encore des saints, et vous toucherez le cœur de personnes qui sont au plus loin, gagnerez leur confiance et leur ferez rencontrer Jésus. Je vous invite à cultiver la fraternité sacerdotale entre vous, à maintenir un étroit lien de charité avec vos évêques et à prier sans cesse pour l’unité de l’Eglise. Que le Saint-Esprit vous aide à renouveler chaque jour le don généreux que vous avez fait de vous-mêmes au Seigneur le jour de votre ordination.
Implorant sur chacun de vous la protection de Notre-Dame, et l’intercession de tous les saints prêtres et évêques de Paris qui vous ont précédés, je vous accorde de grand cœur la Bénédiction apostolique.
Du Vatican, le 4 juin 2025
Léon PP. XIV
Discours aux membres
de trois instituts religieux
pour leur chapitre général
Salle du Consistoire, 6 juin 2025
Conversion, mission, miséricorde
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Que la paix soit avec vous.
Chers frères et sœurs, bienvenue!
Je salue les supérieurs généraux présents, spécialement ceux qui viennent d’être élus, les membres des organes de gouvernement et vous tous, qui appartenez au Tiers-Ordre régulier de Saint François — qui est le nouveau général? Il a été élu?… Ah, pas encore, très bien — puis à la Société des missions africaines et à l’Institut des Serviteurs du Paraclet.
Beaucoup d’entre vous assistent à cette rencontre à l’occasion de vos Chapitres généraux, à un moment important pour votre vie et pour celle de toute l’Eglise. Prions donc tout d’abord le Seigneur pour vos instituts et pour toutes les personnes consacrées, car «ne cherchant avant tout que Dieu seul, unissent la contemplation par laquelle ils adhèrent à lui de cœur et d’esprit, et l’amour apostolique qui s’efforce de s’associer à l’œuvre de la Rédemption» (Conc. œcum. Vat. II, Décr. Perfectae caritatis, n. 5).
Vous qui représentez trois réalités charismatiques nées dans des moments différents de l’histoire de l’Eglise, en réponse aux exigences contingentes de nature variée, mais unies et complémentaires dans la beauté harmonieuse du Corps mystique du Christ. (cf. Id., Const. dogm. Lumen gentium, n. 7).
La fondation la plus ancienne, parmi celles ici présentes, est le Tiers-Ordre de Saint François, dont les débuts remontent au saint d’Assise, qui fut ensuite élevée au rang d’Ordre par le Pape Nicolas V (cf. Bulle Pastoralis officii, 20 juillet 1447). Les thèmes que vous affrontez lors de votre 113e Chapitre général — vie commune, formation et vocation — concernent un peu toute la grande famille de Dieu. Cependant, il est important, comme le dit le titre que vous avez donné à vos travaux, que vous les affrontiez à la lumière de votre charisme «pénitentiel». Cela nous rappelle en effet que — selon les paroles mêmes de saint François — c’est uniquement à travers une chemin de conversion que nous pouvons offrir aux frères les «paroles parfumées de notre Seigneur Jésus-Christ» (Première lettre aux fidèles, n. 19).
La Société des missions africaines, plus récente, a été fondée le 8 décembre 1856 par le vénérable évêque Melchior de Marion Brésillac, signe de ce caractère missionnaire qui se situe au cœur même de la vie de l’Eglise (cf. François, Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 273). L’histoire de votre institut, chers frères, témoigne bien de cette vérité: la fidélité à la mission, en effet, vous aidant à surmonter dans le temps de nombreuses difficultés internes et externes à vos communautés, vous a permis de grandir, en faisant au contraire de vos difficultés une occasion et une inspiration pour partir vers de nouveaux horizons apostoliques en Afrique, puis dans d’autres parties du monde. A ce propos, l’exhortation laissée par votre fondateur à rester fidèles, dans l’annonce, à la simplicité de la prédication apostolique et, dans le même temps, à être toujours prêts à embrasser «la folie de la Croix» (cf. 1 Co 1, 17-25), est très belle: simples et sereins, même face aux incompréhensions et aux moqueries du monde. Libres de tout conditionnement car «comblés» par le Christ, et capables de conduire les frères vers la rencontre avec Lui parce qu’animés par une seule aspiration: annoncer au monde son Evangile (cf. Ph 1, 12-14.21). Quel grand signe pour toute l’Eglise et pour le monde entier!
Et nous arrivons à l’Institut dont la fondation est la plus récente: les Serviteurs du Paraclet. Serviteurs de l’Esprit qui habite en nous (cf. Rm 8, 9) pour le don du baptême et qui guérit quod est saucium — ce qui est blessé — comme nous le chanterons dans quelques jours dans la Séquence de Pentecôte. Serviteurs de l’Esprit qui guérit: c’est ainsi que vous a voulus votre père Gerald Fitzgerald, qui en 1942, a donné naissance à votre œuvre pour le soin des prêtres en difficulté, Pro Christo sacerdote, comme le dit votre devise (cf. Constitutions, 4, 4). Depuis lors, vous exercez dans différentes parties du monde votre ministère de proximité humble, patiente, délicate et discrète envers les personnes profondément blessées, en leur proposant des parcours thérapeutiques qui, à une simple et intense vie spirituelle, personnelle et communautaire, allient une assistance professionnelle hautement qualifiée, qui se différencie selon les besoins. Votre présence nous rappelle également une chose importante: nous tous, bien qu’appelés à être pour nos frères et nos sœurs des ministres du Christ, médecin des âmes (cf. Lc 5, 31-32), nous sommes avant tout, à notre tour, des malades ayant besoin de guérison. Comme le dit saint Augustin, en utilisant l’image d’une barque, «dans le cours de cette vie, notre mortalité, notre fragilité laissent en nous comme des ouvertures qui donnent entrée au péché, sous la pression des vagues de ce siècle» (Sermon 278, 13, 13). Et le saint évêque d’Hippone propose un remède au mal: «Jetons-nous donc sur cette décision comme sur une urne pour rejeter l’eau du navire et ne pas faire naufrage. Pardonnons!» (ibid.). Pardonnons, car partout, «dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde» (François, Bulle Misericordiae Vultus, 11 avril 2015, n. 12).
Chers amis, merci de votre visite, qui aujourd’hui dans cette salle nous montre l’Eglise en trois di-mensions lumineuses de sa beauté: l’engagement de la conversion, l’enthousiasme de la mission et la chaleur de la miséricorde. Merci pour le grand travail que vous faites, dans le monde entier. Je vous bénis et je prie pour vous, dans cette neuvaine de Pentecôte, afin que vous puissiez être toujours plus des instruments dociles de l’Esprit Saint selon les projets de Dieu. Merci.
Discours aux mouvements ecclésiaux
Salle Clémentine, 6 juin 2025
Comme le Christ enrichir
les autres en se dépouillant de soi
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Que la paix soit avec vous!
Monsieur le cardinal, chers frères dans l’épiscopat,
chers frères et sœurs!
Je suis heureux de vous accueillir à l’occasion de la rencontre annuelle organisée par le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie avec vous, modérateurs, responsables internationaux et délégués des groupements ecclésiaux reconnus ou fondés par le Saint-Siège.
Vous représentez des milliers de personnes qui vivent leur expérience de foi et leur apostolat au sein d’associations, de mouvements et de communautés. C’est pourquoi je désire avant tout vous remercier pour le service de guide et d’animation que vous accomplissez. Soutenir et encourager nos frères sur le chemin chrétien comporte des responsabilités, un engagement, et souvent également des difficultés et des incompréhensions, mais c’est un devoir indis-pensable et de grande valeur. L’Eglise vous est reconnaissante pour tout le bien que vous faites.
Le don de la vie associative et des charismes
Les associations auxquelles vous appartenez sont très différentes les unes des autres, de par leur nature et leur histoire, et toutes sont importantes pour l’Eglise. Certaines sont nées pour partager un objectif apostolique, caritatif, de culte, ou pour soutenir le témoignage chrétien dans des milieux sociaux spécifiques. D’autres, en revanche, ont tiré leur origine d’une inspiration charismatique, d’un charisme initial qui a donné vie à un mouvement, à une nouvelle forme de spiritualité et d’évangélisation.
Dans la volonté de s’associer, qui est à l’origine du premier type de groupements, se trouve une vérité fondamentale: nul n’est chrétien seul! Nous faisons partie d’un peuple, d’un corps que le Seigneur a constitué. Saint Augustin, en parlant des premiers disciples de Jésus, disait: «Ils devinrent sans aucun doute le temple de Dieu; et non seulement chacun d'eux était le temple du Seigneur, mais ils l'étaient tous ensemble» (En. in Ps. 131, 5). La vie chrétienne ne se vit pas dans l’isolement, comme si elle était une aventure intellectuelle ou sentimentale, enfermée dans notre esprit ou notre cœur. Elle se vit avec les autres, dans un groupe, une communauté, car le Christ ressuscité se rend présent parmi les disciples réunis en son nom.
L’apostolat associé des fidèles a été vivement encouragé par le Concile Vatican II, en particulier dans le Décret sur l’apostolat des laïcs qui affirme, entre autres, qu’il est «très important parce que souvent, soit dans les communautés ecclésiales, soit dans les divers milieux de vie, l’apostolat requiert une action d’ensemble. Les organisations créées pour un apostolat collectif soutiennent leurs membres, les forment à l’apostolat, ordonnent et dirigent leur action apostolique de telle sorte qu’on puisse en espérer des résultats beaucoup plus importants que si chacun agissait isolément» (n. 18).
Il y a ensuite les réalités nées d’un charisme: le charisme d’un fondateur ou d’un groupe d’initiateurs, ou encore le charisme qui s’inspire d’un institut religieux. Cela aussi est une dimension essentielle de la vie de l’Eglise. Je voudrais vous inviter à con-sidérer les charismes en référence à la grâce, au don de l’Esprit. Dans la Lettre Iuvenescit Ecclesia, que vous connaissez bien, il est dit que la hiérarchie ecclésiastique et le sacrement de l’Ordre existent pour que demeure toujours vivante parmi les fidèles «l’offre objective de la grâce» qui est donnée au moyen «des sacrements, de l’annonce normative de la Parole de Dieu et de la sollicitude de ses pasteurs» (n. 14).
Les charismes, en revanche, «sont distribués librement par l’Esprit Saint, afin que la grâce sacramentelle porte du fruit dans la vie chrétienne de façon diversifiée et à tous ses niveaux» (n. 15).
Ainsi, tout dans l’Eglise se comprend en référence à la grâce: l’institution existe afin que la grâce soit toujours offerte, les charismes sont suscités afin que cette grâce soit accueillie et porte du fruit. Sans les charismes, il y a le risque que la grâce du Christ, offerte en abondance, ne trouve pas un bon terrain pour la recevoir! Voilà pourquoi Dieu suscite les charismes, afin qu’ils réveillent dans les cœurs le désir de la rencontre avec le Christ, la soif de la vie divine qu’Il nous offre, en un mot, la grâce!
Je désire ainsi répéter, dans la lignée de mes prédécesseurs et avec le Magistère de l’Eglise, surtout à partir du Concile Vatican II, que les dons hiérarchiques et les dons charismatiques sont «coessentiels à la constitution divine de l'Eglise fondée par Jésus» (saint Jean-Paul II, Message au Congrès mondial des mouvements ecclésiaux, 27 mai 1998). Grâce aux charismes qui ont donné naissance à vos mouvements et à vos communautés, beaucoup de personnes se sont rapprochées du Christ, ont retrouvé l’espérance dans la vie, ont découvert la maternité de l’Eglise, et désirent être aidées à croître dans la foi, dans la vie communautaire, dans les œuvres de charité, et apporter aux autres, à travers l’évangélisation, le don qu’elles ont reçu.
Unité et mission, en union avec le Pape
L’unité et la mission sont deux piliers de la vie de l’Eglise, et deux priorités du ministère pétrinien. C’est pourquoi j’invite toutes les associations et mouvements ecclésiaux à collaborer fidèlement et généreusement avec le Pape, en particulier dans ces deux domaines.
Tout d’abord, en étant ferment d’unité. Vous faites tous constamment l’expérience de la communion spirituelle qui vous unit. C’est la communion que l’Esprit Saint crée dans l’Eglise. C’est une unité qui a son fondement dans le Christ: Il nous attire, nous attire à lui et nous unit ainsi entre nous. Saint Paulin de Nole l’évoquait ainsi en écrivant à saint Augustin: «Nous avons un même chef, nous sommes favorisés par la même grâce, nous sommes nourris du même pain; nous marchons dans la même voie, nous demeurons dans la même maison […] nous sommes unis dans l’esprit et dans le corps du même Seigneur, duquel nous ne pouvons nous séparer sans périr» (Lettre, 30, 2).
Cette unité, que vous vivez dans les groupes et dans les communautés, étendez-la partout: dans la communion avec les pasteurs de l’Eglise, dans la proximité avec les autres réalités ecclésiales, en devenant proches des personnes que vous rencontrez, afin que vos charismes demeurent toujours au service de l’unité de l’Eglise et soient eux aussi «levain d’unité, de communion, de fraternité» (Homélie, 18 mai 2025) dans le monde si déchiré par la discorde et par la violence.
En second lieu, la mission. La mission a marqué mon expérience pastorale et a façonné ma vie spirituelle. Vous aussi, vous avez fait l’expérience de ce chemin. De la rencontre avec le Seigneur, de la vie nouvelle qui a envahi votre cœur, est né le désir de le faire connaître aux autres. Et vous avez touché tant de personnes, consacré beaucoup de temps, d’enthousiasme et d’énergie pour faire connaître l’Evangile dans les lieux les plus éloignés, dans les milieux les plus difficiles, en supportant les difficultés et les échecs. Gardez toujours vivants entre vous cet élan missionnaire: les mouvements ont aujourd’hui également un rôle fondamental pour l’évangélisation. Il y a parmi vous des personnes généreuses, bien formées, avec une expérience «sur le terrain». Il s’agit d’un patrimoine à faire fructifier, en demeurant à l’écoute de la réalité actuelle avec ses nouveaux défis. Placez vos talents au service de la mission, tant dans les lieux de première évangélisation que dans les paroisses et dans les structures ecclésiales locales, pour atteindre tous ceux qui sont loin et, parfois sans le savoir, attendent la Parole de vie.
Conclusion
Chers amis, je suis heureux de vous rencontrer aujourd’hui pour la première fois. Si Dieu le veut nous aurons d’autres occasions de mieux nous connaître, mais je vous encourage dès à présent à poursuivre votre chemin. Gardez toujours le Seigneur Jésus au centre! C’est l’essentiel, et les charismes eux-mêmes servent à cela. Le charisme sert à la rencontre avec le Christ, à la croissance et à la maturation humaine et spirituelle des personnes, à l’édification de l’Eglise. Dans ce sens, tous sont appelés à imiter le Christ, qui se dépouilla pour nous enrichir (cf. Ph 2, 7). Ainsi, quiconque poursuit avec d’autres une finalité apostolique ou quiconque est porteur d’un charisme est appelé à enrichir les autres, en se dépouillant de soi. Et cela est source de liberté et de grande joie.
Merci pour ce que vous êtes et aussi pour ce que vous faites! Je vous confie à la protection de Marie Mère de l’Eglise et je vous bénis tous de tout cœur, ainsi que ceux que vous représentez. Merci!
Discours aux participants
au Symposium œcuménique
pour les 1700 ans du Concile de Nicée
Salle Clémentine, 7 juin 2025
Nicée, boussole vers la pleine unité visible de tous les chrétiens
La Paix soit avec vous!
Eminences, Excellences,
Mesdames et Messieurs les professeurs,
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à tous qui participez au Symposium «Nicée et l’Eglise du troisième millénaire: Vers l’unité catholique-orthodoxe», organisé conjointement par «Œcumenicum» — l’Institut d’études œcuméniques de l’«Angelicum» — et l’Association théologique orthodoxe internationale. Je salue particulièrement les représentants des Eglises ortho-doxes et orthodoxes orientales, dont beaucoup m’ont fait l’honneur de leur présence à la Messe d’inauguration de mon pontificat.
Avant de poursuivre mon discours officiel, je tiens à m’excuser pour mon léger retard et à vous demander de bien vouloir faire preuve de patience à mon égard. Je ne suis pas encore dans mes fonctions depuis un mois (rires), j’ai donc beaucoup à apprendre. Mais je suis très heureux d’être parmi vous ce matin.
Je suis heureux de constater que le Symposium est résolument tourné vers l’avenir. Le Concile de Nicée n’est pas seulement un événement du passé, mais une boussole qui doit continuer à nous guider vers la pleine unité visible des chrétiens. Le premier Concile œcuménique est fondement du chemin commun que catholiques et ortho-doxes ont entrepris ensemble depuis le concile Vatican II. Pour les Eglises orientales qui commémorent sa célébration dans leur calendrier liturgique, le Concile de Nicée n’est pas simplement un Concile parmi d’autres ou le premier d’une série, mais le Concile par excellence, qui a promulgué la norme de la foi chrétienne, la profession de foi des «318 Pères».
Les trois thèmes de votre Symposium sont particulièrement pertinents pour notre cheminement œcuménique. Premièrement, la foi de Nicée. Comme l’a fait remarquer la Commission théologique internationale dans son récent document pour le 1700e anniversaire de Nicée, l’année 2025 représente «une occasion inestimable de souligner que ce que nous avons en commun est beaucoup plus fort, quantitativement et qualitativement, que ce qui nous divise. Ensemble, nous croyons au Dieu Trinitaire, au Christ vrai homme et vrai Dieu, et au salut par Jésus-Christ, selon les Ecritures lues dans l’Eglise et sous la motion de l’Esprit Saint. Ensemble, nous croyons en l’Eglise, au baptême, à la résurrection des morts et à la vie éternelle» (cf. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, n. 43). Je suis convaincu qu’en revenant au Concile de Nicée et en puisant ensemble à cette source commune, nous pourrons voir sous un autre jour les points qui nous séparent encore. Par le dialogue théologique et avec l’aide de Dieu, nous parviendrons à mieux comprendre le mystère qui nous unit. En célébrant ensemble cette foi de Nicée et en la proclamant ensemble, nous avancerons aussi vers la restauration de la pleine communion entre nous.
Le second thème de votre symposium est la synodalité. Le Concile de Nicée a inauguré un chemin synodal que l’Eglise doit suivre pour traiter les questions théologiques et canoniques au niveau universel. La contribution des frères délégués des Eglises et des communautés ecclésiales d’Orient et d’Occident au récent Synode sur la synodalité, qui s’est tenu ici au Vatican, a été un stimulant précieux pour une plus grande ré-flexion sur la nature et la pratique de la synodalité. Le Document final du Synode a noté que «le dialogue œcuménique est fondamental pour développer notre compréhension de la synodalité et de l’unité de l’Eglise» et a poursuivi en encourageant le développement de «pratiques synodales œcuméniques, y compris des formes de con-sultation et de discernement sur des questions urgentes et d’intérêt commun» (Pour une Eglise synodale: communion, participation, mission, n. 138). J’espère que la préparation et la commémoration commune du 1700e anniversaire du Concile de Nicée seront une occasion providentielle «d’approfondir et de professer ensemble notre foi dans le Christ et de mettre en pratique des formes de synodalité parmi les chrétiens de toutes les traditions» (cf. ibid., n. 139).
Le Symposium a un troisième thème relatif à la date de la Pâques. Comme nous le savons, l’un des objectifs du Concile de Nicée était d’établir une date commune pour la Pâques afin d’exprimer l’unité de l’Eglise dans l’ensemble de l’oikoumene. Malheureusement, les différences de calendrier ne permettent plus aux chrétiens de célébrer ensemble la fête la plus importante de l’année liturgique, ce qui pose des problèmes pastoraux au sein des communautés, divise les familles et porte atteinte à la crédibilité de notre témoignage à l’Evangile. Plusieurs solutions concrètes ont été proposées qui, tout en respectant le principe de Nicée, permettraient aux chrétiens de célébrer ensemble la «Fête des Fêtes». En cette année où tous les chrétiens ont célébré Pâques le même jour, je réaffirme l’ouverture de l’Eglise catholique à la recherche d’une solution œcuménique favorisant une célébration commune de la résurrection du Seigneur et donnant ainsi une plus grande force missionnaire à notre prédication du «nom de Jésus et du salut qui naît de la foi en la vérité salvifique de l’Evangile» (Discours à l’Assemblée générale des Œuvres pontificales missionnaires, 22 mai 2025).
Frères et sœurs, à la veille de la Pentecôte, rappelons-nous que l’unité à laquelle les chrétiens aspirent ne sera pas d’abord le fruit de nos efforts ni ne se réalisera à travers un modèle ou un plan préconçu. L’unité sera plutôt un don reçu «comme le Christ le veut et par les moyens qu’il veut» («Prière pour l’unité» du père Paul Couturier), par l’action de l’Esprit Saint. Et maintenant je vous invite tous à vous lever afin que nous puissions prier ensemble pour implorer de l’Esprit le don de l’unité. La prière que je vais réciter implore l’unité de l’Esprit dans une prière qui est tirée de la tradition orientale:
«Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité,
Toi qui es partout présent et qui remplis tout;
Trésor des biens et donateur de vie,
Viens et demeure en nous, et purifie-nous de toute souillure,
Et sauve nos âmes, toi qui es bonté».
Amen.
Que le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et demeure avec vous pour toujours. Amen. Merci beaucoup.
Homélie pour la veillée de Pentecôte
avec les mouvements, les associations
et les communautés nouvelles
Place Saint-Pierre, samedi 7 juin 2025
Pèlerins de paix, pas prédateurs
Très chers frères et sœurs!
L’Esprit créateur que nous avons invoqué dans le chant — Veni creator Spiritus — est l’Esprit qui est descendu sur Jésus, le protagoniste silencieux de sa mission: «L’Esprit du Seigneur est sur moi» (Lc 4, 18). En lui demandant de visiter nos esprits, de multiplier nos langues, d’enflammer nos sens, d’infuser notre amour, de fortifier nos corps et de nous accorder la paix, nous nous sommes ouverts au Royaume de Dieu. C’est en cela que consiste la conversion selon l’Evangile: se tourner vers le Royaume désormais proche.
En Jésus nous voyons, et de Jésus nous entendons que tout est transformé, parce que Dieu règne, parce que Dieu est proche. En cette veille de Pentecôte, nous sommes profondément touchés par la proximité de Dieu, par son Esprit qui unit notre histoire à celle de Jésus. Nous sommes impliqués dans les choses nouvelles que Dieu fait, pour que sa volonté de vie se réalise et l’emporte sur les volontés de mort.
«Il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur» (Lc 4, 18-19). Nous sentons ici le parfum du chrême dont notre front a également été marqué. Le baptême et la confirmation, chers frères et sœurs, nous ont unis à la mission transformatrice de Jésus, au Royaume de Dieu. De même que l’amour nous rend familier le parfum de la personne aimée, de même nous reconnaissons ce soir en chacun le parfum du Christ. C’est un mystère qui nous étonne et nous fait réfléchir.
A la Pentecôte, Marie, les apôtres et les disciples qui étaient avec eux ont été investis par un Esprit d’unité, enracinant à jamais leurs différences dans l’unique Seigneur Jésus-Christ. Non pas plusieurs missions, mais une seule. Non pas introvertis et querelleurs, mais extravertis et lumineux. Cette Place Saint-Pierre, qui est comme une étreinte ouverte et accueillante, exprime magnifiquement la communion de l’Eglise, vécue par chacun d’entre vous dans vos différentes expériences associatives et communautaires, dont beau-coup sont des fruits du Concile Vatican II.
Le soir de mon élection, en regardant avec émotion le peuple de Dieu ici réuni, je me suis souvenu du mot «synodalité», qui exprime bien la manière dont l’Esprit façonne l’Eglise. Dans ce mot résonne le syn — l’avec — qui constitue le secret de la vie de Dieu. Dieu n’est pas seul. Dieu est «avec» en Lui-même — Père, Fils et Saint-Esprit — et Il est Dieu avec nous. En même temps, la synodalité nous rappelle la route — odós — parce que là où il y a l’Esprit, il y a le mouvement, il y a le cheminement. Nous sommes un peuple en chemin. Cette conscience ne nous éloigne pas de l’humanité, mais nous y plonge, comme le levain dans la pâte, qui la fait toute fermenter. L’année de grâce du Seigneur, dont le Jubilé est l’expression, porte en elle ce ferment. Dans un monde déchiré et sans paix, l’Esprit Saint nous éduque en effet, à marcher ensemble. La terre se reposera, la justice s’affirmera, les pauvres se réjouiront, la paix reviendra si nous ne nous déplaçons plus en prédateurs, mais en pèlerins. Non plus chacun pour soi, mais en harmonisant nos pas avec ceux des autres. Ne pas consommer le monde avec voracité, mais le cultiver et le préserver, comme nous l’enseigne l’encyclique Laudato si’.
Chers amis, Dieu a créé le monde pour que nous soyons ensemble. La «synodalité» est le nom ecclésial de cette conscience. C’est le chemin qui demande à chacun de reconnaître sa dette et son trésor, en se sentant partie d’un tout, en dehors duquel tout s’étiole, même le plus original des charismes. Voyez-vous: la Création tout entière n’existe que dans le fait d’être ensemble, ce qui est parfois dangereux, mais toujours être ensemble (cf. Laudato si’ , nn. 16, 117). Et ce que nous appelons «histoire» ne prend forme que dans la modalité du rassemblement, du vivre ensemble, souvent plein de désaccords, mais toujours un vivre ensemble. Le contraire est mortel, et se trouve malheureusement sous nos yeux, tous les jours. Que vos agrégations et vos communautés soient donc des gymnases de fraternité et de participation, non seulement comme des lieux de rencontre, mais comme des lieux de spiritualité. L’Esprit de Jésus change le monde, parce qu’il change les cœurs. Il inspire cette dimension contemplative de la vie qui vainc l’affirmation de soi, la médisance, l’esprit de discorde, la domination des -consciences et des ressources. Le Seigneur est Esprit et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté (cf. 2 Co 3, 17). La spiritualité authentique invite donc au développement humain intégral, en actualisant au milieu de nous la parole de Jésus. Là où cela se produit, il y a la joie. La joie et l’espérance.
L’évangélisation, chers frères et sœurs, n’est pas une conquête humaine du monde, mais la grâce infinie qui se répand à partir de vies transformées par le Royaume de Dieu. C’est le chemin des Béatitudes, un chemin que nous parcourons ensemble, tendus entre le «déjà» et le «pas encore», affamés et assoiffés de justice, pauvres en esprit, miséricordieux, doux, au cœur pur, artisans de paix. Suivre Jésus sur le chemin qu’il a choisi ne nécessite pas de puissants partisans, de compromis mondains, de stratégies émotionnelles. L’évangélisation est l’œuvre de Dieu, et si elle passe parfois par nos personnes, c’est grâce aux liens qu’elle rend possibles. Soyez donc profondément attachés à chacune des Eglises particulières et des communautés paroissiales où vous nourrissez et dépensez vos charismes. Autour de vos évêques et en synergie avec tous les autres membres du Corps du Christ, nous agirons alors en harmonie. Les défis auxquels l’humanité est confrontée seront moins effrayants, l’avenir sera moins sombre, le discernement moins difficile. Si ensemble nous obéissons à l’Esprit Saint!
Que Marie, Reine des Apôtres et Mère de l’Eglise, intercède pour nous.
Homélie pour la Messe de Pentecôte
Place Saint-Pierre, 8 juin 2025
L’Esprit ouvre les frontières
et abat l’indifférence et la haine
Frères et sœurs,
«Le jour où […] le Seigneur Jésus-Christ, glorifié par son ascension au ciel après sa résurrection, a envoyé le Saint-Esprit, nous apparaît comme un jour heureux» (Saint Augustin, Discours 271, 1). Et aujourd’hui encore, ce qui s’est passé au Cénacle revit: le don de l’Esprit Saint descend sur nous comme un vent impétueux qui nous secoue, comme un bruit qui nous réveille, comme un feu qui nous éclaire (cf. Ac 2, 1-11).
Comme nous l’avons entendu dans la première Lecture, l’Esprit accomplit quelque chose d’extraordinaire dans la vie des Apôtres. Après la mort de Jésus, ils s’étaient enfermés dans la peur et la tristesse, mais maintenant ils reçoivent enfin un regard nouveau et une intelligence du cœur qui les aident à interpréter les événements qui se sont produits et à faire l’expérience intime de la présence du Ressuscité: l’Esprit Saint vainc leur peur, brise leurs chaînes intérieures, apaise leurs blessures, les oint de force et leur donne le courage d’aller à la rencontre de chacun pour annoncer les œuvres de Dieu.
Le passage des Actes des apôtres nous dit qu’à Jérusalem, à ce moment-là, il y avait une multitude de personnes de diverses origines, et pourtant «chacun d’eux les entendait dans son propre dialecte» (v. 6). C’est alors qu’à la Pentecôte, les portes du Cénacle s’ouvrent parce que l’Esprit ouvre les frontières. Comme l’affirme Benoît XVI: «L’Esprit Saint leur donne de comprendre. En surmontant la rupture initiale de Babel — la confusion des cœurs, qui nous élève les uns contre les autres — l’Esprit ouvre les frontières. […] L’Eglise doit toujours redevenir ce qu’elle est déjà: elle doit ouvrir les frontières entre les peuples et abattre les barrières entre les classes et les races. En son sein, il ne peut y avoir de personnes oubliées ou méprisées. Dans l’Eglise, il n’y a que des frères et des sœurs de Jésus Christ libres» (Homélie de Pentecôte, 15 mai 2005).
Voici une image éloquente de la Pentecôte sur laquelle j’aimerais m’arrêter avec vous pour méditer.
L’Esprit ouvre les frontières avant tout en nous. C’est le Don qui ouvre notre vie à l’amour. Et cette présence du Seigneur dissout nos duretés, nos fermetures, nos égoïsmes, les peurs qui nous bloquent, les narcissismes qui nous font tourner uniquement autour de nous-mêmes. Le Saint-Esprit vient défier en nous le risque d’une vie qui s’atrophie, aspirée par l’individualisme. Il est triste de constater que dans un monde où les occasions de socialiser se multiplient, nous risquons paradoxalement d’être davantage seuls, toujours connectés mais incapables de «créer des réseaux», toujours immergés dans la foule mais restant des voyageurs désorientés et solitaires.
Au contraire, l’Esprit de Dieu nous fait découvrir une nouvelle façon de voir et de vivre la vie: il nous ouvre à la rencontre avec nous-mêmes au-delà des masques que nous portons; il nous conduit à la rencontre avec le Seigneur en nous éduquant à faire l’expérience de sa joie; il nous convainc — selon les paroles mêmes de Jésus que nous venons de proclamer — que ce n’est qu’en restant dans l’amour que nous recevons aussi la force d’observer sa Parole et donc d’en être transformés. Il ouvre les frontières en nous, afin que notre vie devienne un espace accueillant.
L’Esprit ouvre également les frontières dans nos relations. En effet, Jésus dit que ce Don c’est l’amour entre Lui et le Père qui vient habiter en nous. Et lors-que l’amour de Dieu habite en nous, nous devenons capables de nous ouvrir à nos frères, de vaincre nos rigidités, de surmonter la peur de ceux qui sont différents, d’éduquer les passions qui s’agitent en nous. Mais l’Esprit transforme aussi les dangers les plus cachés qui polluent nos relations, comme les malentendus, les préjugés, les instrumentalisations. Je pense aussi — avec beau-coup de douleur — lors-qu’une relation est infestée par la volonté de dominer l’autre, une attitude qui débouche souvent sur la violence, comme le montrent malheureusement les nombreux cas récents de féminicide.
Le Saint-Esprit, quant à lui, fait mûrir en nous les fruits qui nous aident à vivre des relations authentiques et bonnes: «Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi» (Ga 5, 22-23). De cette manière, l’Esprit élargit les frontières de nos relations avec les autres et nous ouvre à la joie de la fraternité. Et cela est également un critère décisif pour l’Eglise: nous ne sommes vraiment l’Eglise du Ressuscité et les disciples de la Pentecôte que s’il n’y a ni frontières ni divisions entre nous, si, dans l’Eglise, nous savons dialoguer et nous accueillir mutuellement en intégrant nos différences ; si, en tant qu’Eglise, nous devenons un espace accueillant et hospitalier pour tous.
Enfin, l’Esprit ouvre également les frontières entre les peuples. A la Pentecôte, les apôtres parlent la langue de ceux qu’ils rencontrent et le chaos de Babel est enfin apaisé par l’harmonie produite par l’Esprit. Lors-que le Souffle divin unit nos cœurs et nous fait voir dans l’autre le visage d’un frère, les différences ne deviennent plus une occasion de division et de conflit, mais un patrimoine commun dont nous pouvons tous tirer parti et qui nous met tous en chemin, ensemble, dans la fraternité.
L’Esprit brise les frontières et abat les murs de l’indifférence et de la haine, car «il nous enseigne tout» et «nous rappelle les paroles de Jésus» (cf. Jn 14, 26); et, par conséquent, il enseigne, rappelle et grave avant tout dans nos cœurs le commandement de l’amour, que le Seigneur a placé au centre et au sommet de tout. Et là où il y a l’amour, il n’y a pas de place pour les préjugés, pour les distances de sécurité qui nous éloignent de notre prochain, pour la logique d’exclusion que nous voyons malheureusement émerger aussi dans les nationalismes politiques.
C’est précisément en célébrant la Pentecôte que le Pape François a fait remarquer qu’«aujourd’hui dans le monde, il y a beaucoup de discorde, beaucoup de divisions. Nous sommes tous reliés et pourtant nous nous trouvons déconnectés les uns des autres, anesthésiés par l’indifférence et opprimés par la solitude» (Homélie, 28 mai 2023). Les guerres qui agitent notre planète sont un signe tragique de tout cela. Invoquons l’Esprit d’amour et de paix, afin qu’il ouvre les frontières, abatte les murs, dissolve la haine et nous aide à vivre comme des enfants du seul Père qui est aux cieux.
Frères et sœurs, c’est la Pentecôte qui renouvelle l’Eglise et le monde! Que le vent puissant de l’Esprit vienne sur nous et en nous, ouvre les frontières de notre cœur, nous donne la grâce de la rencontre avec Dieu, élargisse les horizons de l’amour et soutienne nos efforts pour construire un monde où règne la paix.
Que Marie Très Sainte, Femme de la Pentecôte, Vierge visitée par l’Esprit, Mère pleine de grâce, nous accompagne et intercède pour nous.
Regina caeli
Place Saint-Pierre, 8 juin
Que les gouvernants promeuvent la détente et le dialogue
Avant de conclure cette célébration, je salue chaleureusement tous ceux qui ont participé et tous ceux qui se sont joints à nous par les moyens de communication.
Je remercie les cardinaux et les évêques présents, ainsi que tous les représentants des associations, des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles. Chères sœurs et chers frères, avec la force de l’Esprit Saint, repartez le cœur renouvelé après ce Jubilé. Allez et portez à tous l’espérance du Seigneur Jésus!
En Italie et dans d’autres pays, l’année scolaire s’achève ces jours-ci. Je souhaite saluer les jeunes et tous les étudiants et leurs professeurs, en particulier les étudiants qui, dans les prochains jours, passeront leurs examens de fin d’études.
Et maintenant, par l’intercession de la Vierge Marie, implorons du Saint-Esprit le don de la paix. Tout d’abord la paix dans les cœurs: seul un cœur pacifique peut répandre la paix, dans la famille, dans la société, dans les relations internationales. Que l’Esprit du Christ ressuscité ouvre des voies de réconciliation partout où il y a la guerre; qu’il éclaire les gouvernants et leur donne le courage d’accomplir des gestes de détente et de dialogue.
Homélie lors de la Messe
pour le Jubilé du Saint Siège
Basilique Saint-Pierre, 9 juin 2025
La fécondité de l’Eglise
dépend de la Croix
Chers frères et sœurs,
Aujourd’hui, nous avons la joie et la grâce de célébrer le jubilé du Saint-Siège en la mémoire liturgique de Marie, Mère de l’Eglise. Cette heureuse coïncidence est source de lumière et d’inspiration intérieure dans l’Esprit Saint qui, hier, jour de la Pentecôte, s’est répandu en abondance sur le Peuple de Dieu. Et dans ce contexte spirituel, nous vivons aujourd’hui une journée spéciale, d’abord avec la méditation que nous avons écoutée et maintenant, ici, à la table de la Parole et de l’Eucharistie.
La Parole de Dieu dans cette célébration nous fait comprendre le mystère de l’Eglise, et en elle du Saint-Siège, à la lumière des deux icônes bibliques écrites par l’Esprit dans les Actes des Apôtres (1, 12-14) et dans l’Evangile de Jean (19, 25-34).
Commençons par le récit fondamental, celui de la mort de Jésus. Jean, le seul des Douze présent au Calvaire, a vu et témoigné que sous la croix, avec les autres femmes, se trouvait la mère de Jésus (v. 25). Et il a entendu de ses oreilles les dernières paroles du Maître, parmi lesquelles celles-ci: «Femme, voici ton fils!», puis, s’adressant à lui: «Voici ta mère!» (v. 26-27).
La maternité de Marie, à travers le mystère de la Croix, a fait un bond en avant inimaginable: la mère de Jésus est devenue la nouvelle Eve, car le Fils l’a associée à sa mort rédemptrice, source de vie nouvelle et éternelle pour tout homme qui vient en ce monde. Le thème de la fécondité est très présent dans cette liturgie. La «collecte» l’a immédiatement mis en évidence en nous invitant à demander au Père que l’Eglise, soutenue par l’amour du Christ, «soit toujours plus féconde dans l’Esprit».
La fécondité de l’Eglise est la même que celle de Marie; elle se réalise dans l’existence de ses membres dans la mesure où ils revivent «en petit» ce qu’a vécu la Mère, c’est-à-dire qu’ils aiment selon l’amour de Jésus. Toute la fécondité de l’Eglise et du Saint-Siège dépend de la Croix du Christ. Autrement, ce ne serait qu’apparence, voire pire. Un grand théologien contemporain a écrit: «Si l’Eglise est l’arbre qui a poussé à partir du petit grain de sénevé de la croix, cet arbre est destiné à produire à son tour des grains de sénevé, et donc des fruits qui répètent la forme de la croix, car c’est précisément à la croix qu’ils doivent leur existence» (H.U. von Balthasar, Cordula ovverosia il caso serio, Brescia 1969, 45-46).
Dans la Collecte, nous avons également demandé que l’Eglise se réjouisse «de voir grandir en sainteté» ses enfants. En effet, cette fécondité de Marie et de l’Eglise est inséparablement liée à sa sainteté, c’est-à-dire à sa configuration au Christ. Le Saint-Siège est saint comme l’Eglise, dans son noyau originel, dans la fibre dont elle est tissée. Ainsi, le Siège apostolique conserve la sainteté de ses racines tout en étant gardé par elles. Mais il n’en est pas moins vrai qu’il vit aussi de la sainteté de chacun de ses membres. C’est pourquoi la meilleure façon de servir le Saint-Siège est de s’efforcer d’être saint, chacun selon son état de vie et la tâche qui lui est confiée.
Par exemple, un prêtre qui porte personnellement une lourde croix en raison de son ministère, et qui pourtant se rend chaque jour à son bureau et s’efforce de faire son travail du mieux qu’il peut avec amour et foi, ce prêtre participe et contribue à la fécondité de l’Eglise. De même, un père ou une mère de famille qui vit une situation difficile à la maison, un enfant qui a des soucis, ou un parent malade, et qui poursuit son travail avec engagement, cet homme et cette femme sont féconds dans la fécondité de Marie et de l’Eglise.
Nous en arrivons maintenant à la deuxième icône, celle écrite par saint Luc au début des Actes des Apôtres, qui représente la mère de Jésus avec les apôtres et les disciples au Cénacle (1, 12-14). Il nous montre la maternité de Marie à l’égard de l’Eglise naissante, une maternité «archétypale» qui reste d’actualité en tout temps et en tout lieu. Surtout, elle est toujours le fruit du mystère pascal, du don du Seigneur crucifié et ressuscité.
L’Esprit Saint qui descend avec puissance sur la première communauté est le même que celui que Jésus a rendu dans son dernier souffle (cf. Jn 19, 30). Cette icône biblique est inséparable de la première: la fécondité de l’Eglise est toujours liée à la Grâce qui a jailli du Cœur transpercé de Jésus avec le sang et l’eau, symbole des Sacrements (cf. Jn 19, 34).
Marie, au Cénacle, grâce à la mission maternelle reçue au pied de la croix, est au service de la communauté naissante: elle est la mémoire vivante de Jésus et, en tant que telle, elle est, pour ainsi dire, le pôle d’attraction qui harmonise les différences et rend d’un seul cœur la prière des disciples.
Les Apôtres, dans ce texte aussi, sont énumérés par leur nom et, comme toujours, le premier est Pierre (cf. v. 13). Mais c’est lui, le premier, qui est soutenu par Marie dans son ministère. De même, notre Mère l’Eglise soutient le ministère des Successeurs de Pierre par le charisme marial. Le Saint-Siège fait l’expérience très particulière de la présence de deux pôles, le pôle marial et le pôle pétrinien. Et c’est le pôle marial qui assure la fécondité et la sainteté du pôle pétrinien, par sa maternité, don du Christ et de l’Esprit.
Bien-aimés, louons Dieu pour sa Parole, lampe qui éclaire nos pas, ainsi que notre vie quotidienne au service du Saint-Siège. Eclairés par cette Parole, renouvelons notre prière: «Accorde, ô Père, à ton Eglise, soutenue par l’amour du Christ, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d’attirer à elle toutes les familles des peuples» (Collecte). Amen.
Discours aux représentants pontificaux
Salle Clémentine, 10 juin 2025
Instruments d’unité et de dignité
Eminences, Excellences, Messeigneurs,
Je vous salue tous, chers représentants pontificaux. Avant de partager le texte préparé, je voudrais seulement dire, à Son Eminence et à vous tous, que personne ne m’a suggéré les propos que j’ai tenus et que le cardinal a rapportés, j’y crois profondément: votre rôle, votre ministère est irremplaçable. Bien des choses ne pourraient se produire dans l’Eglise sans le sacrifice, le travail et tout ce que vous faites pour permettre à une dimension aussi importante de la grande mission de l’Eglise de se réaliser, et c’est précisément ce dont je parlais, à savoir la sélection des candidats à l’épiscopat. Merci du fond du cœur pour votre travail! A présent, je vous demande un peu de patience.
Après la célébration d’hier matin pour le Jubilé du Saint-Siège, je suis heureux de pouvoir passer quelques instants avec vous, qui êtes les représentants du Pape auprès des Etats et des Organisations internationales du monde entier.
Tout d’abord, je vous remercie d’être venus, d’avoir entrepris un voyage qui pour beaucoup d’entre vous a été long. Merci! Vous êtes, rien que par vos personnes, une image de l’Eglise catholique, car aucun pays au monde n’a un corps diplomatique aussi universel que le nôtre! Cependant, en même temps, je crois que l’on peut aussi dire qu’aucun pays au monde ne possède un corps diplomatique aussi uni que le vôtre: car votre communion, notre communion, n’est pas seulement fonctionnelle, ni seulement idéale, mais nous sommes unis dans le Christ et nous sommes unis dans l’Eglise. C’est intéressant de réfléchir à ce fait: la diplomatie du Saint-Siège constitue, par son personnel même, un modèle — certes imparfait, mais très significatif — du message qu’elle propose, celui de la fraternité humaine et de la paix entre tous les peuples.
Très chers, je fais mes premiers pas dans ce ministère que le Seigneur m’a confié. Et je ressens aussi envers vous ce que j’ai confié il y a quelques jours à la Secrétairerie d’Etat: de la gratitude envers ceux qui m’aident à accomplir mon service jour après jour. Cette gratitude est d’autant plus grande quand je pense — et je constate en affrontant les différentes questions — que votre travail me précède bon nombre de fois! Oui, et c’est particulièrement vrai pour vous. Car, lorsque l’on me soumet une situation qui concerne, par exemple, l’Eglise dans un pays particulier, je peux compter sur la documentation, les réflexions, les synthèses que vous et vos collaborateurs avez préparés. Le réseau des Représentations pontificales est toujours actif et opérationnel. C’est pour moi un motif de grande reconnaissance et de gratitude. Je dis cela en pensant bien évidemment à votre dévouement et à votre organisation, mais plus encore aux motivations qui vous guident, au style pastoral qui devrait nous caractériser, à l’esprit de foi qui nous anime. Grâce à ces qualités, je pourrai moi aussi faire l’expérience de ce qu’écrivait saint Paul VI, c’est-à-dire qu’à travers ses représentants, qui résident dans les différents pays, le -Pape participe à la vie même de ses enfants et, presque en s’intégrant dans celle-ci, il parvient à connaître leurs besoins et leurs aspirations de manière plus rapide et plus sûre, (cf. Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio Sollicitudo omnium Ecclesiarum, Introduction).
Et maintenant, je voudrais partager avec vous une image biblique qui m’est venue à l’esprit en pensant à votre mission par rapport à la mienne. Au début des Actes des Apôtres (3, 1-10), le récit de la guérison de l’infirme décrit bien le ministère de Pierre. Nous sommes à l’aube de l’expérience chrétienne et la première communauté, rassemblée autour des Apôtres, sait qu’elle ne peut compter que sur une seule réalité: Jésus, ressuscité et vivant. Un infirme, qui fait l’aumône, est assis à la porte du Temple. Cela semble être l’image d’une humanité qui a perdu espoir et s’est résignée. Aujourd’hui encore, l’Eglise rencontre souvent des hommes et des femmes qui n’ont plus de joie, que la société a marginalisés ou que la vie a, d’une certaine manière, contraints à mendier pour survivre. Voici ce que rapporte cette page des Actes: «Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit: “Regarde-nous”. Il tenait son regard attaché sur eux, s’attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit: “De l’argent et de l’or, je n’en ai pas, mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ le Nazaréen, marche!”. Et le saisissant par la main droite, il le releva. A l’instant ses pieds et ses chevilles s’affermirent; d’un bond il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le Temple, marchant, gambadant et louant Dieu» (3, 4-8).
La demande que Pierre adresse à cet homme fait réfléchir: «Regarde-nous!». Se regarder dans les yeux signifie construire une relation. Le ministère de Pierre consiste à créer des liens, des ponts; et un représentant du Pape se tient avant tout au service de cette invitation, de ce regard dans les yeux. -Soyez toujours le regard de Pierre! Soyez des hommes capables de construire des relations là où c’est le plus difficile. Mais ce faisant, gardez la même humilité et le même réalisme que Pierre, qui sait pertinemment qu’il n’a pas la solution à tout: «Je n’ai ni or ni argent», dit-il; mais il sait tout autant qu’il a l’essentiel, c’est-à-dire le Christ, le sens le plus profond de toute existence: «Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche!».
Donner le Christ signifie donner de l’amour, témoigner de cette charité prête à tout. Je compte sur vous pour que, dans les pays où vous vivez, chacun sache que l’Eglise est toujours prête à tout par amour, qu’elle est toujours du côté des derniers, des pauvres, et qu’elle défendra toujours le droit sacré de croire en Dieu, de croire que cette vie n’est pas à la merci des puissances de ce monde, mais qu’elle est traversée par un sens mystérieux. Seul l’amour est digne de foi, face à la douleur des innocents, des crucifiés d’aujourd’hui, que beaucoup d’entre vous connaissent personnellement parce qu’ils servent des peuples victimes de la guerre, de violences, d’injustices, ou même de ce faux bien-être qui trompe et déçoit.
Chers frères, soyez toujours consolés par le fait que votre service est toujours sub umbra Petri, comme il est gravé sur l’anneau que je vous offrirai. Sentez-vous toujours liés à Pierre, protégés par Pierre, envoyés par Pierre. Ce n’est que dans l’obéissance et dans une communion effective avec le Pape que votre ministère pourra être efficace pour l’édification de l’Eglise, en communion avec les évêques locaux.
Ayez toujours un regard bénissant, car le ministère de Pierre consiste à bénir, c’est-à-dire à toujours savoir voir le bien, même le bien caché, le bien minoritaire. Sentez-vous comme des missionnaires, envoyés par le Pape pour être des instruments de communion, d’unité, au service de la dignité de la personne humaine, favorisant partout des relations sincères et constructives avec les autorités avec lesquelles vous serez appelés à coopérer. Que votre compétence soit toujours illuminée par une ferme résolution à la sainteté. Nous avons pour exemple les saints qui ont fait parti du service diplomatique du Saint-Siège, tels que saint Jean XXIII et saint Paul VI.
Très chers amis, votre présence ici aujourd’hui renforce la conscience que le rôle de Pierre consiste à confirmer dans la foi. Vous les premiers avez besoin de cette confirmation pour en devenir des messagers, des signes visibles dans toutes les parties du monde.
Que la Porte Sainte que nous avons franchie tous ensemble hier matin nous incite à être des témoins courageux du Christ, qui est toujours notre espérance. Merci.
Audience générale
Place Saint-Pierre, 11 juin 2026
Ne jamais abandonner l’espérance
Chers frères et sœurs, bonjour!
Avec cette catéchèse, je voudrais porter notre regard sur un autre aspect essentiel de la vie de Jésus, à savoir ses guérisons. C’est pourquoi je vous invite à présenter au Cœur du Christ vos douleurs et vos fragilités, ces aspects de votre vie où vous vous sentez bloqués et immobilisés. Demandons avec confiance au Seigneur d’entendre notre cri et de nous guérir!
Le personnage qui nous accompagne dans cette réflexion nous aide à comprendre qu’il ne faut jamais abandonner l’espérance, même lorsque nous nous sentons perdus. Il s’agit de Bartimée, un aveugle et mendiant que Jésus rencontra à Jéricho (cf. Mc 10, 40-52). Le lieu est significatif: Jésus se rend à Jérusalem, mais il commence son -voyage, pour ainsi dire, depuis les «enfers» de Jéricho, ville située en-dessous du niveau de la mer. Jésus, en effet par sa mort, est allé chercher cet Adam qui est tombé et qui représente chacun de nous.
Bartimée signifie «fils de Timée»: il décrit cet homme à travers une relation, malgré cela celui-ci est dramatiquement seul. Ce nom pourrait toutefois aussi signifier «fils de l’honneur» ou «de l’admiration», exactement le contraire de la situation dans laquelle il se trouve1. Et comme le nom est aussi important dans la culture hébraïque, cela signifie que Bartimée ne parvient pas à vivre ce qu’il est appelé à être.
A la différence ensuite du grand mouvement de la foule marchant à la suite de Jésus, Bartimée est immobile. L’évangéliste dit qu’il est assis au bord de la route, il a donc besoin de quelqu’un qui le remette debout et l’aide à reprendre le chemin.
Que pouvons-nous faire lorsque nous nous trouvons dans une situation qui semble sans issue? Bartimée nous enseigne à faire appel aux ressources que nous portons en nous et qui font partie de nous. Il est mendiant, il sait demander, il sait même crier! Si tu désires vraiment quelque chose, fais tout pour l’obtenir, même si les autres te réprimandent, t’humilient et te disent de laisser tomber. Si tu le désires vraiment, continue à crier!
Le cri de Bartimée, rapporté dans l’Evangile de Marc — «Fils de David, Jésus, aie pitié de moi!» (v. 47) — est devenu une prière très connue dans la tradition orientale, que nous pouvons également utiliser: «Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur».
Bartimée est aveugle, mais paradoxalement, il voit mieux que les autres et reconnaît qui est Jésus! Devant son cri, Jésus s’arrête et le fait appeler (cf. v. 49), car il n’y a aucun cri que Dieu n’entende, même lorsque nous ne sommes pas conscients de nous adresser à lui (cf. Ex 2, 23). Il semble étrange que, devant un aveugle, Jésus ne se rende pas immédiatement auprès de lui; mais, si nous y réfléchissons bien, c’est la manière pour réactiver la vie de Bartimée: il le pousse à se relever, fait foi en sa capacité de marcher. Cet homme peut se remettre debout, il peut ressusciter de sa situation de mort. Mais pour cela, il doit accomplir un geste très significatif: il doit jeter son manteau (cf. v. 50)!
Pour un mendiant, le manteau est tout: c’est la sécurité, c’est la maison, c’est la défense qui le protège. Même la loi protégeait le manteau du mendiant et imposait de le lui rendre le soir, s’il avait été pris en gage (cf. Ex 22, 25). Et pourtant, bien souvent, ce qui nous bloque, ce sont précisément nos apparentes sécurités, ce que nous avons mis sur nous pour nous défendre et qui, au contraire, nous empêche de marcher. Pour aller vers Jésus et se laisser guérir, Bartimée doit s’exposer à Lui dans toute sa vulnérabilité. C’est le passage fondamental de tout cheminement vers la guérison.
La question que Jésus lui pose semble également étrange: «Que veux-tu que je fasse pour toi?» (v. 51). Mais, en réalité, il n’est pas évident que nous voulions guérir de nos maladies, parfois nous préférons rester immobiles pour ne pas assumer nos responsabilités. La réponse de Bartimée est profonde: il utilise le verbe anablepein, qui peut signifier «voir à nouveau», mais que nous pourrions également traduire par «lever le regard». En effet, Bartimée ne veut pas seulement recouvrer la vue, il veut aussi retrouver sa dignité! Pour lever le regard, il faut relever la tête. Parfois, les gens sont bloqués parce que la vie les a humiliés et ils ne souhaitent que retrouver leur propre valeur.
Ce qui sauve Bartimée, et chacun de nous, c’est la foi. Jésus nous guérit pour que nous puissions devenir libres. Il n’invite pas Bartimée à le suivre, mais lui dit d’aller, de se remettre en chemin (cf. v. 52). Marc conclut cependant le récit en rapportant que Bartimée se mit à suivre Jésus: il a librement choisi de suivre celui qui est le Chemin!
Chers frères et sœurs, portons avec confiance devant Jésus nos maladies, ainsi que celles de nos proches, portons aussi la souffrance de ceux qui se sentent perdus et ne trouvent pas d’issue. Crions aussi pour eux, et soyons certains que le Seigneur nous écoutera et se penchera sur nous.
1C’est également l’interprétation donnée par Augustin dans L’accord entre les Evangiles, 2, 65, 125: PL 34, 1138.
A l’issue de l’Audience générale, le Saint-Père a ajouté:
Je prie pour les victimes de la tragédie qui s’est produite dans l’école de Graz. Je suis proche des familles, des enseignants et des camarades de l’école. Que le Seigneur accueille ses enfants dans sa paix.
Je souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins. Je salue également les Sœurs de la Sainte-Croix de Menzingen, qui célèbrent leur Chapitre général; les Sœurs de la charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours; les Frères maristes des écoles; les Sœurs de l’Union internationale des supérieures générales. Que cette rencontre avec le Successeur de Pierre vous incite à poursuivre avec ferveur votre chemin de foi, afin de construire des communautés capables d’exprimer un témoignage évangélique incisif dans le monde d’aujourd’hui.
Dimanche prochain, nous célébrerons la Solennité de la Sainte Trinité. Je souhaite que la contemplation du mystère trinitaire vous introduise de plus en plus dans l’Amour divin, afin qu’en toutes circonstances vous accomplissiez la volonté du Seigneur. Je vous donne à tous ma bénédiction!
Parmi les groupes ayant assisté à l’Audience générale se trouvaient les groupes francophones suivants:
De France: groupe de pèlerins du diocèse de Vannes; collège privé Saint-Gilbert, de Montceau-les-Mines; famille spirituelle des Filles de la Croix; groupe de Nantes; groupe de l’île de La Réunion.
De Suisse: Institut catholique la Salésienne, de Veyrier.
Du Gabon: groupe de pèlerins, de Port-Gentil.
Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus du Gabon, de Suisse, de la Réunion et de France.
Portons avec confiance devant Jésus nos épreuves, nos limites et nos faiblesses, ainsi que celles de nos proches. Portons aussi la souffrance de ceux qui se sentent perdus et ne trouvent pas d’issue. Crions aussi pour eux, et soyons certains que le Seigneur nous écoutera et se penchera sur nous.
Que Dieu vous bénisse avec vos familles.
Discours au clergé du diocèse de Rome
Salle Paul VI, 12 juin 2025
Hommes de communion
crédibles et prophétiques
Je voudrais demander un grand applaudissement pour vous tous qui êtes ici et pour tous les prêtres et diacres de Rome!
Très chers prêtres et diacres qui accomplissez votre service dans le diocèse de Rome, très chers séminaristes, je vous salue tous avec affection et amitié!
Je remercie Son Eminence, le cardinal-vicaire, pour ses paroles de salutation et la présentation qu’il a faite, en parlant un peu de votre présence dans cette ville.
J’ai souhaité vous rencontrer pour vous connaître de près et pour commencer à marcher avec vous. Je vous remercie pour votre vie donnée au service du Royaume, pour vos efforts quotidiens, pour votre grande générosité dans l’exercice de votre ministère, pour tout ce que vous vivez en silence et qui, parfois, s’accompagne de souffrance et d’incompréhension. Vous accomplissez des services différents mais vous êtes tous précieux aux yeux de Dieu et dans la réalisation de son projet.
Le diocèse de Rome préside dans la charité et dans la communion, et peut accomplir cette mission grâce à chacun de vous, dans le lien de grâce avec l’Evêque et dans la coresponsabilité féconde avec tout le Peuple de Dieu. Notre diocèse est un diocèse très particulier, car beaucoup de prêtres proviennent de différentes parties du monde, en particulier pour des raisons d’études; et cela implique aussi que la vie pastorale — je pense surtout aux paroisses — est marquée par cette universalité et par l’accueil réciproque qu’elle comporte.
C’est précisément à partir de ce regard universel qu’offre Rome que je voudrais partager avec vous de manière cordiale quelques réflexions.
La première, qui me tient particulièrement à cœur, est l’unité et la communion. Dans la prière dite «sacerdotale», comme nous le savons, Jésus a demandé au Père que ses disciples soient une seule et même chose (cf. Jn 17, 20-23). Le Seigneur sait bien que ce n’est qu’unis à Lui et entre nous que nous pouvons porter du fruit et donner au monde un témoignage crédible. La communion sacerdotale ici à Rome est favorisée par le fait que, par une ancienne tradition, nous avons l’habitude de vivre ensemble, dans les presbytères et dans les collèges, ou dans d’autres résidences. Le prêtre est appelé à être l’homme de la communion, car il la vit en premier et l’alimente continuellement. Nous savons que cette communion est aujourd’hui entravée par un climat culturel qui favorise l’isolement ou l’auto-référentialité. Aucun de nous n’échappe à ces écueils qui menacent la solidité de notre vie spirituelle et la force de notre ministère.
Mais nous devons être vigilants car, outre le contexte culturel, la communion et la fraternité entre nous rencontrent également quelques obstacles, pour ainsi dire «internes», qui concernent la vie ecclésiale du diocèse, les relations interpersonnelles et également ce qui habite notre cœur, en particulier ce sentiment de lassitude qui survient car nous avons vécu des épreuves particulières, car nous ne nous sommes pas sentis compris et écoutés, ou pour d’autres raisons. Je voudrais vous aider, marcher avec vous, afin que chacun retrouve une sérénité dans son ministère; et précisément pour cela, je vous demande une élan de fraternité sacerdotale, qui puise ses racines dans une vie spirituelle solide, dans la rencontre avec le Seigneur et dans l’écoute de sa Parole. Nourris par cette sève, nous parvenons à vivre des relations d’amitié, rivalisant d’estime les uns pour les autres (cf. Rm 12, 10); nous ressentons le besoin de l’autre pour grandir et pour alimenter la même tension ecclésiale.
La communion doit également se traduire par l’engagement dans ce diocèse; avec des charismes différents et avec également des services différents, mais l’effort pour le soutenir doit être unique. Je demande à tous de prêter attention au chemin pastoral de ce diocèse, qui est local mais, en raison de ceux qui le guident, est aussi universel. Marcher ensemble est toujours une garantie de fidélité à l’Evangile; ensemble et en harmonie, cherchant à enrichir l’Eglise avec son propre charisme tout en ayant à cœur d’être l’unique corps dont le Christ est le Chef.
La deuxième réflexion que je désire vous soumettre est l’exemplarité. A l’occasion des ordinations sacerdotales du 31 mai dernier, dans mon homélie, j’ai rappelé l’importance de la transparence de la vie, sur la base des paroles de saint Paul qui dit aux personnes âgées d’Ephèse: «Vous savez vous-mêmes de quelle façon je n’ai cessé de me comporter avec vous» (At 20, 18). Je vous le demande avec le cœur d’un père et de pasteur: engageons-nous à être des prêtres crédibles et exemplaires! Nous sommes -conscients des limites de notre nature et le Seigneur nous connaît profondément; mais nous avons reçu une grâce extraordinaire; un trésor précieux dont nous sommes ministres, serviteurs, nous a été confié. Et la fidélité est demandée au serviteur. Aucun de nous n’échappe aux suggestions du monde et la ville, avec ses mille propositions, pourrait aussi nous éloigner du désir de vie sainte, provoquant un nivellement par le bas où les valeurs profondes de la vie de prêtre se perdent. Laissez-vous encore attirer par l’appel du Maître, pour ressentir et vivre l’amour de la première heure, ce qui vous a poussé à faire des choix importants et des renonciations courageuses. Si ensemble nous essayons d’être exemplaires dans une vie humble, alors nous pourrons exprimer la force rénovatrice de l’Evangile pour chaque homme et pour chaque femme.
Une dernière réflexion que je souhaite vous soumettre concerne la relève des défis de notre temps dans une perspective prophétique. Nous sommes préoccupés et affligés par tout ce qui se passe chaque jour dans le monde: les violences qui engendrent la mort nous blessent, les inégalités, les pauvretés, les nombreuses formes de marginalisation sociale, la souffrance généralisée qui revêt les traits d’une détresse qui désormais n’épargne plus personne, nous interpellent. Et ces réalités ne se produisent pas uniquement ailleurs, loin de nous, mais concernent également notre ville de Rome, marquée par de multiples formes de pauvreté et de graves urgences, comme celle du logement. Une ville dans laquelle, comme le faisait remarquer le Pape François, à la «grande beauté» et au charme de l’art doit correspondre aussi «la simple décence et la fonctionnalité normale dans les lieux et les situations de la vie ordinaire, de tous les jours. Parce qu’une ville plus vivable pour ses ci-toyens est aussi plus accueillante pour tous» (Homélie des première Vêpres et Te Deum, 31 décembre 2023).
Le Seigneur nous a voulu précisément dans cette époque riche de défis qui, parfois, nous semblent plus grands que nos forces. Ces défis, nous sommes appelés à les embrasser, les interpréter de façon évangélique et à les vivre comme des possibilités de témoignages. Ne fuyons pas face à eux! Que l’engagement pastoral, comme celui de l’étude, deviennent pour tous une école pour apprendre à construire le Royaume de Dieu dans le présent d’une histoire complexe et stimulante. Récemment, nous avons eu l’exemple de saints prêtres qui ont su conjuguer la passion pour l’histoire avec l’annonce de l’Evangile, tels que le père Primo Mazzolari et le père Lorenzo Milani, prophètes de paix et de justice. Et ici, à Rome, nous avons le père Luigi Di Liegro qui, face à autant de pauvreté, a donné sa vie pour chercher des chemins de justice et de promotion humaine. Puisons dans la force de ces exemples pour continuer à semer des graines de sainteté dans notre ville.
Chers amis, je vous assure de ma proximité, de mon affection et de ma disponibilité à marcher avec vous. Confions au Seigneur notre vie sacerdotale et demandons-lui de grandir dans l’unité, dans l’exemplarité et dans l’engagement prophétique pour servir notre temps. Que nous accompagne l’appel pressant de saint Augustin qui disait: «Aimez cette Eglise, vivez en elle, formez-la telle qu’elle vient de vous apparaître; chérissez le bon Pasteur, l’époux si beau qui ne trompe personne et qui ne veut la mort de personne. Priez aussi pour les brebis dispersées; qu’elles reviennent aussi, qu’elles reconnaissent aussi et aiment la vérité, afin qu’il n’y ait plus qu’un troupeau et qu’un pasteur» (Sermon 138, 10). Merci!
Message pour la prochaine Journée Mondiale des Pauvres
Travail, éducation, logement, santé: conditions d’une vraie sécurité
1. «Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance» (Ps 71, 5). Ces paroles jaillissent d’un cœur accablé par de graves difficultés: «Tu m’as fait voir tant de maux et de détresses» (v. 20), dit le psalmiste. Malgré cela, son âme est ouverte et confiante, car elle est ferme dans la foi, qui reconnaît le soutien de Dieu et le professe: «Ma forteresse et mon roc, c’est toi» (v. 3). De là jaillit la confiance inébran-lable que l’espérance en Lui ne déçoit pas: «En toi, Seigneur, j’ai mon refuge: garde-moi d’être humilié pour toujours» (v. 1).
Dans les épreuves de la vie, l’espérance est animée par la certitude ferme et encourageante de l’amour de Dieu répandu dans les cœurs par l’Esprit Saint. C’est pourquoi elle ne déçoit pas (cf. Rm 5, 5) et saint Paul peut écrire à Timothée: «Si nous nous donnons de la peine et si nous combattons, c’est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant» (1 Tm 4, 10). Le Dieu vivant est en effet le «Dieu de l’espérance» (Rm 15, 13) qui dans Christ, par sa mort et sa résurrection, est devenu «notre espérance» (1 Tm 1, 1). Nous ne pouvons pas oublier que nous avons été sauvés dans cette espérance dans laquelle nous devons rester enracinés.
2. Le pauvre peut devenir témoin d’une espérance forte et fiable, justement parce qu’il la professe dans des conditions de vie précaires, faites de privations, de fragilité et d’exclusion. Il ne compte pas sur les certitudes du pouvoir et des biens; au contraire, il les subit et en est souvent victime. Son espérance ne peut reposer qu’ailleurs. En reconnaissant que Dieu est notre première et unique espérance, nous accomplissons nous aussi le passage entre les espérances éphémères et l’espérance durable. Face au désir d’avoir Dieu comme compagnon de route, les richesses sont relativisées car découvrant le véritable trésor dont nous avons réellement besoin. Les paroles avec lesquelles le Seigneur Jésus exhortait ses disciples résonnent clairement et avec force: «Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n’y a pas de mites ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler» (Mt 6, 19-20).
3. La plus grande pauvreté consiste à ne pas connaître Dieu. C’est ce que nous rappelait le Pape François lorsqu’il écrivait dans Evangelii gaudium: «La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle. L’immense majorité des pauvres ont une ouverture particulière à la foi; ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas manquer de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa Parole, la célébration des sacrements et la proposition d’un chemin de croissance et de maturation dans la foi» (n. 200). Il y a là une conscience fondamentale et tout à fait originale de la manière de trouver en Dieu son trésor. L’apôtre Jean insiste en effet: «Si quelqu’un dit: «J’aime Dieu», alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas» (1 Jn 4, 20).
C’est une règle de la foi et un secret de l’espérance: tous les biens de cette terre, les réalités matérielles, les plaisirs du monde, le bien-être économique, bien qu’importants, ne suffisent pas à rendre le cœur heureux. Les richesses sont souvent trompeuses et conduisent à des situations dramatiques de pauvreté, à commencer par celle de pen-ser que l’on n’a pas besoin de Dieu et de mener sa vie indépendamment de Lui. Les paroles de saint Augustin me reviennent à l’esprit: «Que toute ton espérance soit en Dieu: sens que tu as besoin de Lui pour être comblé par Lui. Sans Lui, tout ce que tu auras ne servira qu’à te rendre encore plus vide» (Enarr. in Ps. 85,3).
4. L’espérance chrétienne à laquelle renvoie la Parole de Dieu est une certitude sur le chemin de la vie, car elle ne dépend pas de la force humaine, mais de la promesse de Dieu qui est toujours fidèle. C’est pourquoi, depuis les origines, les chrétiens ont voulu identifier l’espérance au symbole de l’ancre, qui offre stabilité et sécurité. L’espérance chrétienne est comme une ancre qui fixe notre cœur sur la promesse du Seigneur Jésus qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection et qui reviendra parmi nous. Cette espérance continue à indiquer comme véritable horizon de la vie les «cieux nouveaux» et la «terre nouvelle» (2 P 3, 13), où l’existence de toutes les créatures trouvera son sens authentique, car notre véritable patrie est dans les cieux (cf. Ph 3, 20).
La cité de Dieu nous engage donc pour les cités des hommes. Celles-ci doivent dès maintenant commencer à lui ressembler. L’espérance, soutenue par l’amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint (cf. Rm 5, 5) transforme le cœur humain en terre féconde, où peut germer la charité pour la vie du monde. La Tradition de l’Eglise réaffirme cons-tamment cette circularité entre les trois vertus théologales: la foi, l’espérance et la charité. L’espérance naît de la foi qui la nourrit et la soutient sur le fondement de la charité, qui est la mère de toutes les vertus. Et c’est de charité que nous avons besoin aujourd’hui, maintenant. Ce n’est pas une promesse mais une réalité vers laquelle nous regardons avec joie et responsabilité: elle nous engage et oriente nos décisions vers le bien commun. Celui qui manque de charité, en revanche, non seulement manque de foi et d’espérance, mais enlève l’espérance à son prochain.
5. L’invitation biblique à l’espérance comporte donc le devoir d’assumer sans tarder des respon-sabilités cohérentes dans l’histoire. En effet, la charité «représente le plus grand commandement social» (Catéchisme de l’Eglise catholique, 1889). La pauvreté a des causes structurelles qui doivent être affrontées et éliminées. Pendant ce temps, nous sommes tous appelés à créer de nouveaux signes d’espérance qui témoignent de la charité chrétienne, comme l’ont fait tant de saints et saintes à travers les âges. Les hôpitaux et les écoles, par exemple, sont des institutions créées pour accueillir les plus faibles et les plus marginaux. Ils devraient désormais faire partie des politiques publiques de chaque pays, mais les guerres et les inégalités l’empêchent encore souvent. De plus en plus, les foyers d’accueil, les communautés pour mineurs, les centres d’écoute et d’accueil, les cantines pour les pauvres, les dortoirs, les écoles populaires deviennent aujourd’hui des signes d’espérance: autant de signes souvent cachés auxquels nous ne prêtons peut-être pas attention mais qui sont pourtant si importants pour se-couer l’indifférence et susciter l’engagement dans différentes formes de volontariat!
Les pauvres ne sont pas une distraction pour l’Eglise, ils sont nos frères et sœurs les plus aimés, car chacun d’eux, par son existence et aussi par les paroles et la sagesse dont il est porteur, nous invite à toucher du doigt la vérité de l’Evangile. C’est pourquoi la Journée mondiale des pauvres veut rappeler à nos communautés que les pauvres sont au centre de toute l’œuvre pastorale. Non seulement en son aspect charitable, mais également en ce que l’Eglise célèbre et annonce. Dieu a pris leur pauvreté pour nous rendre riches à travers leurs voix, leurs histoires, leurs visages. Toutes les formes de pauvreté, sans exception, sont un appel à vivre concrètement l’Evangile et à offrir des signes efficaces d’espérance.
6. Telle est l’invitation qui nous est faite par la célébration du Jubilé. Ce n’est pas un hasard si la Journée mondiale des pauvres est célébrée vers la fin de cette année de grâce. Lorsque la Porte Sainte sera fermée, nous devrons garder et transmettre les dons divins qui ont été déversés dans nos mains tout au long d’une année de prière, de conversion et de témoignage. Les pauvres ne sont pas des objets de notre pastorale, mais des sujets créatifs qui nous poussent à trouver toujours de nouvelles façons de vivre l’Evangile aujourd’hui. Face à la succession de nouvelles vagues d’appauvrissement, le risque est de s’habituer et de se résigner. Nous rencontrons chaque jour des personnes pauvres ou démunies et il arrive parfois que ce soit nous-mêmes qui ayons moins, qui perdions ce qui nous semblait autrefois sûr: un logement, une alimentation suffisante pour la journée, l’accès aux soins, un bon niveau d’éducation et d’information, la liberté religieuse et d’expression.
En promouvant le bien commun, notre respon-sabilité sociale trouve son fondement dans le geste créateur de Dieu, qui donne à tous les biens de la terre: comme ceux-ci, les fruits du travail de l’homme doivent également être accessibles à tous de manière équitable. Aider les pauvres est en effet une question de justice avant d’être une question de charité. Comme le fait remarquer saint Augustin: «Tu donnes du pain à celui qui a faim, mais il vaudrait mieux que personne n’ait faim, même si cela signifie qu’il n’y aurait personne à qui donner. Tu offres des vêtements à celui qui est nu, mais combien il serait préférable que tous aient des vêtements et qu’il n’y ait pas cette indigence» (Commentaire sur 1 Jn, VIII, 5).
Je souhaite donc que cette Année jubilaire puisse encourager le développement de politiques de lutte contre les formes anciennes et nouvelles de pauvreté, ainsi que de nouvelles initiatives de soutien et d’aide aux plus pauvres parmi les pauvres. Le travail, l’éducation, le logement, la santé sont les conditions d’une sécurité qui ne s’affirmera jamais par les armes. Je me félicite des initiatives déjà existantes et de l’engagement quotidien au niveau international d’un grand nombre d’hommes et de femmes de bonne volonté.
Confions-nous à la Très Sainte Vierge Marie, Con-solatrice des affligés, et avec elle, élevons un chant d’espérance en faisant nôtres les paroles du Te Deum: «In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum – En toi, Seigneur, j’ai espéré, je ne serai jamais confondu».
Du Vatican, le 13 juin 2025, mémoire
de saint Antoine de Padoue, patron des pauvres
Léon PP. XIV
Audience jubilaire
Basilique Saint-Pierre, 14 juin 2025
Jésus est une porte qui unit
pas un mur qui sépare
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous.
Chers frères et sœurs,
les audiences jubilaires spéciales, que le Pape François avait commencées au mois de janvier, en proposant chaque fois un aspect particulier de la vertu théologale de l’espérance et une figure spirituelle qui en est le témoin, reprennent ce matin. Continuons donc le chemin entrepris, comme pèlerins d’espérance!
L’espérance transmise par les apôtres depuis le début nous rassemble. Les apôtres ont vu en Jésus la terre qui se lie au ciel: avec les yeux, les oreilles, les mains, ils ont accueilli le Verbe de la vie. Le Jubilé est une porte ouverte sur ce mystère. L’année jubilaire relie plus radicalement le monde de Dieu au nôtre. Elle nous invite à prendre au sérieux ce que nous prions chaque jour: «Sur la terre comme au ciel». Telle est notre espérance. Voici l’aspect que nous voulons approfondir aujourd’hui: espérer, c’est relier.
Un des plus grands théologiens chrétiens, l’évêque Irénée de Lyon, nous aidera à reconnaître combien cette espérance est belle et actuelle. Irénée est né en Asie mineure et s’est formé parmi ceux qui avaient connu directement les apôtres. Il est ensuite venu en Europe, car une communauté de chrétiens provenant de ses terres s’était déjà formée à Lyon. Comme cela nous fait du bien de le rappeler ici, à Rome, en Europe! L’Evangile a été apporté sur ce continent de l’extérieur. Et aujourd’hui encore, les communautés de migrants sont des présences qui ravivent la foi dans les pays qui les accueillent. L’Evangile vient de l’extérieur. Irénée relie l’Orient et l’Occident. Cela est déjà un signe d’espérance, car cela nous rappelle que les peuples continuent de s’enrichir mutuellement.
Irénée, cependant, possède un trésor encore plus grand à nous donner. Les clivages doctrinaux qu’il rencontra au sein de la communauté chrétienne, les conflits internes et les persécutions extérieures ne l’ont pas découragé. Au contraire, dans un monde en morceaux, il a appris à mieux penser, portant toujours plus profondément son attention sur Jésus. Il est devenu un chantre de sa personne, même de sa chair. Il a reconnu, en effet, qu’en Lui, ce qui nous semble opposé se recompose en unité. Jésus n’est pas un mur qui sépare, mais une porte qui nous unit. Il faut rester en lui et distinguer la réalité des idéologies.
Chers frères et sœurs, aujourd’hui aussi les idées peuvent dégénérer et les paroles peuvent tuer. Le chair, au contraire, est ce dont nous sommes tous faits; c’est ce qui nous lie à la terre et aux autres créatures. La chair de Jésus doit être accueillie et contemplée dans chaque frère et sœur, dans chaque créature. Ecoutons le cri de la chair, sentons-nous appelés par la douleur d’autrui. Le commandement que nous avons reçu depuis le début est celui d’un amour réciproque. Il est inscrit dans notre chair, avant d’être écrit dans les lois.
Irénée, maître d’unité, nous enseigne à ne pas opposer, mais à relier. Il y a une intelligence non pas là où l’on sépare, mais là où l’on unit. Distinguer est utile, diviser jamais. Jésus est la vie éternelle parmi nous: il rassemble les opposés et rend la communion possible.
Nous sommes pèlerins d’espérance, car parmi les personnes, les peuples et les créatures, il faut quelqu’un qui décide d’agir envers la communion. D’autres nous suivront. Comme Irénée à Lyon au IIe siècle, ainsi que dans chacune de nos villes, recommençons à construire des ponts là où aujourd’hui il y a des murs. Ouvrons des portes, relions les mondes et il y aura de l’espérance.
A l’issue de l’Audience jubilaire, le Saint-Père a lancé l’appel suivant:
Ces jours-ci aussi, en effet, des nouvelles très préoccupantes nous parviennent. La situation en l’Iran et Israël s’est gravement détériorée, et dans un moment aussi délicat, je désire renouveler avec force un appel à la responsabilité et à la raison. L’engagement pour construire un monde plus sûr et libéré de la menace nucléaire doit être poursuivi à travers une rencontre respectueuse et un dialogue sincère, pour édifier une paix durable, fondée sur la justice, la fraternité et sur le bien commun. Personne ne devrait jamais menacer l’existence d’autrui. C’est le devoir de tous les pays de soutenir la cause de la paix, en ouvrant des chemins de réconciliation et en favorisant des solutions qui garantissent la sécurité et la dignité pour tous.
Je donne à tous ma bénédiction.
Parmi les groupes qui assistaient à l’Audience jubilaire était présent le groupe francophone suivant:
De France: groupe de pèlerins de Villeroy de Galhau.
Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les pèlerins venus de France. Frères et sœurs, par l’intercession de saint Irénée, construisons dans nos cités des ponts là où il y a encore des murs, en devenant des instruments d’unité et de paix pour faire naître l’espérance dans les cœurs. Que Dieu vous bénisse!
Homélie pour le Jubilé du Sport
Basilique Saint-Pierre, 15 juin 2025
L’entraînement quotidien à l’amour édifie un monde nouveau
Chers frères et sœurs,
Dans la première lecture, nous avons entendu ces paroles: «Ecoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu: “Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. […] Quand il établissait les cieux, j’étais là; […] Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, -jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes”» (Pr 8, 22.27.30-31). Pour saint Augustin, la Trinité et la sagesse sont intimement liées. La sagesse divine est révélée dans la Très Sainte Trinité, et la sagesse nous conduit toujours à la vérité.
Et aujourd’hui, alors que nous célébrons la Solennité de la Sainte Trinité, nous vivons les journées du Jubilé du Sport. Le binôme Trinité-sport n’est pas vraiment courant, et pourtant cette association n’est pas déplacée. En effet, toute bonne activité humaine porte en elle un reflet de la beauté de Dieu, et le sport en fait certainement partie. D’ailleurs, Dieu n’est pas statique, il n’est pas fermé sur lui-même. Il est communion, relation vivante entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui s’ouvre à l’humanité et au monde. La théologie appelle cette réalité périchorèse, c’est-à-dire «dan-se»: une danse d’amour réciproque.
C’est de ce dynamisme divin que jaillit la vie. Nous avons été créés par un Dieu qui se réjouit et se complaît à donner l’existence à ses créatures, qui «“joue”, comme nous l’a rappelé la première lecture (cf. Pr 8, 30-31). Certains Pères de l’Eglise parlent même, hardiment, d’un Deus ludens, d’un Dieu qui se divertit (cf. S. Salonius de Genève, In Parabolas Salomonis expositio mystica; S. Grégoire de Nazianze, Carmina, I, 2, 589). C’est pourquoi le sport peut nous aider à rencontrer Dieu Trinité: parce qu’il exige un mouvement de soi vers l’autre, certes extérieur, mais aussi et surtout intérieur. Sans cela, il se réduit à une stérile compétition d’égoïsmes.
Pensons à une expression couramment utilisée en italien pour encourager les athlètes pendant les compétitions: les spectateurs crient «Dai!» (Allez!). Nous n’y prêtons peut-être pas attention, mais c’est un impératif magnifique: c’est l’impératif du verbe «dare» (donner). Et cela peut nous faire réfléchir: il ne s’agit pas seulement de donner une performance physique, même extraordinaire, mais de se donner soi-même, de “se mettre en jeu”. Il s’agit de se donner pour les autres — pour leur croissance, pour les supporters, pour les proches, pour les entraîneurs, pour les collaborateurs, pour le public, même pour les adversaires — et, si l’on est vraiment sportif, cela vaut au-delà du résultat. Saint Jean-Paul II — un sportif, comme nous le savons — en parlait ainsi: «Le sport est joie de vivre, jeu, fête, et comme tel, il doit être valorisé [...] par la redécouverte de sa gratuité, de sa capacité à créer des liens d’amitié, à favoriser le dialogue et l’ouverture des uns vers les autres, [...] au-delà des lois dures de la production et de la consommation et de toute autre considération purement utilitaire et hédoniste de la vie» (Homélie pour le Jubilé des sportifs, 12 avril 1984).
Dans cette optique, mentionnons en particulier trois aspects qui font aujourd’hui du sport un moyen précieux de formation humaine et chrétienne.
Premièrement, dans une société marquée par la solitude, où l’individualisme exacerbé a déplacé le centre de gravité du «nous» vers le «je», finissant par ignorer l’autre, le sport — surtout lorsqu’il s’agit d’un sport d’équipe — enseigne la valeur de la collaboration, du cheminement commun, de ce partage qui, comme nous l’avons dit, est au cœur même de la vie de Dieu (cf. Jn 16, 14-15). Il peut ainsi devenir un instrument important de recomposition et de rencontre: entre les peuples, dans les communautés, dans les milieux scolaires et professionnels, dans les familles!
Deuxièmement, dans une société de plus en plus numérique, où les technologies, tout en rapprochant les personnes éloignées, éloignent souvent celles qui sont proches, le sport valorise le caractère concret du vivre ensemble, le sens du corps, de l’espace, de l’effort, du temps réel. Ain-si, contre la tentation de fuir dans des mondes virtuels, il aide à maintenir un contact sain avec la nature et avec la vie concrète, lieu seul où s’exerce l’amour (cf. 1 Jn 3, 18).
Troisièmement, dans une société compétitive où il semble que seuls les forts et les gagnants méritent de vivre, le sport enseigne aussi à perdre, en confrontant l’homme, dans l’art de la défaite, à l’une des vérités les plus profondes de sa condition: la fragilité, la limite, l’imperfection. Cela est important, car c’est à partir de l’expérience de cette fragilité que l’on s’ouvre à l’espérance. L’athlète qui ne se trompe jamais, qui ne perd jamais, n’existe pas. Les champions ne sont pas des machines infaillibles, mais des hommes et des femmes qui, même lorsqu’ils tombent, trouvent le courage de se relever. Rappelons-nous encore une fois, à ce propos, les paroles de saint Jean-Paul II, qui disait que Jésus est «le véritable athlète de Dieu», parce qu’il a vaincu le monde non par la force, mais par la fidélité de son amour (cf. Homélie lors de la Messe pour le Jubilé des sportifs, 29 octobre 2000).
Ce n’est pas un hasard si, dans la vie de nombreux saints de notre temps, le sport a joué un rôle important, soit comme pratique personnelle, soit comme moyen d’évangélisation. Pensons au bienheureux Pier Giorgio Frassati, patron des sportifs, qui sera proclamé saint le 7 septembre prochain. Sa vie, simple et lumineuse, nous rappelle que, tout comme personne ne naît champion, personne ne naît saint. C’est l’entraînement quotidien à l’amour qui nous rapproche de la victoire définitive (cf. Rm 5, 3-5) et qui nous rend capables d’œuvrer à l’édification d’un monde nouveau. Saint Paul VI l’affirmait également, vingt ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en rappelant aux membres d’une association sportive catholique combien le sport avait contribué à ramener la paix et l’espérance dans une société bouleversée par les conséquences de la guerre (cf. Discours aux membres du C.S.I., 20 mars 1965). Il disait: «C’est à la formation d’une société nouvelle que tendent vos efforts: [...] dans la conscience que le sport, dans les éléments formateurs sains qu’il met en valeur, peut être un instrument très utile pour l’élévation spirituelle de la personne humaine, condition première et indispensable d’une société ordonnée, sereine et constructive» (ibid.).
Chers sportifs, l’Eglise vous confie une très belle mission: être, dans vos activités, un reflet de l’amour de Dieu Trinité pour votre bien et celui de vos frères. Laissez-vous impliquer dans cette mission avec enthousiasme: en tant qu’athlètes, formateurs, société, groupes, familles. Le Pape François aimait souligner que Marie, dans l’Evangile, nous apparaît active, en mouvement, jusqu’à «courir» (cf. Lc 1, 39), prête, comme savent le faire les mères, à partir au moindre signe de Dieu pour venir en aide à ses enfants (cf. Discours aux volontaires des JMJ, 6 août 2023). Demandons lui d’accompagner nos efforts et nos élans, et de toujours les orienter vers le meilleur, jusqu’à la plus grande victoire: celle de l’éternité, le «champ infini» où le jeu n’aura plus de fin et où la joie sera complète (cf. 1 Co 9, 24-25; 2 Tm 4, 7-8).
Angelus Domini
Place Saint-Pierre, 15 juin 2025
S’opposer à toute forme
de violence et d’abus
Chers frères et sœurs, bonjour!
Nous venons de conclure la célébration eucharistique pour le Jubilé du Sport, et c’est avec joie que je vous salue tous, sportifs de tous les âges et de tous les horizons! Je vous exhorte à vivre l’activité sportive, y compris au niveau compétitif, toujours dans un esprit de gratuité, dans un esprit «ludique» au sens noble du terme, car c’est dans le jeu et dans le divertissement sain que l’être humain ressemble à son Créateur.
Je tiens ensuite à souligner que le sport est un chemin pour construire la paix, car il est une école de respect et de loyauté, qui fait grandir la culture de la rencontre et de la fraternité. Sœurs et frères, je vous encourage à pratiquer ce style de manière -consciente, en vous opposant à toute forme de violence et d’oppression.
Le monde en a tant besoin aujourd’hui! En effet, les conflits armés sont si nombreux. En Birmanie, malgré le cessez-le-feu, les combats se poursuivent, causant également des dommages aux infrastructures civiles. J’invite toutes les parties à s’engager sur la voie du dialogue inclusif, seule voie qui puisse conduire à une solution pacifique et stable.
Dans la nuit du 13 au 14 juin, dans la ville de Yelwata, dans la zone administrative locale de Gouma, dans l’Etat de Benue au Nigeria, un terrible massacre a eu lieu, au cours duquel environ deux cents personnes ont été tuées avec une extrême cruauté, la plupart d’entre elles étant des personnes déplacées à l’intérieur du pays, hébergées par la mission catholique locale. Je prie pour que la sécurité, la justice et la paix prévalent au Nigeria, pays aimé et si durement touché par diverses formes de violence. Je prie en particulier pour les communautés chrétiennes rurales de l’Etat de Benue, qui ont été sans cesse victimes de violences.
Je pense également à la République du Soudan, dévastée par la violence depuis plus de deux ans. J’ai appris la triste nouvelle du décès du père Luke Jumu, curé d’El Fasher, victime d’un bombardement. Alors que je prie pour lui et pour toutes les victimes, je renouvelle mon appel aux combattants pour qu’ils cessent les hostilités, protègent les civils et engagent un dialogue pour la paix. J’exhorte la communauté internationale à intensifier ses efforts pour fournir au moins l’aide essentielle à la population durement touchée par la grave crise humanitaire.
Continuons à prier pour la paix au Moyen-Orient, en Ukraine et dans le monde entier.
Cet après-midi, dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, Floribert Bwana Chui, jeune martyr congolais, sera béatifié. Il a été tué à l’âge de vingt-six ans parce qu’en tant que chrétien, il s’opposait à l’injustice et défendait les petits et les pauvres. Que son témoignage donne courage et espérance aux jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l’Afrique!
Bon dimanche à tous! Et à vous, les jeunes, je vous dis: je vous attends dans un mois et demi pour le Jubilé des jeunes! Que la Vierge Marie, Reine de la Paix, intercède pour nous.
Discours aux évêques de Madagascar
en pèlerinage jubilaire
Salle des Papes, 16 juin 2025
Le regard tourné vers les pauvres pour y reconnaître le Christ
Eminence, Excellences, chers frères dans l’épiscopat,
C’est avec une grande joie que je vous accueille aujourd’hui auprès de la tombe de l’apôtre Pierre, vous pasteurs de l’Eglise qui est à Madagascar, venus à Rome en pèlerinage jubilaire. Cette rencontre revêt, pour moi, une signification particulière, car elle est notre première rencontre. Je rends grâce au Seigneur pour cette occasion de fraternité dans le Christ.
Je dois aussi vous dire que j’admire votre décision de venir tous ensemble à Rome, en tant qu’évêques de Madagascar. C’est un beau signe d’unité, déjà décidée ensemble avec le bien-aimé Pape François, que nous sentons spirituellement présent aussi en ce moment. Il a visité votre pays en 2019; et trois ans plus tard, il vous a accueillis en Visite ad limina Apostolorum. Cette fois-ci, c’est le Jubilé, l’Année de grâce proclamée par le Seigneur Jésus, qui vous a convoqués.
Et il est beau que vous soyez devenus des pèlerins de l’espérance, avec les milliers et milliers de fidèles qui franchissent chaque jour les Portes Saintes des basiliques papales. Vous êtes avant tout des pèlerins de l’espérance pour vous-mêmes: vous qui êtes pasteurs, vous vous êtes souvenus que vous êtes avant tout des brebis du troupeau, à qui le Christ dit: «Je suis la porte des brebis. [...] Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et sortira, et il trouvera les pâturages» (Jn 10, 7.9). Et en même temps, vous êtes devenus des pèlerins d’espérance pour votre peuple, pour les familles, pour les personnes âgées, les enfants, les jeunes; afin que les Eglises qui sont à Madagascar, à travers vous, reçoivent la grâce de marcher dans l’espérance qui est Jésus-Christ.
Je me réjouis de vous entendre pour me dire les joies et les épreuves pastorales que vous portez dans la fidélité. Votre proximité au Peuple de Dieu est un signe vivant de l’Evangile. J’encourage chacun de vous dans son ministère épiscopal, particulièrement ayez soin des prêtres, qui sont vos premiers collaborateurs et vos frères les plus proches, ainsi que des religieux et religieuses qui se dépensent au service.
Je rends grâce également pour la vitalité missionnaire de vos Eglises particulières, héritières du témoignage de saints qui, pour apporter l’Evangile sur cette terre lointaine, n’ont pas craint ni le rejet, ni la persécution. J’aimerai rappeler le souvenir d’Henri de Solages, le premier missionnaire qui n’a pas été rebuté par l’échec et la prison ou encore le saint martyr Jacques Berthieu, dont le sang a été semence de chrétiens à Madagascar. Que leur exemple continue à vous fortifier dans le don de vous-même au Christ et à son Eglise, au milieu des réussites et des épreuves pastorales que vous traversez pour rejoindre le peuple de Dieu dans différentes réalités de vos diocèses!
Je vous exhorte aussi à ne pas détourner votre regard des pauvres: ils sont au cœur de l’Evangile, et ils sont les destinataires privilégiés de l’annonce de la Bonne Nouvelle. Qu’en eux vous sachiez reconnaître le visage du Christ, et que votre action pastorale demeure toujours animée par une sollicitude concrète envers les plus petits. Que votre ministère en ce Jubilé; au-delà des épreuves, les aide à embraser les horizons toujours nouveaux de l’espérance offerte par le Christ.
A la suite du Pape François, je vous invite à prendre soin de notre maison commune, préservez la beauté de la Grande Ile, dont la beauté et la fragilité vous sont confiées. Le soin de notre maison fait partie intégrante de votre mission prophétique. Prenez soin de la création qui gémit, et enseignez à vos fidèles l’art de la protéger dans la justice et la paix.
Chers frères, allez de l’avant dans votre service avec courage et espérance. Le Successeur de Pierre vous accompagne de sa prière et de son affection. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Madagascar, vous protège. Que le bienheureux Raphaël Rafiringa, la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo, saint Jacques Berthieu et tous les saints de votre terre intercèdent pour vous. Je vous bénis de tout cœur.
Discours aux pèlerins venus pour la béatification de Floribert Bwana Chui
Salle Clémentine, 16 juin 2025
Un ferment de paix désarmée
et désarmante
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
La paix soit avec vous!
Eminence, frères dans l’épiscopat,
chers frères et sœurs!
Je vous accueille avec joie, après la béatification de Floribert Bwana Chui. Je salue les évêques présents, en particulier ceux de la République démocratique du Congo, parmi lesquels l’évêque de Goma, diocèse où a vécu le nouveau bienheureux. Je salue la mère et les proches du bienheureux Floribert, ainsi que la Communauté de Sant’Egidio à laquelle il appartenait. Ce jeune homme a été martyrisé à Goma le 8 juillet 2007. Je le rappelle par les paroles du bien-aimé Pape François, adressées aux jeunes de Kinshasa lors de son voyage apostolique au Congo: «Un jeune comme vous, Floribert Bwana Chui: [...] à seulement vingt-six ans, il a été tué à Goma pour avoir bloqué le passage de denrées alimentaires avariées qui auraient nui à la santé des personnes. […] En tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d’être honnête en disant “non” à la souillure de la corruption. C’est cela garder les mains propres; alors que les mains qui trafiquent l’argent se salissent de sang. […] Etre honnête, c’est briller de jour, c’est répandre la lumière de Dieu, c’est vivre la béatitude de la justice: vaincre le mal par le bien!» (2 février 2023).
D’où un jeune homme pouvait-il tirer la force de résister à la corruption enracinée dans la mentalité courante et capable de toutes les violences? Le choix de garder les mains propres — il était fonc-tionnaire de la douane — mûrit dans une conscience formée par la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, la communion avec les frères.
Il vivait la spiritualité de la Communauté de Sant’Egidio que le Pape François a résumée en trois «P»: prière, pauvres, paix. Les pauvres étaient au cœur de sa vie. Le bienheureux Floribert vivait une relation familière et engagée avec les enfants des rues, poussés à Goma par la guerre, méprisés et orphelins. Il les aimait de la charité du Christ, il s’intéressait à eux et se souciait de leur formation humaine et chrétienne. La force de Floribert a grandi dans la fidélité à la prière et aux pauvres. Un ami se souvient: «Il était convaincu que nous étions nés pour faire de grandes choses, pour marquer l’histoire, pour transformer la réalité»1.
Il était un homme de paix. Dans une région aussi souffrante que le Kivu, déchirée par la violence, il menait son combat pour la paix avec douceur, en servant les pauvres, en pratiquant l’amitié et la rencontre dans une société déchirée. Une religieuse a rappelé qu’il disait: «La communauté met tous les peuples à la même table».
Ce jeune homme, jamais résigné au mal, avait un rêve nourri par les paroles de l’Evangile et la proximité du Seigneur. Beaucoup de jeunes se sentaient abandonnés et sans espoir, mais Floribert entendait la parole de Jésus: «Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous» (Jn 14, 19). Aucune terre n’est abandonnée de Dieu! Il invitait ses amis à ne pas se résigner et à ne pas vivre pour eux-mêmes. En dépit de tout, il exprimait sa confiance en l’avenir. Il disait: «Le Seigneur prépare un monde nouveau où la guerre n’existera plus, où les haines seront effacées, où la violence ne surgira plus comme un voleur dans la nuit... où les enfants grandiront dans la paix. Oui, c’est un grand rêve. Ne vivons pas pour ce qui n’a pas de valeur. Vivons plutôt pour ce grand rêve!».
Un martyr africain, sur un continent riche en jeunes, démontre comment ces derniers peuvent être un ferment de paix «désarmée et désarmante». Un laïc congolais met en lumière la valeur précieuse du témoignage des laïcs et des jeunes. Puisse la paix tant attendue, par l’intercession de la Vierge Marie et du bienheureux Floribert, advenir bientôt au Kivu, au Congo et dans toute l’Afrique! Merci!
[Bénédiction]
1Les témoignages et les paroles du bienheureux Floribert Bwana Chui sont extraits de la Positio super Martyrio.
Audience générale
Place Saint-Pierre, 18 juin 2025
Le cœur du Christ, véritable maison de la miséricorde
Chers frères et sœurs, bonjour!
Nous continuons à contempler Jésus qui guérit. De manière particulière, aujourd’hui, je voudrais vous inviter à réfléchir aux situations dans lesquelles nous nous sentons «bloqués» et dans l’impasse. Parfois, il nous semble qu’il est inutile de continuer à espérer; nous nous résignons et ne voulons plus lutter. Cette situation est décrite dans les Evangiles par l’image de la paralysie. C’est pourquoi je voudrais m’arrêter aujourd’hui sur la guérison d’un paralytique, racontée dans le cinquième chapitre de l’Evangile de Saint Jean (5, 1-9).
Jésus se rend à Jérusalem pour une fête juive. Il ne se rend pas directement au Temple, mais s’arrête à une porte où probablement on lavait les moutons qui étaient ensuite offerts en sacrifice. Près de cette porte, il y avait aussi beaucoup de malades qui, à la différence des brebis, étaient exclus du Temple car considérés comme impurs! C’est alors Jésus lui-même qui les rejoint dans leur douleur. Ces personnes espéraient un prodige capable de changer leur destin; en effet, à côté de la porte se trouvait une piscine dont les eaux étaient considérées comme thaumaturgiques, c’est-à-dire capables de guérir: à certains moments, l’eau s’agitait et, selon la croyance de l’époque, celui qui y plongeait en premier était guéri.
Une sorte de «guerre des pauvres» était ainsi créée: nous pouvons imaginer la triste scène de ces malades se traînant péniblement pour entrer dans la piscine. Cette piscine s’appelait Betzatha, ce qui signifie «maison de la miséricorde»: elle pourrait être une image de l’Eglise, où les malades et les pauvres se rassemblent et où le Seigneur vient pour guérir et donner l’espérance.
Jésus s’adresse spécifiquement à un homme paralysé depuis trente-huit ans. Il est maintenant résigné, parce qu’il ne parvient jamais à s’immerger dans la piscine, lorsque l’eau devient agitée (cf. v. 7). En effet, ce qui nous paralyse, bien souvent, c’est précisément la déception. Nous nous sentons découragés et risquons de tomber dans l’apathie.
Jésus pose à ce paralytique une question qui peut sembler superflue: «Veux-tu être guéri?» (v. 6). C’est au contraire une question nécessaire, car lorsqu’on est bloqué depuis tant d’années, même la volonté de guérir peut faire défaut. Parfois, nous préférons rester dans la condition de malade, obligeant les autres à s’occuper de nous. C’est parfois aussi une excuse pour ne pas décider quoi faire de notre vie. Jésus renvoie en revanche cet homme à son désir le plus vrai et le plus profond.
Cet homme répond en effet de manière plus articulée à la question de Jésus, révélant sa conception de la vie. Il dit tout d’abord qu’il n’a personne pour le plonger dans la piscine: la faute n’est donc pas la sienne, mais celle des autres qui ne prennent pas soin de lui. Cette attitude devient un prétexte pour éviter d’assumer ses propres responsabilités. Mais est-ce bien vrai qu’il n’avait personne pour l’aider? Voici la réponse éclairante de saint Augustin: «Oui, pour être guéri, il avait absolument besoin d’un homme, mais d’un homme qui fut aussi Dieu. [...] L’homme qu’il fallait est donc venu, pourquoi retarder encore la guérison?» (Homélie 17, 7.).
Le paralytique ajoute ensuite que lorsqu’il essaie de plonger dans la piscine, il y a toujours quelqu’un qui arrive avant lui. Cet homme exprime une vision fataliste de la vie. Nous pensons que les choses nous arrivent parce que nous n’avons pas de chance, parce que le destin est contre nous. Cet homme est découragé. Il se sent vaincu dans le combat de la vie.
Jésus l’aide en revanche à découvrir que sa vie est aussi entre ses mains. Il l’invite à se lever, à sortir de sa situation chronique et à prendre son brancard (cf. v. 8). Ce brancard n’est pas à laisser ou à jeter: il représente sa maladie passée, il est son histoire. Jusqu’à ce moment, le passé l’a bloqué, il l’a obligé à rester couché comme un mort. Maintenant, c’est lui qui peut prendre ce brancard et le porter où il veut: il peut décider ce qu’il veut faire de son histoire! Il s’agit de marcher, en s’assumant la responsabilité de choisir la route à suivre. Et cela grâce à Jésus!
Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur le don de comprendre où notre vie est bloquée. Es-sayons d’exprimer notre désir de guérison. Et prions pour tous ceux qui se sentent paralysés, qui ne voient pas d’issue. Demandons à retourner habiter dans le cœur du Christ, qui est la véritable maison de la miséricorde!
Le Pape a ensuite lancé l’appel suivant:
Chers frères et sœurs, le cœur de l’Eglise est trans-percé par les cris qui s’élèvent des lieux de guerre, en particulier de l’Ukraine, d’Iran, d’Israël, de Gaza. Nous ne devons pas nous habituer à la guerre! Au contraire, nous devons rejeter comme une tentation la fascination pour les armes puissantes et sophistiquées. En réalité, parce que dans la guerre d’aujourd’hui «on utilise des armes scientifiques de toutes sortes, son atrocité menace de conduire les combattants à une barbarie bien supérieure à celle des temps passés» (Conc. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 79). C’est pourquoi, au nom de la dignité humaine et du droit international, je répète aux responsables ce que disait le pape François: la guerre est toujours une défaite! Et avec Pie XII: «Rien n’est perdu avec la paix. Tout peut l’être avec la guerre».
Parmi les pèlerins qui assistaient à l’Audience générale, se trouvaient les groupes francophones suivants:
De France: groupe de pèlerins du diocèse de Dijon; groupe Les amis de Compostelle et Rome; lycée Notre-Dame d’Orveau, de Segré; collège Sainte-Marie, d’Aubagne; collège Maison Blanche, de Le Guillaume Saint Paul.
Groupe de pèlerins de Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la République démocratique du Congo.
Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les fidèles de Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la République Démocratique du Congo et de France, dont un groupe des Amis de Compostelle et Rome, le Lycée Notre Dame d’Orveau et de nombreux élèves de différents Collèges.
A l’approche de la Fête-Dieu, ravivons notre foi en ce grand mystère de l’Eucharistie et unissons nos voix aux chants d’action de grâces de l’Eglise. Que Dieu vous bénisse!
Message à la deuxième Conférence annuelle de Rome sur
«AI, ethics and corporate governance»
La nécessité d’un cadre éthique pour l’intelligence artificielle
A l’occasion de cette deuxième conférence annuelle de Rome sur l’Intelligence artificielle, j’exprime mes meilleurs vœux dans la prière à tous les participants. Votre présence témoigne du besoin urgent d’une réflexion sérieuse et d’un débat constant sur la dimension intrinsèquement éthique de l’IA, ainsi que sur sa gouvernance responsable. A cet égard, je suis heureux que le -deuxième jour de la Conférence se déroule au Palais apostolique, ce qui manifeste clairement la volonté de l’Eglise de participer à ces débats qui touchent directement le présent et l’avenir de notre famille humaine.
A côté de son extraordinaire potentiel au bénéfice de la famille humaine, le développement rapide de l’IA soulève également des questions plus profondes concernant l’utilisation appropriée de cette technologie pour édifier une société mondiale plus authentiquement juste et humaine. Dans ce sens, tout en étant sans aucun doute un produit exceptionnel du génie humain, l’IA est «avant tout un outil» (Pape François, Discours à la session du G7 sur l’Intelligence artificielle, 14 juin 2024). Par définition, les outils renvoient à l’intelligence humaine qui les a conçus et tirent une grande partie de leur force éthique des intentions des personnes qui les manipulent. Dans certains cas, l’IA a été utilisée de façon positive et même noble pour promouvoir une plus grande égalité, mais il existe également la possibilité qu’elle soit détournée à des fins égoïstes au détriment des autres, ou pire, pour fomenter les conflits et les agressions.
Pour sa part, l’Eglise désire contribuer à un débat serein et éclairé sur ces ques-tions urgentes en soulignant avant tout le besoin de mesurer les ramifications de l’IA à la lumière du «développement intégral de la personne et de la société» (Note Antiqua et Nova, n. 6). Cela implique de prendre en compte le bien-être de la personne humaine, non seulement du point de vue matériel, mais également intellectuel et spirituel; cela signifie sauvegarder la dignité inviolable de chaque personne humaine et respecter la richesse culturelle et spirituelle des peuples du monde. En définitive, les bénéfices ou les risques de l’IA doivent être évalués précisément en fonction de ce critère éthique supérieur.
Malheureusement, comme le regretté Pape François l’a souligné, nos sociétés assis-tent aujourd’hui à une certaine «disparition ou du moins à une éclipse du sens de l’humain» et cela nous exhorte tous à réfléchir plus profondément sur la véritable nature et l’unicité de notre dignité humaine commune (Discours à la session du G7 sur l’Intelligence artificielle, 14 juin 2024). L’IA, en particulier l’IA générative, a ouvert de nouveaux horizons à différents et multiples niveaux, notamment en améliorant la recherche en matière de santé et de découverte scientifique, mais elle soulève également des questions préoccupantes sur ses possibles répercussions sur l’ouverture de l’humanité à la vérité et à la beauté, sur notre capacité distinctive à saisir et à interpréter la réalité. Reconnaître et respecter ce qui caractérise de façon unique la personne humaine est essentiel au débat de tout cadre éthique adéquat pour la gouvernance de l’IA.
Nous sommes tous, j’en suis certain, préoccupés pour les enfants et les jeunes, et les possibles conséquences de l’utilisation de l’IA sur le développement intellectuel et neurologique. Il faut aider nos jeunes, et non pas les entraver, dans leur parcours vers la maturité et la véritable responsabilité. Ils sont notre espérance pour l’avenir, et le bien-être de la société dépend de la capacité qu’ils pourront avoir de développer les dons et les aptitudes que Dieu leur a donnés, et de répondre aux défis de notre époque et aux besoins des autres avec un esprit libre et généreux. Aucune génération n’a jamais eu un tel accès rapide à la masse d’information désormais disponible grâce à l’IA. Mais une fois encore, l’accès à des données — bien qu’extensives — ne doit pas être confondue avec l’intelligence, qui implique nécessairement «l’ouverture de la personne aux questions ultimes de la vie et reflète une orientation vers le Vrai et le Bien» (Antiqua et Nova, n. 29). A la fin, la sagesse authentique est davantage liée à la reconnaissance de la véritable signification de la vie, qu’à la disponibilité de données.
Chers amis, dans cette perspective, je forme le vœu que vos débats considéreront également l’IA dans le contexte de l’apprentissage intergénérationnel nécessaire qui permettra aux jeunes d’intégrer la vérité dans leur vie morale et spirituelle, éclairant ain-si leurs décisions mûres et ouvrant la voie à un monde de plus grande solidarité et unité (cf. ibid., n. 28). La tâche qui s’ouvre à vous n’est pas aisée, mais elle est d’une importance vitale. En vous remerciant pour vos efforts présents et futurs, j’invoque cordialement sur vous et vos familles les bénédictions divines de sagesse, de joie et de paix.
Du Vatican, le 17 juin 2025
Léon PP. XIV
Audience aux frères mineurs conventuels et aux trinitaires
Salle Clémentine, 20 juin 2025
Illuminés réciproquement dociles à l’Eglise et inspirés par Dieu
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Que la paix soit avec vous!
Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus!
Je salue en particulier les supérieurs généraux — tous deux ont été confirmés — les conseillers et les membres capitulaires de l’ordre des Frères mineurs conventuels et ceux de l’Ordre de la Très Sainte Trinité et des captifs, ainsi que les délégués des Tiers-Ordres et des groupes de laïcs.
Pouvoir accueillir ensemble franciscains et trinitaires m’a rappelé un tableau qui se trouve dans l’abside de la basilique Saint-Jean-de-Latran, qui représente une audience dont celle-ci pourrait être une belle évocation. En effet, le tableau montre le Pape Innocent III qui reçoit saint François et saint Jean de Matha ensemble, pour honorer leur grande contribution à la réforme de la vie religieuse.
Il est intéressant de noter que saint François est représenté à genoux avec un énorme livre ouvert, comme s’il était sur le point de dire au Pape: «Sainteté, je vous demande uniquement de vivre la règle du saint Evangile sine glossa» (cf. Test 14-15). Saint Jean de Matha, en revanche, est debout et tient dans la main la Règle qu’il a rédigée avec le Pape. Si saint François montre sa docilité à l’Eglise, en présentant son projet non pas comme sien, mais comme don divin, saint Jean de Matha montre le texte approuvé, après l’étude et le discernement, comme le point culminant d’un travail absolument nécessaire pour réaliser le dessein que Dieu a inspiré. Les deux attitudes, loin d’être en opposition entre elles, allaient s’illuminer réciproquement et représenter une ligne directrice pour le service que le Saint-Siège a accompli depuis lors en faveur de tous les charismes.
Dieu a inspiré à ces deux saints non seulement un chemin spirituel de service, mais aussi le désir de se confronter avec le Successeur de Pierre sur le don reçu de l’Esprit pour le mettre à disposition de l’Eglise. Saint François expose au Pape la nécessité de suivre Jésus sans réserve, sans autres fins, sans ambiguïtés ni artifices. Saint Jean de Matha a exprimé cette vérité à travers des paroles qui se révéleront ensuite fondamentales et que saint François fera siennes. Un bel exemple sera celui de vivre «sans aucune possession», sans rien de «caché dans l’arrière-chambre de la poche ou du cœur», comme l’a souligné le Pape François (cf. Discours aux chanoinesses de l’Ordre du Saint Esprit, 5 décembre 2024). Un autre terme exprime la nécessité que cette dévotion se trans-forme en service, que le supérieur soit perçu comme un ministre, c’est-à-dire celui qui se fait plus petit, pour être le serviteur de tous. Il est intéressant de noter que le verset de saint Matthieu (cf. 20, 27) a influencé le vocabulaire de toute la vie religieuse, car appeler prieur, maître, magister ou ministre façonne l’entière conception de l’autorité comme service.
Le Pape a ensuite prononcé en espagnol les paroles suivantes:
Pour réaliser ce don, vous trinitaires avez voulu vous concentrer sur l’objectif de votre institut: apporter une consolation à ceux qui ne peuvent pas vivre leur foi librement. Au cours de ces mois, vous avez transformé ce désir en prière, selon les paroles de saint Paul: «persécutés, mais non abandonnés; terrassés, mais non annihilés» (2 Co 4, 9), qui inspirent la devise de votre Chapitre. Je m’unis à cette prière et je demande également à Dieu Trinité que cela soit l’un des fruits de votre assemblée: que vous ne cessiez pas de rappeler dans votre prière et dans votre engagement quotidien tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Cette partie, la troisième — qui concerne les persécutés — selon le magistère de saint Augustin, est la partie de Dieu, et celle qui marque la vocation du libérateur de son Peuple (cf. Questions sur l’Heptateuque, lib. II, 15). En outre, cette ten-sion vers les membres de l’Eglise qui souffrent le plus attirera le regard des vocations, des fidèles et des hommes de bonne volonté sur cette réalité, et vous maintiendra disponibles aux services de frontières que vous accomplirez dans la Péninsule arabique, au Moyen-Orient, en Afrique et dans le sous-continent indien.
Puis Léon XIV a repris en italien:
Un autre élément essentiel de votre intention, frères mineurs conventuels, a été, dans ce Chapitre, d’opérer un discernement sur les règlements des Chapitres généraux et provinciaux, car en eux «il est question des choses de Dieu». Ce n’est pas notre intérêt personnel qui doit nous pousser, mais celui du Christ; c’est son Esprit que nous devons avant tout écouter, pour «écrire l’avenir dans le présent» — comme l’énonce la devise de votre Chapitre. L’écouter dans la voix du frère, dans le discernement de la communauté, dans l’attention aux signes des temps, dans les appels du Magistère. Chers fils de saint François d’Assise, à l’occasion du huitième centenaire de la composition du Cantique des créatures ou de frère soleil, je vous exhorte à être, chacun personnellement et dans chacune de vos fraternités, un rappel vivant du primat de la louange de Dieu dans la vie chrétienne. Et je n’oublie pas que vous, conventuels, célébrez l’anniversaire de votre présence renouvelée en Extrême-Orient.
Très chers amis, je voudrais conclure cette rencontre par les Laudes de Dieu Très Haut, l’hymne de -louange écrit par saint François: «Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles! Tu es fort, tu es grand, Tu es le Très-Haut, tu es le roi tout puissant, toi, Père saint, roi du ciel et de la terre» (Sources franciscaines, 261).
Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse!
Discours aux parlementaires
à l’occasion du Jubilé
des pouvoirs publics
Salle des Bénédictions, 21 juin 2025
La politique, la forme
la plus élevée de la charité
Madame la présidente du Conseil et Monsieur le président de la Chambre des députés de la République italienne,
Madame la présidente et Monsieur le secrétaire général de l’Union interparlementaire,
Représentants des institutions académiques et responsables religieux,
C’est avec plaisir que je vous accueille à l’occasion de la rencontre de l’Union interparlementaire internationale, dans le cadre du Jubilé des pouvoirs publics. Je salue les membres des délégations de soixante-huit pays. Parmi eux, j’adresse une pensée particulière aux présidents des institutions parlementaires respectives.
L’action politique a été définie, à juste titre, par Pie XI comme «la forme la plus élevée de la charité» (Pie XI, Discours à la Fédération universitaire catholique italienne, 18 décembre 1927). Et, en effet, si l’on considère le service qu’elle rend à la société et au bien commun, elle apparaît véritablement comme l’œuvre de cet amour chrétien qui n’est jamais une simple théorie, mais toujours un signe et un témoignage concret de l’action de Dieu en faveur de l’homme (cf. François, encyclique Fratelli tutti, nn. 176-192).
A ce sujet, je voudrais partager avec vous ce matin trois considérations que je juge importantes dans le contexte culturel actuel.
La première concerne la mission qui vous est confiée de promouvoir et de protéger, au-delà de tout intérêt particulier, le bien de la communauté, le bien commun, en particulier en défense des plus faibles et des marginalisés. Il s’agit, par exemple, de s’engager à surmonter l’inacceptable disproportion entre la richesse concentrée entre les mains de quelques-uns et la pauvreté d’une multitude (cf. Léon XIII, encyclique Rerum novarum, 15 mai 1891, n. 1). Ceux qui vivent dans des conditions extrêmes crient pour faire entendre leur voix, mais souvent, ils ne trouvent pas d’oreilles attentives. Ce déséquilibre engendre des situations d’injustice permanente qui débouchent facilement sur la violence et, tôt ou tard, sur le drame de la guerre. En revanche, une bonne politique, en favorisant une répartition équitable des ressources, peut offrir un service efficace à l’harmonie et à la paix, tant au niveau social qu’international.
La deuxième réflexion porte sur la liberté religieuse et le dialogue interreligieux. Dans ce domaine également, aujourd’hui toujours plus actuel, l’action politique peut faire beaucoup, en promouvant les conditions favorables à une liberté religieuse effective et à au développement d’un dialogue respectueux et constructif entre les diverses communautés religieuses. Croire en Dieu, avec les valeurs positives qui en découlent, constitue une immense source de bien et de vérité dans la vie des personnes et des communautés. Saint Augustin, à ce propos, évoquait le passage chez l’homme de l’amor sui — l’amour égoïste de soi, fermé et destructeur — à l’amor Dei — l’amour gratuit, enraciné en Dieu et conduisant au don de soi —, comme élément fondamental de la construction de la civitas Dei, c’est-à-dire d’une société dans laquelle la loi fondamentale est la charité (cf. De civitate Dei, XIV, 28).
Pour avoir alors un point de référence unitaire dans l’action politique, au lieu d’exclure a priori, dans les processus décisionnels, la référence au trans-cendant, il convient d’y rechercher ce qui unit chacun. A cet égard, un point de référence incontournable est celui de la loi naturelle: non pas écrite de la main de l’homme, mais reconnue comme valide universellement et en tout temps, qui trouve dans la nature même sa forme la plus plausible et convaincante. Dans l’Antiquité, Cicéron en était déjà un éminent interprète, en écrivant dans De re publica: «Il est une loi véritable, la droite raison conforme à la nature, immuable, éternelle, qui appelle l’homme au bien par ses commandements, et le détourne du mal par ses menaces […]. On ne peut ni l’infirmer par d’autres lois, ni déroger à quelqu’un de ses préceptes, ni l’abroger tout entière; ni le sénat ni le peuple ne peuvent nous dégager de son empire; elle n’a pas besoin d’interprète qui l’explique; il n’y en aura pas une à Rome, une autre à Athènes, une aujourd’hui, une autre dans un siècle; mais une seule et même loi éternelle et inaltérable régit à la fois tous les peuples, dans tous les temps» (Cicéron, La République, III, 22).
La loi naturelle, universellement valide au-delà d’autres opinions pouvant être discutées, constitue la boussole pour légiférer et agir, notamment face aux délicates questions éthiques qui, aujourd’hui plus que par le passé, touchent le domaine de la vie personnelle et de la vie privée.
La Déclaration universelle des droits de l’homme, approuvée et proclamée par les Nations unies le 10 décembre 1948, appartient désormais au patrimoine culturel de l’humanité. Ce texte, toujours actuel, peut contribuer de manière décisive à replacer la personne humaine, dans son intégrité inviolable, à la base de la recherche de vérité, afin de rendre sa dignité à ceux qui ne se sentent pas respectés dans leur for intérieur et dans les exigences de leur conscience.
Venons-en à la troisième considération. Le degré de civilisation atteint dans notre monde, et les objectifs aux-quels vous êtes appelés à répondre, trouvent aujourd’hui un grand défi dans l’intelligence artificielle. Il s’agit d’un développement qui apportera sans aucun doute une aide utile à la société, dans la mesure où, toutefois, son utilisation ne compromet pas l’identité et la dignité de la personne humaine, ni ses libertés fondamentales. En particulier, il ne faut pas oublier que le rôle de l’intelligence artificielle est d’être un instrument au service du bien de l’être humain, et non pour le diminuer ou en provoquer la perte. Le défi qui se profile est donc important, et exige une grande attention, une vision clairvoyante de l’avenir, afin de concevoir, dans un monde en rapide mutation, des styles de vie sains, justes et sûrs, en particulier pour les jeunes générations.
La vie personnelle vaut beaucoup plus qu’un algorithme et les relations sociales ont besoin d’espaces humains bien plus riches que les schémas limités que peut préfabriquer une quelconque machine sans âme. N’oublions pas que bien qu’étant en mesure d’emmagasiner des millions de données et d’offrir en quelques secondes des réponses à de nombreuses questions, l’intelligence artificielle demeure dotée d’une «mémoire» statique, sans comparaison possible avec celle de l’homme et de la femme, qui est au contraire créative, dynamique, générative, capable d’unir passé, présent et avenir dans une recherche vivante et féconde de sens, avec toutes les implications éthiques et existentielles qui en découlent (cf. François, Discours à la session du G7 sur l’intelligence artificielle, 14 juin 2024).
La politique ne peut ignorer un tel défi. Elle est, au contraire, appelée à répondre aux nombreux citoyens qui regardent à juste titre les défis liés à cette nouvelle culture numérique avec confiance mais aussi préoccupation.
Saint Jean-Paul II, lors du Jubilé de l’an 2000, a indiqué aux hommes politiques saint Thomas More comme témoin à admirer et intercesseur sous la protection duquel placer leur engagement. En effet, Thomas More fut un homme fidèle à ses responsabilités civiles, précisément en vertu de sa foi, qui le conduisit à interpréter la politique non pas comme une profession, mais comme une mission pour la promotion de la vérité et du bien. Il «mit son activité publique au service de la personne, surtout quand elle est faible ou pauvre; il géra les controverses sociales avec un grand sens de l’équité; il protégea la famille et la défendit avec une détermination inlassable; il promut l’éducation intégrale de la jeunesse» (Lett. Ap. M.P. E Sancti Thomae Mori, 31 octobre 2000, n. 4). Le courage avec lequel il n’hésita pas à sacrifier sa vie pour ne pas trahir la vérité en fait pour nous, aujourd’hui encore, un martyr de la liberté et de la primauté de la conscience. Puisse son exemple être pour chacun de vous une source d’inspiration et d’orientation.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre visite. Je forme mes meilleurs vœux pour votre mission et j’invoque sur vous et sur vos proches les bénédictions du Ciel.
Je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse, ain-si que votre travail. Merci.
Angelus
Place Saint-Pierre, 22 juin 2025
Mettre fin
à la tragédie de la guerre
Chers frères et sœurs, bon dimanche!
Aujourd’hui, dans de nombreux pays, on célèbre la Solennité du Corps et du Sang du Christ, le Corpus Domini, et l’Evangile raconte le miracle des pains et des poissons (cf. Lc 9, 11-17).
Pour nourrir les milliers de personnes venues l’écouter et demander la guérison, Jésus invite les apôtres à lui présenter le peu qu’ils ont, bénit les pains et les poissons et leur ordonne de les distribuer à tous. Le résultat est surprenant: non seulement chacun reçoit suffisamment à manger, mais il en reste en abondance (cf. Lc 9, 17).
Au-delà du prodige, le miracle est un «signe» qui nous rappelle que les dons de Dieu, même les plus petits, augmentent d’autant plus qu’ils sont partagés.
Mais nous qui lisons tout cela le jour du Corpus Domini, nous réfléchissons à une réalité encore plus profonde. Nous savons en effet qu’à la racine de tout partage humain, il y en a un plus grand qui le précède: celui de Dieu à notre égard. Lui, le Créateur qui nous a donné la vie pour nous sauver, a demandé à l’une de ses créatures d’être sa mère, de lui donner un corps fragile, limité, mortel, comme le nôtre, en se confiant à elle comme un enfant. Il a ain-si partagé jusqu’au bout notre pauvreté, choisissant de se servir, pour nous racheter, du peu que nous pouvions lui offrir (cf. Nicola Cabasilas, La vita in Cristo, IV, 3).
Pensons à quel point il est beau, lorsque nous faisons un cadeau — même petit, proportionné à nos moyens — de voir qu’il est apprécié par celui qui le reçoit; à quel point nous sommes heureux lorsque nous sentons que, malgré sa simplicité, ce cadeau nous unit encore plus à ceux que nous aimons. Eh bien, dans l’Eucharistie, entre nous et Dieu, c’est précisément ce qui se passe: le Seigneur accueille, sanctifie et bénit le pain et le vin que nous déposons sur l’autel, avec l’offrande de notre vie, et les transforme en Corps et en Sang du Christ, Sacrifice d’amour pour le salut du monde. Dieu s’unit à nous en accueillant avec joie ce que nous apportons et nous invite à nous unir à Lui en recevant et en partageant avec autant de joie son don d’amour. Ainsi, dit saint Augustin, comme «les grains de blé, rassemblés ensemble […] forment un seul pain, de même, dans la concorde de la charité, nous formons un seul corps du Christ» (Sermon 229/A, 2).
Chers amis, ce soir, nous ferons la procession eucharistique. Nous célébrerons ensemble la Sainte Messe, puis nous nous mettrons en marche, en portant le Saint-Sacrement à travers les rues de notre ville. Nous chanterons, nous prierons et enfin, nous nous rassemblerons devant la basilique Sainte-Marie-Majeure pour implorer la bénédiction du Seigneur sur nos maisons, nos familles et toute l’humanité. Que cette Célébration soit un signe lumineux de notre engagement à être chaque jour, à partir de l’Autel et du Tabernacle, porteurs de communion et de paix les uns pour les autres, dans le partage et la charité.
A l’issue de l’Angelus, le Saint-Père a prononcé les appels suivants:
Chers frères et sœurs, des nouvelles alarmantes continuent d’affluer du Moyen-Orient, notamment de l’Iran. Dans ce contexte dramatique qui inclut Israël et la Palestine, la souffrance quotidienne de la population risque de tomber dans l’oubli, en particulier à Gaza et dans les autres territoires, où l’urgence d’une aide humanitaire adéquate se fait de plus en plus pressante.
Aujourd’hui plus que jamais, l’humanité crie et implore la paix. C’est un cri qui appelle à la respon-sabilité et à la raison, et qui ne doit pas être étouffé par le fracas des armes et les discours rhétoriques qui incitent au conflit. Chaque membre de la communauté internationale a une responsabilité morale: mettre fin à la tragédie de la guerre avant qu’elle ne devienne un gouffre irréparable. Il n’y a pas de conflits «lointains» lorsque la dignité humaine est en jeu.
La guerre ne résout pas les problèmes, elle les amplifie et laisse des blessures profondes dans l’histoire des peuples qui mettent des générations à guérir. Aucune victoire armée ne pourra compenser la douleur des mères, la peur des enfants, l’avenir volé.
Que la diplomatie fasse taire les armes! Que les nations façonnent leur avenir par des œuvres de paix, non par la violence et les conflits sanglants!
Je vous salue tous, Romains et pèlerins! Je suis heureux de saluer les parlementaires et les maires ici présents à l’occasion du Jubilé des pouvoirs publics.
Je souhaite à tous un bon dimanche et je bénis ceux qui participent activement aujourd’hui à la fête du Corpus Domini, notamment par le chant, la musique, les décorations florales, l’artisanat et, surtout, par la prière et la procession. Merci à tous et bon dimanche!
Homélie en la Solennité
du Corpus Domini
Place Saint-Jean-de-Latran, 22 juin 2025
Partager le pain
pour multiplier l’espérance
Chers frères et sœurs, qu’il est beau d’être avec Jésus! L’Evangile qui vient d’être proclamé en témoigne lorsqu’il raconte que les foules restaient des heures et des heures avec lui à l’écouter parler du Royaume de Dieu et guérir les malades (cf. Lc 9, 11). La compassion de Jésus pour ceux qui souffrent manifeste la proximité aimante de Dieu, qui vient dans le monde pour nous sauver. Quand Dieu règne, l’homme est libéré de tout mal. Cependant, même pour ceux qui reçoivent la bonne nouvelle de Jésus, l’heure de l’épreuve vient. Dans ce lieu désert, où les foules ont écouté le Maître, le soir tombe et il n’y a rien à manger (cf. v. 12). La faim du peuple et le coucher du soleil sont des signes de la finitude qui pèse sur le monde, sur chaque créature: le jour s’achève, tout comme la vie des hommes. C’est à cette heure, dans l’indigence, la misère et les ténèbres, que Jésus reste parmi nous.
Au moment même où le soleil décline et où la faim grandit, alors que les apôtres eux-mêmes demandent de renvoyer la foule, le Christ nous surprend par sa miséricorde. Il a de la compassion pour le peuple affamé et invite ses disciples à prendre soin de lui: la faim n’est pas un besoin qui n’a rien à voir avec l’annonce du Royaume et le témoignage du salut. Au contraire, cette faim concerne notre relation avec Dieu. Cinq pains et deux poissons ne semblent toutefois pas suffisants pour nourrir le peuple: apparemment raisonnables, les calculs des disciples révèlent au contraire leur faible foi. Car, en réalité, avec Jésus, nous avons tout ce qu’il faut pour donner force et sens à notre vie.
A cet appel de la faim, en effet, il répond par le signe du partage: il lève les yeux, dit la bénédiction, rompt le pain et donne à manger à tous ceux qui sont présents (cf. v. 16). Les gestes du Seigneur n’inaugurent pas un rituel magique complexe, mais témoignent avec simplicité de la reconnaissance envers le Père, de la prière filiale du Christ et de la communion fraternelle que soutient l’Esprit Saint. Pour multiplier les pains et les poissons, Jésus divise ceux qui sont là: ainsi, ils suffisent pour tous, voire ils débordent. Après avoir mangé — et mangé à satiété —, ils emportèrent douze paniers (cf. v. 17).
Telle est la logique qui sauve le peuple affamé: Jésus agit selon le style de Dieu, en enseignant à faire de même. Aujourd’hui, en lieu et place des foules mentionnées dans l’Evangile, il y a des peuples entiers, humiliés par la cupidité des autres plus encore que par leur propre faim. Face à la misère de beaucoup, le cumul des richesses par quelques-uns est signe d’une arrogance indifférente, qui engendre la souffrance et l’injustice. Au lieu de partager, l’opulence gaspille les fruits de la terre et du travail de l’homme. Particulièrement, en cette année jubilaire, l’exemple du Seigneur reste pour nous un critère urgent d’action et de service: partager le pain, pour multiplier l’espérance, c’est proclamer l’avènement du Royaume de Dieu.
En nourrissant les foules, Jésus annonce en effet qu’il sauvera tout le monde de la mort. Tel est le mystère de la foi que nous célébrons dans le sacrement de l’Eucharistie. De même que la faim est un signe de notre pauvreté extrême, ainsi, rompre le pain est un signe du don divin du salut.
Mes très chers amis, le Christ est la réponse de Dieu à la faim de l’homme, car son corps est le pain de la vie éternelle: prenez et mangez-en tous! L’invitation de Jésus embrasse notre expérience quotidienne: pour vivre, nous avons besoin de nous nourrir de la vie, en la prenant aux plantes et aux animaux. Pourtant, manger quelque chose de mort nous rappelle que nous aussi, malgré ce que nous mangeons, nous mourrons. En revanche, lorsque nous nous nourrissons de Jésus, pain vivant et vrai, nous vivons pour Lui. En s’offrant tout entier, le Crucifié Ressuscité se donne à nous qui découvrons ainsi que nous sommes faits pour nous nourrir de Dieu. Notre nature affamée porte la marque d’une indigence qui est comblée par la grâce de l’Eucharistie. Comme l’écrit saint Augustin, le Christ est vraiment «panis qui reficit, et non deficit; panis qui sumi potest, consumi non potest» (Sermon 130, 2): un pain qui nourrit et ne manque pas; un pain que l’on peut manger mais qui ne s’épuise pas. L’Eucharistie, en effet, est la présence véritable, réelle et substantielle du Sauveur (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1413), qui transforme le pain en Lui-même, pour nous trans-former en Lui. Vivant et vivifiant, le Corpus Domini fait de nous, c’est-à-dire de l’Eglise elle-même, le corps du Seigneur.
C’est pourquoi, suivant les paroles de l’apôtre Paul (cf. 1 Co 10, 17), le Concile Vatican II enseigne que «par le sacrement du pain eucharistique, est représentée et réalisée l’unité des fidèles qui, dans le Christ, forment un seul corps. A cette union avec le Christ, lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés» (Const. dogm. Lumen gentium, n. 3). La procession que nous allons bientôt commencer est le signe de ce cheminement. Ensemble, pasteurs et troupeau, nous nous nourrissons du Très-Saint-Sacrement, nous l’adorons et nous le portons dans les rues. Ce faisant, nous le présentons au regard, à la conscience, au cœur des personnes. Au cœur de ceux qui croient, pour qu’ils croient plus fermement; au cœur de ceux qui ne croient pas, pour qu’ils s’interrogent sur la faim que nous avons dans l’âme et sur le pain qui peut la rassasier.
Restaurés par la nourriture que Dieu nous donne, nous portons Jésus dans le cœur de tous, lui qui implique tout le monde dans l’œuvre du salut, invitant chacun à participer à sa table. Heureux les invités qui deviennent témoins de cet amour!
Méditation pour le Jubilé
des séminaristes
Basilique Saint-Pierre, 24 juin 2025
Serviteurs d’une Eglise ouverte
et missionnaire
Merci, merci à tous!
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous!
Eminences, Excellences, formateurs et surtout vous tous, séminaristes, bonjour à tous!
Je suis très heureux de vous rencontrer et je vous remercie tous, séminaristes et formateurs, pour votre présence chaleureuse. Merci avant tout pour votre joie et pour votre enthousiasme. Merci, car avec votre énergie, vous alimentez la flamme de l’espérance dans la vie de l’Eglise!
Aujourd’hui, vous n’êtes pas seulement pèlerins, mais aussi témoins d’espérance: vous me le témoignez, ainsi qu’à tous, parce que vous vous êtes laissés entraîner dans l’aventure fascinante de la vocation sacerdotale à une époque qui n’est pas facile. Vous avez accueilli l’appel à devenir des annonciateurs doux et forts de la Parole qui sauve, des serviteurs d’une Eglise ouverte et d’une Eglise en sortie missionnaire.
Y digo una palabra también en español, gracias por haber aceptado con valentía la invitación del Señor a seguir, a ser discípulo, a entrar en el seminario. Hay que ser valientes y no tengan miedo.
[Et je dis aussi quelques mots en espagnol: merci d’avoir accepté avec courage l’invitation du Seigneur à le suivre, à devenir ses disciples, à entrer au séminaire. Il faut être courageux et n’ayez pas peur!]
Au Christ qui vous appelle, vous dites «oui» avec humilité et courage; et ce «me voici», que vous lui adressez, germe dans la vie de l’Eglise, et se laisse accompagner par le nécessaire chemin de discernement et de formation.
Jésus, vous le savez, vous appelle avant tout à vivre une expérience d’amitié avec Lui et avec vos compagnons de route (cf. Mc 3, 13); une expérience appelée à croître de manière permanente, même après l’ordination, et qui touche tous les aspects de la vie. Rien en vous ne doit être écarté, en effet, tout doit être assumé et transfiguré dans la logique du grain de blé, afin de devenir des personnes et des prêtres heureux, des «ponts» et non des obstacles à la rencontre avec le Christ pour tous ceux qui vous côtoient. Oui, Il doit croître et nous diminuer, pour pouvoir devenir des pasteurs selon son Cœur1.
A propos du Cœur de Jésus Christ, comment ne pas rappeler l’Encyclique Dilexit nos, que nous a donnée le bien-aimé Pape François?2 Précisément en ce temps que vous vivez, c’est-à-dire celui de la formation et du discernement, il est important de porter votre attention vers le centre, vers le «moteur» de tout votre chemin: le cœur! Le séminaire, quelle que soit la manière dont on l’envisage, devrait être une école des affections. Aujourd’hui plus que jamais, dans un contexte social et culturel marqué par le conflit et le narcissisme, nous avons besoin d’apprendre à aimer et à le faire comme Jésus3.
Comme le Christ a aimé avec un cœur d’homme4, vous êtes appelés à aimer avec le Cœur du Christ! Amar con el corazón de Jesús. Mais pour apprendre cet art, il faut travailler sur son intériorité, là où Dieu fait entendre sa voix et d’où partent les décisions les plus profondes; lieu également de tensions et de luttes (cf. Mc 7, 14-23), à convertir pour que toute votre humanité respire l’Evangile. Le premier travail doit donc se faire sur l’intériorité. Souvenez-vous bien de l’invitation de saint Augustin à revenir au cœur, car c’est là que nous retrouvons les traces de Dieu. Descendre dans son cœur peut parfois faire peur, car on y trouve aussi des blessures. N’ayez pas peur de les soigner, laissez-vous aider: car c’est de ces blessures que naîtra votre capacité à être proches de ceux qui souffrent. Sans vie intérieure, la vie spirituelle n’est pas possible, car c’est dans le cœur que Dieu nous parle. Dios nos habla en el corazón, tenemos que saber escucharlo. [Dieu nous parle dans le cœur, il faut savoir l’écouter]. Ce travail intérieur inclut aussi l’apprentissage à reconnaître les mouvements du cœur: pas seulement les émotions rapides et immédiates, caractéristiques de l’âme des jeunes, mais surtout vos sentiments profonds, qui vous aident à découvrir la direction de votre vie. Si vous apprenez à connaître votre cœur, vous deviendrez toujours plus authentiques et vous n’aurez pas besoin de porter de masques. Et le chemin privilégié qui nous conduit à l’intériorité est la prière: à une époque d’hyperconnexion, il devient toujours plus difficile de faire l’expérience du silence et de la solitude. Sans la rencontre avec Lui, nous ne pouvons pas non plus véritablement nous connaître nous-mêmes.
Je vous invite à invoquer fréquemment l’Esprit Saint, pour qu’il façonne en vous un cœur docile, capable de percevoir la présence de Dieu, également en écoutant les voix de la nature, de l’art, de la poésie, de la littérature5, de la musique, mais aussi des sciences humaines6. Dans le travail rigoureux des études théologiques, sachez aussi écouter avec un esprit et un cœur ouverts les voix de la culture, comme les défis récents de l’intelligence artificielle et celles des médias sociaux7. Surtout, à l’ex-emple de Jésus, sachez entendre le cri souvent silencieux des petits, des pauvres et des opprimés, et de tant de personnes, surtout des jeunes, qui cherchent un sens à leur vie.
Si vous prenez soin de votre cœur, avec des moments quotidiens de silence, de méditation et de prière, vous apprendrez l’art du discernement. Cela aussi est un travail important: apprendre à discerner. Quand on est jeune, on porte en soi beaucoup de désirs, de rêves et d’ambitions. Le cœur est souvent encombré et il arrive de se sentir confus. Au contraire, à l’image de la Vierge Marie, notre intériorité doit devenir capable de conserver et de méditer. Capable de synballein — comme l’écrit l’évangéliste Luc (2, 19.51): rassembler les fragments8. Fuyez la superficialité, et assemblez les morceaux de votre vie dans la prière et la méditation, en vous demandant: qu’est-ce que m’apprend ce que je vis? Qu’est-ce que cela dit à mon chemin? Où le Seigneur me conduit-il?
Très chers amis, ayez un cœur doux et humble comme celui de Jésus (cf. Mt 11, 29). A l’exemple de l’apôtre Paul (cf. Ph 2, 5sq), puissiez-vous avoir les sentiments du Christ, pour grandir en maturité humaine, surtout affective et relationnelle. Il est important, même nécessaire, dès le temps du séminaire, de miser beaucoup sur la maturation humaine, en rejetant tout faux-semblant ou hypocrisie. En gardant le regard fixé sur Jésus, il faut apprendre à nommer et à exprimer aussi la tristesse, la peur, l’angoisse, l’indignation, en apportant tout dans la relation à Dieu. Les crises, les limites, les fragilités ne doivent pas être occultées: elles sont au contraire des occasions de grâce et d’expérience pascale.
Dans un monde souvent marqué par l’ingratitude et la soif de pouvoir, où semble parfois prévaloir la logique du rejet, vous êtes appelés à témoigner de la gratitude et de la gratuité du Christ, de l’exultation et de la joie, de la tendresse et de la miséricorde de son Cœur. A pratiquer le style de l’accueil et de la proximité, du service généreux et désintéressé, en laissant l’Esprit Saint «oindre» votre humanité avant l’ordination.
Le Cœur du Christ est animé d’une immense compassion: Il est le bon Samaritain de l’humanité, et Il nous dit: «Va, et toi aussi fais de même» (Lc 10, 37). Cette compassion le pousse à rompre pour les foules le pain de la Parole et du partage (cf. Mc 6, 30-44), en préfigurant le geste du Cénacle et de la Croix, quand Il se donnera Lui-même en nourriture, et Il nous dit: «Donnez-leur vous-mêmes à manger» (Mc 6, 37), c’est-à-dire: faites de votre vie un don d’amour.
Chers séminaristes, la sagesse de la Mère Eglise, assistée par l’Esprit Saint, cherche au fil du temps les formes les plus appropriées de former les ministres ordonnés, selon les exigences des lieux. Quelle est votre tâche dans cet effort? Celle de ne jamais -jouer au rabais, de ne pas vous contenter, de ne pas être de simples récepteurs passifs, mais de vous passionner pour la vie sacerdotale, en vivant le présent et en regardant vers l’avenir avec un cœur prophétique. J’espère que notre rencontre aidera chacun de vous à approfondir votre dialogue personnel avec le Seigneur, dans lequel lui demander d’assimiler toujours davantage les sentiments du Christ, les sentiments de son Cœur. Ce Cœur qui bat d’amour pour vous et pour toute l’humanité.
Bon cheminement! Je vous accompagne de ma bénédiction.
Chers séminaristes,
Je suis heureux de pouvoir vous accompagner ce matin, à l’occasion de votre Jubilé, avec les prêtres qui vous guident dans votre parcours de formation. Vous provenez de diverses Eglises dans le monde, avec des expériences de vie très variées, mais dans le Seigneur, nous formons tous un seul corps. En effet, l’espérance à laquelle vous avez été appelés est une seule, celle de votre vocation (cf. Ep 4, 4). Aujourd’hui, sur la tombe de l’apôtre Pierre et avec moi, son Successeur, vous renouvelez solennellement la foi de votre Baptême. Que ce Credo soit la racine d’où germera le «me voici» que vous proclamerez avec joie le jour de votre ordination sacerdotale. Que Dieu, qui a commencé en vous son œuvre, la mène à son accomplissement.
[récitation du Credo en latin]
Prions. Père, qui en cette Année jubilaire ouvres la voie du salut à ton Eglise, accueille nos intentions de bien et exauce notre désir de convertir nos vies vers toi pour devenir des témoins authentiques de l’Evangile. Par la grâce de l’Esprit Saint, guide nos pas vers la bienheureuse espérance de voir ton visage dans la Jérusalem céleste, où ton Royaume parviendra à son accomplissement plein et parfait, et où tout sera réalisé dans le Christ ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi et avec l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles..
[bénédiction]
Tous mes vœux à tous et bon pèlerinage d’espérance!
1 Cf. S. Jean Paul II, Exhort. ap. Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 43.
2 Lett. enc. Dilexit nos, sur l’amour humain et divin du cœur de Jésus Christ (24 octobre 2024).
3 Cf. ivi, 17.
4 Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 22.
5 Cf. François, Lettre sur le rôle de la littérature dans la formation, 17 juillet 2024.
6 Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 62.
7 Congrégation pour le clergé, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Le don de la vocation presbytérale (8 décembre 2016), n. 97.
8 Cf. François, Lettre enc. Dilexit nos, sur l’amour humain et divin du cœur de Jésus Christ (24 octobre 2024), n. 19.
Audience générale
Place Saint-Pierre, 25 juin 2025
Nourris par l’Evangile
pour guérir du mal de vivre
Chers frères et sœurs,
Aujourd’hui encore, nous méditons sur les guérisons de Jésus comme signe d’espérance. En Lui, il y a une force que nous aussi nous pouvons expérimenter lorsque nous entrons en relation avec Sa Personne.
Une maladie très répandue à notre époque est le mal de vivre: la réalité nous semble trop complexe, lourde, difficile à affronter. Et alors nous nous éteignons, nous nous endormons, avec l’illusion qu’au réveil, les choses seront différentes. Mais la réalité doit être affrontée et, avec Jésus, nous pouvons bien le faire. Parfois, nous nous sentons bloqués par le jugement de ceux qui prétendent mettre des étiquettes sur les autres.
Il me semble que ces situations se retrouvent dans un passage de l’Evangile de Marc, où deux histoires s’entremêlent: celle d’une fillette de douze ans, malade dans son lit et à l’article de la mort; et celle d’une femme, qui saigne depuis douze ans et cherche Jésus pour être guérie (cf. Mc 5, 21-43).
Entre ces deux figures féminines, l’Evangéliste place le personnage du père de la jeune fille: il ne reste pas à la maison pour se plaindre de la maladie de sa fille, mais il sort et demande de l’aide. Bien qu’il soit le chef de la synagogue, il n’exige rien en raison de sa position sociale. Lorsqu’il faut attendre, il ne perd pas patience et attend. Et quand on vient lui dire que sa fille est morte et qu’il est inutile de déranger le Maître, il continue à avoir foi et à espérer.
La conversation de ce père avec Jésus est interrompue par la femme hémorroïsse, qui réussit à s’approcher de Jésus et à toucher son manteau (v. 27). Cette femme, avec beaucoup de courage, a pris la décision qui a changé sa vie: tout le monde lui disait de rester à distance, de ne pas se faire voir. Ils l’avaient condamnée à rester cachée et isolée. Parfois, nous aussi, nous sommes victimes du jugement des autres, qui prétendent nous revêtir d’un habit qui n’est pas le nôtre. Et alors, nous sommes malades et nous ne réussissons pas à en sortir.
Cette femme prend le chemin du salut quand germe en elle la foi que Jésus peut la guérir: elle trouve alors la force de sortir et d’aller à sa recherche. Elle veut arriver au moins à toucher son vêtement.
Il y avait une grande foule autour de Jésus, tant de gens le touchaient, mais rien ne leur arrivait. Au contraire, lorsque cette femme touche Jésus, elle est guérie. Où se trouve la différence? Commentant ce point du texte, Saint Augustin dit — au nom de Jésus —: «Les foules se pressent autour de moi, mais la foi me touche» (Sermon 243, 2, 2). C’est ainsi: chaque fois que nous faisons un acte de foi adressé à Jésus, un contact s’établit avec Lui et immédiatement jaillit de Lui sa grâce. Parfois, nous ne nous en rendons pas compte, mais d’une manière secrète et réelle, la grâce nous atteint et, de l’intérieur, transforme lentement la vie.
Peut-être qu’aujourd’hui encore, beaucoup de gens s’approchent de Jésus de manière superficielle, sans vraiment croire en sa puissance. Nous foulons la superficie de nos églises, mais le cœur est peut-être ailleurs! Cette femme, silencieuse et anonyme, surmonte ses peurs en touchant le cœur de Jésus avec ses mains considérées comme impures à cause de sa maladie. Et immédiatement, elle se sent guérie. Jésus lui dit: «Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix» (Mc 5, 34).
Pendant ce temps, on apporte au père la nouvelle de la mort de sa fille. Jésus lui dit: «Ne crains pas, crois seulement» (v. 36). Il se rend ensuite dans sa maison et, voyant que tout le monde pleure et crie, il dit: «L’enfant n’est pas morte, elle dort» (v. 39). Il entre alors dans la chambre où était couchée la jeune fille, la prend par la main et lui dit: «Talità kum», «Jeune fille, lève-toi». La jeune fille se lève et se met à marcher (cf. v. 41-42). Ce geste de Jésus nous montre qu’il ne guérit pas seulement de toute maladie, mais qu’il réveille aussi de la mort. Pour Dieu, qui est Vie éternelle, la mort du corps est comme un sommeil. La vraie mort est celle de l’âme: c’est d’elle que nous devons avoir peur!
Un dernier détail: Jésus, après avoir ressuscité l’enfant, dit aux parents de lui donner à manger (cf. v. 43). Voilà un autre signe très concret de la proximité de Jésus avec notre humanité. Mais nous pouvons aussi le comprendre dans un sens plus profond et nous demander: lorsque nos enfants sont en crise et ont besoin d’une nourriture spirituelle, savons-nous la leur donner? Et comment pouvons-nous le faire si nous ne nous nourrissons pas nous-mêmes de l’Evangile?
Chers frères et sœurs, dans la vie, il y a des moments de déception et de découragement, et il y a même l’expérience de la mort. Apprenons de cette femme, de ce père: allons à Jésus: Lui il peut nous guérir, il peut nous faire renaître. Jésus est notre espérance
A l’issue de l’audience générale le Pape a lancé l’appel suivant:
Dimanche dernier, un attentat terroriste lâche a été perpétré contre la communauté grecque orthodoxe dans l’église Mar Elias à Damas. Nous confions les victimes à la miséricorde de Dieu et élevons nos prières pour les blessés et leurs familles. Aux chrétiens du Moyen-Orient, je dis: je suis proche de vous! Toute l’Eglise est proche de vous!
Cet événement tragique rappelle la profonde fragilité qui continue de marquer la Syrie après des années de conflits et d’instabilité. Il est donc essentiel que la communauté internationale ne détourne pas son regard de ce pays, mais continue de lui offrir son soutien par des gestes de solidarité et par un engagement renouvelé en faveur de la paix et de la réconciliation.
Nous continuons à suivre avec attention et espérance l’évolution de la situation en Iran, en Israël et en Palestine. Les paroles du prophète Isaïe résonnent plus que jamais avec urgence: «Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée; ils n’apprendront plus la guerre» (Is 2, 4). Que l’on écoute cette voix qui vient du Très-Haut! Que l’on guérisse les lacérations provoquées par les actions sanglantes des derniers jours. Que l’on rejette toute logique de tyrannie et de vengeance et que l’on choisisse avec détermination la voie du dialogue, de la diplomatie et de la paix.
Parmi les pèlerins qui assistaient à l’Audience générale se trouvaient les groupes francophones suivants:
De France: Pèlerinage du diocèse de Tarbes et Lourdes, avec S.Exc. Mgr Jean-Marc Micas; groupe de pèlerins des diocèses du Mans, et d’Auch; séminaristes du Séminaire Saint-Bonjour, de Toulouse; groupe Les Elus Sarthois; Aumônerie étudiante, de Mende; groupe de L’île de La Réunion.
De Belgique: groupe de prêtres.
Du Canada: groupe de pèlerins du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
De Côte d’Ivoire: groupe de prêtres d’Abidjan.
Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier ceux venus du Canada, de la Côte d’ivoire, de la Belgique et de la France.
Frères et sœurs, par l’intercession des saints Pierre et Paul, les colonnes de l’Eglise, puissions-nous, au milieu de nos fatigues et difficultés humaines, aller vers Jésus notre espérance et notre vie.
Que Dieu vous bénisse!
Méditation pour le Jubilé des évêques
Basilique Saint-Pierre, 25 juin 2025
Bâtisseurs de communion
dociles à l’Esprit
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous!
Chers confrères, bonjour et bienvenue!
J’apprécie et j’admire votre dévouement à venir en pèlerinage à Rome, bien conscient des exigences pressantes du ministère. Mais chacun de vous, comme moi, avant d’être pasteur, est une brebis du troupeau du Seigneur! Et par conséquent, nous aussi, et même en premier lieu, nous sommes invités à franchir la Porte Sainte, symbole du Christ Sauveur. Pour guider l’Eglise confiée à nos soins, nous devons nous laisser profondément renouveler par Lui, le Bon Pasteur, afin de nous conformer pleinement à son cœur et à son mystère d’amour.
«Spes non confundit», «l’espérance ne déçoit pas» (Rm 5, 5). Combien de fois le Pape François a-t-il répété ces paroles de saint Paul! Elles sont devenues sa devise, au point qu’il les a choisies comme incipit de la bulle d’indiction de cette Année jubilaire.
En tant qu’évêques, nous sommes les premiers héritiers de cette mission prophétique, et nous devons la préserver et la transmettre au Peuple de Dieu, par la parole et par le témoignage. Parfois, annoncer que l’espérance ne déçoit pas signifie aller à contre-courant, voire à l’encontre de l’évidence de situations douloureuses qui semblent sans issue. Mais c’est précisément dans ces moments-là que peut mieux se manifester le fait que notre foi et notre espérance ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Et alors, si nous sommes vraiment proches, solidaires de ceux qui souffrent, l’Esprit Saint peut même raviver dans les cœurs la flamme presque éteinte (cf. Bulle Spes non confundit, n. 3).
Très chers frères, le pasteur est témoin de l’espérance par l’exemple d’une vie fermement ancrée en Dieu et entièrement donnée au service de l’Eglise. Cela se produit dans la mesure où il s’identifie au Christ dans sa vie personnelle et dans son ministère apostolique: l’Esprit du Seigneur façonne sa pen-sée, ses sentiments, ses comportements. Arrêtons-nous ensemble sur quelques traits qui caractérisent ce témoignage.
Tout d’abord, l’évêque est le principe visible d’unité dans l’Eglise particulière qui lui est confiée. Il a pour tâche de veiller à ce qu’elle s’édifie dans la communion entre tous ses membres et avec l’Eglise universelle, en valorisant la contribution des divers dons et ministères pour la croissance commune et la diffusion de l’Evangile. Dans ce service, comme dans toute sa mission, l’évêque peut compter sur la grâce divine spéciale qui lui a été conférée lors de l’Ordination épiscopale: elle le soutient en tant que maître de la foi, sanctificateur et guide spirituel. Elle anime son dévouement pour le Royaume de Dieu, pour le salut éternel des personnes, pour transformer l’histoire par la force de l’Evangile.
Le deuxième aspect que je voudrais examiner, toujours à partir du Christ comme forme de vie du Pasteur, je le définirais ainsi: l’évêque comme homme de vie théologale. Ce qui équivaut à dire: homme pleinement docile à l’action de l’Esprit Saint, qui suscite en lui la foi, l’espérance et la charité et les nourrit, comme la flamme du feu, dans les différentes situations existentielles.
L’évêque est un homme de foi. Et ici me vient à l’esprit cette magnifique page de la Lettre aux Hébreux (cf. chap. 11), où l’auteur, en commençant par Abel, dresse une longue liste de «témoins» de la foi. Je pense en particulier à Moïse qui, appelé par Dieu pour conduire le peuple vers la terre promise, il tint ferme — dit le texte — comme s’il voyait Celui qui est invisible» (He 11, 27). Quelle belle image de l’homme de foi: celui qui, par la grâce de Dieu, voit au-delà, voit le but, et reste ferme dans l’épreuve. Pensons aux moments où Moïse intercède pour le peuple devant Dieu. Voilà: l’évêque dans son Eglise est l’intercesseur, car l’Esprit maintient vivante dans son cœur la flamme de la foi.
Dans cette même perspective, l’évêque est un homme d’espérance, car «la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas» (He 11, 1). Surtout lors-que le chemin du peuple devient plus difficile, le pasteur, par vertu théologale, aide à ne pas désespérer: non pas par des paroles, mais par sa proximité. Lorsque les familles portent des fardeaux excessifs et que les institutions publiques ne les soutiennent pas suffisamment; lorsque les jeunes sont déçus et écœurés par des messages illusoires; lorsque les personnes âgées et les personnes gravement handicapées se sentent abandonnées, l’évêque est proche et n’offre pas de recettes, mais l’expérience de communautés qui cherchent à vivre l’Evangile dans la simplicité et dans le partage.
Ainsi, sa foi et son espérance se fondent en lui comme homme de charité pastorale. Toute la vie de l’évêque, tout son ministère, si diversifié et multiforme, trouve son unité dans ce que saint Augustin appelle amoris officium. C’est là que s’exprime et transparaît au plus haut point son existence théologale. Dans la prédication, dans les visites aux communautés, dans l’écoute des prêtres et des diacres, dans les choix administratifs, tout est animé et motivé par la charité de Jésus-Christ Pasteur. Par sa grâce, puisée quotidiennement dans l’Eucharistie et dans la prière, l’évêque donne l’exemple de l’amour fraternel envers son coadjuteur ou son auxiliaire, envers l’évêque émérite et les évêques des diocèses voisins, envers ses plus proches collaborateurs comme envers les prêtres en difficulté ou malades. Son cœur est ouvert et accueillant, tout comme sa maison.
Chers frères, tel est le noyau théologique de la vie du Pasteur. Autour de lui, et toujours animées par le même Esprit, je voudrais placer d’autres vertus indispensables: la prudence pastorale, la pauvreté, la continence parfaite dans le célibat et les vertus humaines.
La prudence pastorale est la sagesse pratique qui guide l’évêque dans ses choix, dans son gouvernement, dans ses relations avec les fidèles et leurs associations. Un signe clair de prudence est l’exercice du dialogue comme style et méthode dans les relations et aussi dans la présidence des organismes de participation, c’est-à-dire dans la gestion de la synodalité dans l’Eglise particulière. Sur cet aspect, le Pape François nous a fait faire un grand pas en avant en insistant, avec une sagesse pédagogique, sur la synodalité comme dimension de la vie de l’Eglise. La prudence pastorale permet également à l’évêque de guider la communauté diocésaine en valorisant ses traditions et en promouvant de nouvelles voies et de nouvelles initiatives.
Pour témoigner du Seigneur Jésus, le Pasteur vit la pauvreté évangélique. Il a un style simple, sobre et généreux, digne et en même temps adapté aux conditions de la plupart de son peuple. Les pauvres doivent trouver en lui un père et un frère, ne pas se sentir mal à l’aise en le rencontrant ou en entrant dans sa maison. Il est personnellement détaché des richesses et ne cède pas à des favoritismes fondés sur celles-ci ou sur d’autres formes de pouvoir. L’évêque ne doit pas oublier que, comme Jésus, il a été oint du Saint-Esprit et envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres (cf. Lc 4, 18).
Outre la pauvreté effective, l’évêque vit également cette forme de pauvreté qu’est le célibat et la virginité pour le Royaume des cieux (cf. Mt 19, 12). Il ne s’agit pas seulement d’être célibataire, mais de pratiquer la chasteté du cœur et de la conduite et de vivre ainsi la suite du Christ et d’offrir à tous la véritable image de l’Eglise, sainte et chaste dans ses membres comme dans son Chef. Il devra être ferme et décidé dans la manière d’affronter les situations qui peuvent donner scandale et tous les cas d’abus, en particulier à l’égard des mineurs, en se conformant aux dispositions actuelles.
Enfin, le Pasteur est appelé à cultiver les vertus humaines que les Pères conciliaires ont voulu mentionner dans le décret Presbyterorum ordinis (n. 3) et qui, à plus forte raison, sont d’une grande aide pour l’évêque dans son ministère et dans ses relations. Nous pouvons mentionner la loyauté, la sincérité, la magnanimité, l’ouverture d’esprit et de cœur, la capacité de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de souffrir avec ceux qui souffrent; ainsi que la maîtrise de soi, la délicatesse, la patience, la discrétion, une grande disposition à l’écoute et au dialogue, la disponibilité au service. Ces vertus, dont chacun de nous est plus ou moins doté par nature, nous pouvons et devons les cultiver à l’image de Jésus-Christ, avec la grâce du Saint-Esprit.
Très chers amis, que l’intercession de la Vierge Marie et des saints Pierre et Paul vous obtienne, à vous et à vos communautés, les grâces dont vous avez le plus besoin. En particulier, qu’ils vous aident à être des hommes de communion, à promouvoir toujours l’unité dans le presbyterium diocésain, et que chaque prêtre, sans exception, puisse faire l’expérience de la paternité, de la fraternité et de l’amitié de l’évêque. Cet esprit de communion encourage les prêtres dans leur engagement pastoral et fait grandir l’unité de l’Eglise particulière.
Je vous remercie de me garder dans vos prières! Et je prie moi aussi pour vous et vous bénis de tout cœur.
Discours aux évêques scalabriniens
et rédemptoristes
Salle du Consistoire, 26 juin 2025
Service aux migrants
et évangélisation des pauvres
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Que la paix soit avec vous!
Eminences, Excellences, révérends supérieurs,
chers frères, bienvenue!
Je suis heureux de cette rencontre, et je trouve que l’occasion en est belle: le choix de deux Congrégations religieuses de se rencontrer et de discuter avec les confrères dont elles ont fait don à l’Eglise dans le ministère épiscopal. Il s’agit d’un échange qui enrichit certainement les évêques présents, vos communautés et tout le Peuple de Dieu, comme l’enseigne le Concile Vatican II (cf. Const. dogm. Lumen gentium, n. 7; Congrégation pour les religieux et les Instituts séculiers — Congrégation pour les évêques, Directives de base sur les rapports entre les évêques et les religieux dans l’Eglise, n. 2).
L’Eglise est reconnaissante envers vos Instituts, auxquels elle a demandé, à travers la nomination d’évêques parmi leurs membres, un sacrifice non négligeable en temps de pénurie de religieux, étant donné que se priver de confrères engagés dans le service de différences œuvres comporte bon nombre de problèmes. Le général peut-être me dira quelque chose!… Dans le même temps, cependant, elle a fait un très grand don à vos Congrégations, car le service à l’Eglise universelle est pour toute famille religieuse la grâce et la joie la plus belle, comme le confirmeraient certainement vos fondateurs.
En particulier vous, religieux scalabriniens et rédemptoristes, choisis et consacrés pour le service de l’épiscopat et également du cardinalat, vous amenez dans votre ministère l’héritage de deux charismes importants, spécialement de nos jours: le service aux migrants et l’évangélisation des pauvres et de ceux qui sont éloignés.
Saint Alphonse Marie de’ Liguori, entrant en contact avec la misère des quartiers abandonnés de Naples au XVIIIe siècle, renonça à une vie aisée et à une carrière prospère, embrassant la mission d’apporter l’Evangile parmi les derniers.
Saint Jean-Baptiste Scalabrini, un siècle plus tard, sut sentir et s’approprier les espérances et les souffrances de nombreuses personnes qui partaient, laissant tout derrière eux, pour trouver dans des pays lointains un meilleur avenir pour eux et leurs familles. Tous les deux ont été fondateurs, ils devinrent évêques et surent répondre aux défis de systèmes sociaux et économiques qui, bien qu’ils ouvraient de nouveaux horizons à différents niveaux, laissaient derrière eux beaucoup de misère ignorée et de nombreux problèmes, créant de nombreuses poche de pauvreté dont personne ne semblait vouloir d’occuper.
En cette période historique qui présente aussi de grandes opportunités et, dans le même temps, des difficultés et des contradictions, en célébrant le Jubilé de l’espérance, nous voulons rappeler que, hier comme aujourd’hui, la voix à écouter pour comprendre ce qu’il faut faire est celle de «l’amour de Dieu […] répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné» (Rm 5, 5).
Dans notre monde également, l’œuvre du Seigneur nous précède: c’est à elle que nous sommes appelés à conformer nos esprits et nos cœurs à travers un sage discernement; et je suis convaincu que la rencontre que vous avez promue sera très utile à cet effet. Je vous encourage, pour ce faire, à maintenir et à cultiver, aussi pour l’avenir, ces relations d’aide fraternelle avec générosité et désintérêt, pour le bien de tout le Troupeau du Christ. Je vous remercie pour le grand travail que vous faites et je vous bénis de tout cœur, ainsi que toutes vos communautés. Merci!
Audience aux participants à l’Assemblée plénière de la Réunion des Œuvres pour l’Aide aux Eglises Orientales
Salle Clémentine, 26 juin 2025
Le cœur saigne face à une violence jamais vue
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
La paix soit avec vous!
Eminences et Excellences,
chers prêtres, frères et sœurs,
la paix soit avec vous! Je vous souhaite la bienvenue, heureux de vous rencontrer à l’issue de votre Assemblée plénière. Je salue Son Eminence le cardinal Gugerotti, les autres supérieurs du Dicastère, les officials et vous tous, membres des Agences de la ROACO.
«Dieu aime celui qui donne joyeusement» (2 Co 9, 7). Je sais que pour vous, soutenir les Eglises orientales n’est pas d’abord un travail, mais une mission exercée au nom de l’Evangile qui, comme le mot lui-même l’indique, est annonce de joie qui réjouit avant tout le cœur de Dieu, dont la générosité est sans mesure. Merci, parce que, avec vos bienfaiteurs, vous semez l’espérance sur les terres de l’Orient chrétien, aujourd’hui plus que jamais bouleversées par les guerres, vidées par les intérêts, enveloppées d’une chape de haine qui rend l’air irrespirable et toxique.
Vous êtes la bouteille d’oxygène des Eglises orientales, épuisées par les conflits. Pour tant de populations, pauvres en moyens mais riches de foi, vous êtes une lumière qui brille dans les ténèbres de la haine. Je vous prie, de tout cœur, de toujours faire tout votre possible pour aider ces Eglises si précieuses et si éprouvées.
L’histoire des Eglises catholiques orientales a souvent été marquée par la violence qu’elles ont subie; mal-heureusement, les oppressions et les incompréhensions n’ont pas manqué, y compris au sein même de la communauté catholique, incapable de reconnaître et d’apprécier la valeur des traditions différentes de la tradition occidentale. Mais aujourd’hui, la violence belliqueuse semble s’abattre sur les territoires de l’Orient chrétien avec une véhémence diabolique jamais vue auparavant. Votre session annuelle en a également souffert, avec l’absence physique de ceux qui auraient dû venir de la Terre Sainte mais qui n’ont pas pu entreprendre le -voyage. Le cœur saigne en pensant à l’Ukraine, à la situation tragique et inhumaine de Gaza, et au -Moyen-Orient dévasté par la propagation de la guerre. Nous sommes tous appelés, en tant qu’êtres humains, à évaluer les causes de ces conflits, à vérifier celles qui sont réelles et à essayer de les surmonter, et à rejeter celles qui sont fallacieuses, fruit de simulations émotionnelles et de rhétorique, en les démas-quant avec détermination. Les gens ne peuvent pas mourir à cause de fausses nouvelles.
Il est vraiment triste de voir aujourd’hui, dans de nombreux contextes, s’imposer la loi du plus fort, qui légitime les intérêts personnels. Il est désolant de constater que la force du droit international et celle du droit humanitaire ne semblent plus contraindre, remplacées par le prétendu droit de contraindre les autres par la force.
Cela est indigne de l’homme, honteux pour l’humanité et pour les responsables des nations. Comment peut-on croire, après des siècles d’histoire, que les actions belliqueuses apportent la paix et ne se retournent pas contre ceux qui les ont menées? Comment peut-on penser poser les bases de l’avenir sans cohésion, sans une vision d’ensemble animée par le bien commun? Comment peut-on continuer à trahir les aspirations de paix des peuples par la propagande men-songère du réarmement, dans l’illusion vaine que la suprématie résout les problèmes au lieu d’alimenter la haine et la vengeance? Les gens sont de moins en moins ignorants des sommes d’argent allant dans les poches des marchands de mort et qui pourraient servir à construire des hôpitaux et des écoles; au lieu de cela, on détruit ceux qui existent déjà!
Et je me demande: en tant que chrétiens, outre nous indigner, élever la voix et retrousser nos manches pour être des artisans de paix et favoriser le dialogue, que pouvons-nous faire? Je crois qu’il faut avant tout prier sincèrement. C’est à nous de faire de chaque nouvelle tragique et image qui nous touchent un cri d’intercession vers Dieu. Et ensuite, aider, comme vous le faites et comme beaucoup le font, et peuvent le faire à travers vous. Mais il y a plus, et je le dis en pensant particulièrement à l’Orient chrétien: il y a le témoignage. C’est l’appel à res-ter fidèles à Jésus, sans se faire prendre dans les tentacules du pouvoir. C’est imiter le Christ qui a vaincu le mal, en aimant depuis la croix, en montrant une manière de régner différente de celle d’Hérode et de Pilate. L’un, par crainte d’être détrôné, avait tué des enfants qui aujourd’hui ne cessent d’être déchiquetés par les bombes; l’autre s’était lavé les mains, comme nous ris-quons de le faire quotidiennement jusqu’au seuil de l’irréparable. Regardons Jésus, qui nous appelle à guérir les blessures de l’histoire par la seule douceur de sa croix glorieuse d’où émanent la force du pardon, l’espoir d’un nouveau départ, le devoir de rester honnête et transparent dans un océan de corruption. Suivons le Christ qui a libéré les cœurs de la haine, et donnons l’exem-ple permettant de sortir de la logique de la division et de la vengeance. Je voudrais remercier et embrasser par la pensée tous les chrétiens orientaux qui répondent au mal par le bien: merci, frères et sœurs, pour le témoignage que vous donnez, surtout lorsque vous restez sur vos terres comme disciples et comme témoins du Christ.
Chers amis de la ROACO, dans votre travail, outre les nombreuses misères causées par la guerre et le terrorisme — je pense au récent et terrible attentat dans l’église Saint-Elie à Damas —, vous voyez fleurir aussi les germes de l’Evangile dans le désert. Vous découvrez le peuple de Dieu qui persévère en tournant son regard vers le Ciel, en priant Dieu et en aimant son prochain. Vous touchez du doigt la grâce et la beauté des traditions orientales, des liturgies qui laissent Dieu habiter le temps et l’espace, des chants séculaires imprégnés de louange, de gloire et de mystère, qui élèvent une demande incessante de pardon pour l’humanité. Vous rencontrez des figures qui, souvent dans l’ombre, viennent s’ajouter aux grandes foules de martyrs et de saints de l’Orient chrétien. Dans la nuit des conflits, vous êtes témoins de la lumière de l’Orient.
Je voudrais que cette lumière de sagesse et de salut soit mieux connue dans l’Egli-se catholique, où il existe encore beaucoup d’ignorance à ce sujet et où, en certains lieux, la foi risque de s’asphyxier, notamment parce que le vœu exprimé à plusieurs reprises par saint Jean-Paul II ne s’est pas réalisé. Il y a 40 ans, il disait: «L’Eglise doit réapprendre à respirer avec ses deux poumons, celui de l’Orient et celui de l’Occident» (Discours au Sacré Collège des cardinaux, 28 juin 1985). Cependant, l’Orient chrétien ne peut être préservé que s’il est aimé; et on ne l’aime que si on le connaît. Il faut, en ce sens, mettre en œuvre les invitations claires du Magistère à faire connaître ses trésors, par exemple en commençant à organiser des cours de base sur les Eglises orientales dans les séminaires, les facultés de théologie et les centres universitaires catholiques (cf. saint Jean-Paul II, Lett. ap. Orientale lumen, n. 24; Congrégation pour l’éducation catholique, Lettre circ. Eu égard au développement, 9-14). Il est également nécessaire de se rencontrer et de partager l’action pastorale, car les catholiques orientaux ne sont plus aujourd'hui des cousins éloignés qui célèbrent des rites inconnus, mais des frères et sœurs qui, en raison des migrations forcées, vivent à nos côtés. Leur sens du sacré, leur foi cristalline, rendue solide par les épreuves, et leur spiritualité qui embaume du mystère divin peuvent apaiser la soif de Dieu latente mais présente en Occident.
Confions cette croissance commune dans la foi à l’intercession de la Très Sainte Mère de Dieu et des apôtres Pierre et Paul, qui ont uni l’Orient et l’Occident. Je vous bénis et vous encourage à persévérer dans la charité, animés par l’espérance du Christ. Merci.
Homélie de la messe d’ordinations sacerdotales en la solennité
du Sacré-Cœur de Jésus
Basilique Saint-Pierre, 27 juin 2025
Unir par l’amour du Christ
Aujourd’hui, solennité du Sacré-Cœur de Jésus, Journée pour la sanctification des prêtres, nous célébrons avec joie cette Eucharistie à l’occasion du Jubilé des prêtres.
Je m’adresse donc tout d’abord à vous, chers frères prêtres, venus près de la tombe de l’apôtre Pierre pour franchir la Porte Sainte, afin de replonger dans le Cœur du Sauveur vos vêtements baptismaux et sacerdotaux. Pour certains d’entre vous, ce geste s’accomplit en un jour unique de votre vie: celui de l’Ordination.
Parler du Cœur du Christ dans ce contexte, c’est parler de tout le mystère de l’incarnation, de la mort et de la résurrection du Seigneur, qui nous a été confié de manière particulière afin que nous le rendions présent dans le monde. C’est pourquoi, à la lumière des Lectures que nous avons entendues, réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons contribuer à cette œuvre de salut.
Dans la première Lecture, le prophète Ezéchiel nous parle de Dieu comme d’un berger qui passe en revue son troupeau, comptant ses brebis une par une: il cherche celles qui sont perdues, soigne celles qui sont blessées, soutient celles qui sont faibles et malades (cf. Ez 34, 11-16). Il nous rappelle ainsi, en cette période de grands et terribles conflits, que l’amour du Seigneur, auquel nous sommes appelés à nous abandonner et façonner, est universel, et qu’à ses yeux — et donc aussi aux nôtres — il n’y a pas de place pour les divisions et les haines de quelque nature que ce soit.
Dans la deuxième Lecture (cf. Rm 5, 5-11), saint Paul, nous rappelant que Dieu nous a réconciliés «alors que nous n’étions encore capables de rien» (v. 6) et «pécheurs» (v. 8), nous invite à nous abandonner à l’action transformatrice de son Esprit qui habite en nous, dans un chemin quotidien de conversion. Notre espérance repose sur la certitude que le Seigneur ne nous abandonne pas: il nous accompagne toujours. Mais nous sommes appelés à co-opérer avec lui, tout d’abord en plaçant au centre de notre existence l’Eucharistie, «source et sommet de toute la vie chrétienne» (Conc. œcum. Vat. II, -Const. dogm. Lumen gentium, n. 11); ensuite «par la réception avec fruit les sacrements, spécialement par la confession sacramentelle fréquente» (Id., Decr. Presbiterorum ordinis, n. 18); et enfin par la prière, la méditation de la Parole et l’exercice de la charité, en conformant toujours davantage notre cœur à celui «du Père des miséricordes» (ibid.).
Cela nous conduit à l’Evangile que nous avons entendu (cf. Lc 15, 3-7), où il est question de la joie de Dieu — et de tout pasteur qui aime selon son Cœur — pour le retour à la bergerie d’une seule de ses brebis. C’est une invitation à vivre la charité pastorale avec le même grand cœur que le Père, en cultivant en nous son désir: que personne ne se perde (cf. Jn 6, 39), mais que tous, à travers nous aussi, connaissent le Christ et aient en lui la vie éternelle (cf. Jn 6, 40). C’est une invitation à nous unir intimement à Jésus (cf. Presbiterorum ordinis, n. 14), semence de concorde au milieu de nos frères, en chargeant sur nos épaules ceux qui se sont perdus, en accordant le pardon à ceux qui ont fait des erreurs, en allant chercher ceux qui se sont éloignés ou sont restés exclus, en soignant ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, dans un grand échange d’amour qui, jaillissant du côté transpercé du Crucifié, enveloppe tous les hommes et remplit le monde. Le Pape François écrivait à ce sujet: «Un fleuve qui ne s’épuise pas, qui ne passe pas, qui s’offre toujours de nouveau à qui veut aimer, continue de jaillir de la blessure du côté du Christ. Seul son amour rendra possible une nouvelle humanité» (Lett. enc. Dilexit nos, n. 219).
Le ministère sacerdotal est un ministère de sanctification et de réconciliation pour l’unité du Corps du Christ (cf. Lumen gentium, n. 7). C’est pourquoi le Concile Vatican II demande aux prêtres de faire tout leur possible pour «conduire tous à l’unité dans l’amour» (Presbiterorum ordinis, n. 9), en harmonisant les différences afin que «personne ne se sente étranger» (ibid.). Il leur recommande d’être unis à l’évêque et au presbyterium (ibid., nn. 7-8). En effet, plus il y aura d’unité entre nous, plus nous saurons conduire les autres vers la bergerie du Bon Pasteur, pour vivre comme des frères dans la maison unique du Père.
A ce propos, saint Augustin, dans un sermon prononcé à l’occasion de l’anniversaire de son ordination, parlait d’un fruit joyeux de la communion qui unit les fidèles, les prêtres et les évêques, et qui trouve sa racine dans le sentiment d’être tous rachetés et sauvés par la même grâce et la même miséricorde. C’est dans ce contexte qu’il prononçait cette phrase célèbre: «Avec vous, je suis chrétien, pour vous je suis évêque» (Sermo 340, 1).
Lors de la Messe solennelle d’ouverture de mon pontificat, j’ai exprimé devant le peuple de Dieu un grand désir: «Une Eglise unie, signe d’unité et de communion, qui devienne ferment pour un monde réconcilié» (18 mai 2025). Je reviens aujourd’hui pour le partager avec vous tous: réconciliés, unis et transformés par l’amour qui jaillit abondamment du Cœur du Christ, marchons ensemble sur ses traces, humbles et déterminés, fermes dans la foi et ouverts à tous dans la charité, portons dans le monde la paix du Ressuscité, avec cette liberté qui vient du fait de nous savoir aimés, choisis et envoyés par le Père.
Et maintenant, avant de conclure, je m’adresse à vous, très chers ordinands, qui, dans quelques instants, par l’imposition des mains de l’évêque et par une effusion renouvelée de l’Esprit Saint, deviendrez prêtres. Je vous dis certaines choses simples, mais que je considère importantes pour votre avenir et pour celui des âmes qui vous seront confiées. Aimez Dieu et vos frères, soyez généreux, fervents dans la célébration des sacrements, dans la prière, surtout dans l’adoration, et dans le ministère. Soyez proches de votre troupeau, donnez votre temps et votre énergie à tous, sans vous ménager, sans faire de différences, comme nous l’enseignent le côté trans-percé du Crucifié et l’exemple des saints. A cet égard, rappelez-vous que l’Eglise, au cours de son histoire millénaire, a eu — et a encore aujourd’hui — de merveilleuses figures de sainteté sacerdotale: depuis les communautés des origines, elle a engendré et connu, parmi ses prêtres, des martyrs, des apôtres infatigables, des missionnaires et des champions de la charité. Profitez pleinement de toute cette richesse: intéressez-vous à leur histoire, étudiez leur vie et leurs œuvres, imitez leurs vertus, laissez-vous enflammer par leur zèle, invoquez souvent et avec insistance leur intercession! Notre monde propose trop souvent des modèles de réussite et de prestige discutables et inconsistants. Ne vous laissez pas séduire! Regardez plutôt l’exemple solide et les fruits de l’apostolat, souvent caché et humble, de ceux qui ont servi le Seigneur et leurs frères avec foi et dé-vouement, et perpétuez leur mémoire par votre fidélité.
Confions-nous enfin tous à la protection maternelle de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère des prêtres et Mère de l’espérance: qu’elle accompagne et soutienne nos pas, afin que chaque jour nous puissions configurer toujours davantage notre c œur à celui du Christ, Pasteur suprême et éternel.
Message aux prêtres à l’occasion
de la Journée de la sanctification sacerdotale
Bâtisseurs d’unité et de paix
Chers frères dans le sacerdoce!
En cette Journée de la sanctification des prêtres, que nous célébrons en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, je m’adresse à chacun de vous avec un cœur reconnaissant et plein de confiance.
Le Cœur du Christ, transpercé par amour, est la chair vivante et vivifiante qui accueille chacun de nous, nous transformant à l’image du Bon Pasteur. C’est là que l’on comprend la véritable identité de notre ministère: ardents de la miséricorde de Dieu, nous sommes les témoins joyeux de son amour qui guérit, accompagne et rachète.
La fête d’aujourd’hui renouvelle donc dans nos cœurs l’appel à nous donner totalement au service du peuple saint de Dieu. Cette mission commence par la prière et se poursuit dans l’union avec le Seigneur, qui ravive continuellement en nous son don: la sainte vocation au sacerdoce.
Se souvenir de cette grâce, comme l’affirme saint Augustin, signifie entrer dans un «sanctuaire vaste et sans fond» (cf. Confessions, X, 8. 15), qui ne se contente pas de conserver quelque chose du passé, mais rend toujours nouveau et actuel ce qui y est déposé. Ce n’est qu’en faisant mémoire que nous vivons et faisons revivre ce que le Seigneur nous a confié, en nous demandant de le transmettre à notre tour en son nom. La mémoire unifie nos cœurs dans le Cœur du Christ et notre vie dans la vie du Christ, de telle sorte que nous devenons capables d’apporter au Peuple saint de Dieu la Parole et les Sacrements du salut, pour un monde réconcilié dans l’amour. Ce n’est que dans le cœur de Jésus que nous trouvons notre véritable humanité d’enfants de Dieu et de frères entre nous. Pour ces raisons, je voudrais aujourd’hui vous adresser une invitation pressante: soyez des artisans d’unité et de paix!
Dans un monde marqué par des tensions croissantes, même au sein des familles et des communautés ecclésiales, le prêtre est appelé à promouvoir la réconciliation et à générer la communion. Etre des artisans d’unité et de paix signifie être des pasteurs capables de discernement, habiles dans l’art de composer les fragments de vie qui nous sont confiés, pour aider les personnes à trouver la lumière de l’Evangile au milieu des tourments de l’existence; cela signifie être des lecteurs avisés de la réalité, en allant au-delà des émotions du moment, des peurs et des modes; cela signifie offrir des propositions pastorales qui engendrent et régénèrent la foi en cons-truisant de bonnes relations, des liens de solidarité, des communautés où brille le style de la fraternité. Etre des artisans d’unité et de paix signifie ne pas s’imposer, mais servir. En particulier, la fraternité sacerdotale devient un signe crédible de la présence du Ressuscité parmi nous lorsqu’elle caractérise le cheminement commun de nos presbyteriums.
Je vous invite donc à renouveler aujourd’hui, devant le Cœur du Christ, votre «oui» à Dieu et à son peuple saint. Laissez-vous façonner par la grâce, gardez le feu de l’Esprit reçu lors de votre ordination afin que, unis à Lui, vous puissiez être sacrement de l’amour de Jésus dans le monde. N’ayez pas peur de votre fragilité: le Seigneur ne cherche pas en effet des prêtres parfaits, mais des cœurs humbles, disposés à la conversion et prêts à aimer comme Lui-même nous a aimés.
Très chers frères prêtres, le Pape François nous a proposé à nouveau la dévotion au Sacré-Cœur comme lieu de rencontre personnelle avec le Seigneur (cf. Lett. enc. Dilexit nos, n. 103), donc comme lieu où apporter et résoudre nos conflits intérieurs et ceux qui déchirent le monde contemporain, car «en Lui, nous devenons capables d’entrer en relation de manière saine et heureuse et de construire dans ce monde le Royaume de l’amour et de la justice. Notre cœur uni à celui du Christ est capable de ce miracle social» (ibid., n. 28).
Au cours de cette Année Sainte, qui nous invite à être des pèlerins de l’espérance, notre ministère sera d’autant plus fécond qu’il sera enraciné dans la prière, le pardon, la proximité avec les pauvres, les familles, les jeunes en quête de vérité. Ne l’oubliez pas: un prêtre saint fait fleurir la sainteté autour de lui.
Je vous confie à Marie, Reine des Apôtres et Mère des prêtres, et je vous bénis de tout cœur.
Du Vatican, le 27 juin 2025
Léon PP. XIV
Discours aux membres de la délégation du Patriarcat œcuménique
Bibliothèque privée du Palais apostolique, 28 juin 2025
Vers la pleine communion
avec l’écoute et le dialogue
Eminence,
Chers frères dans le Christ!
Je suis particulièrement heureux d’accueillir, pour la première fois depuis mon élection en tant qu’Evêque de Rome et Successeur de l’apôtre Pierre, votre délégation qui représente l’Eglise sœur de Constantinople tandis que nous célébrons la fête des saints Pierre et Paul, patrons de l’Eglise de Rome. Cet échange traditionnel de délégations entre les deux Eglises à l’occasion des fêtes respectives des saints patrons est le signe de la profonde communion déjà existante entre nous et est le reflet du lien de fraternité qui unit les apôtres Pierre et André.
Après des siècles de désaccords et d’incompré-hensions, la reprise d’un dialogue authentique entre les Eglises sœurs de Rome et de Constantinople a été possible grâce aux pas courageux et clairvoyants accomplis par le Pape Paul VI et le Patriarche œcuménique Athénagoras. Leurs vénérables successeurs aux Sièges de Rome et de Constantinople ont poursuivi avec conviction le même chemin de réconciliation, renforçant davantage nos relations. A ce propos, je souhaite mentionner le témoignage de proximité sincère à l’égard de l’Eglise catholique rendu par le Patriarche œcuménique Sa Sainteté Bartholomée à travers sa participation en personne aux funérailles du Pape François et à la Messe d’inauguration de mon pontificat.
Alors que je rappelle avec une vive gratitude le chemin accompli jusqu’à présent, je vous assure de mon intention de persévérer dans l’effort pour rétablir la pleine communion visible entre nos Eglises. Cet objectif ne peut être atteint qu’avec l’aide de Dieu, à travers un engagement constant d’écoute respectueuse et de dialogue fraternel. Je suis donc ouvert à toute suggestion à ce propos, en consultant toujours mes confrères évêques de l’Eglise catholique qui partagent avec moi, chacun à sa façon, la responsabilité pour la pleine et visible unité de l’Eglise (cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23).
Eminence, chers frères dans le Christ, je vous suis très reconnaissant pour votre présence à Rome en cette solennelle circonstance. Je vous demande, s’il vous plaît, de transmettre mon cordial salut au Patriarche Bartholomée et aux membres du Saint-Synode, avec ma reconnaissance pour avoir envoyé la Délégation cette année aussi. Que l’intercession des saint Pierre et Paul, de saint André et de la Sainte Mère de Dieu, qui vivent éternellement dans la parfaite communion des saints, nous accompagne et nous soutienne dans notre engagement au service de l’Evangile. Merci!
Discours aux pèlerins de l’Eglise grecque-catholique ukrainienne
Basilique Saint-Pierre, 28 juin 2025
«Je partage la douleur
pour cette guerre insensée»
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
La paix soit avec vous.
Chers frères dans l’épiscopat, religieuses et religieux, chères sœurs, chers frères!
Je vous salue tous cordialement, chers fidèles de l’Eglise grecque-catholique ukrainienne, venus sur la tombe de l’apôtre Pierre à l’occasion de l’Année jubilaire. Je salue Sa Béatitude Shevchuk, archevêque majeur de Kyiv-Halyč, les évêques, les prêtres, les consacrées et les consacrés ainsi que tous les fidèles laïcs.
Votre pèlerinage est le signe du désir de renouveler votre foi, de renforcer le lien et la communion avec l’Evêque de Rome et de témoigner de l’espérance qui ne déçoit pas, parce qu’elle naît de l’amour du Christ qui a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint (cf. Rm 5, 5). Le Jubilé nous appelle à devenir pèlerins de cette espérance dans toute notre vie, malgré les adversités du moment présent. Votre voyage à Rome, avec le passage des Portes Saintes et les arrêts auprès des tombes des apôtres et des martyrs, est le symbole de ce chemin quotidien, tendu vers l’éternité, où le Seigneur essuiera toute larme et où il n’y a aura plus de mort, ni pleurs, ni cri, ni peine (cf. Ap 21, 4).
Pour arriver ici, beaucoup d’entre vous êtes partis de votre belle terre, riche de foi chrétienne, fécondée par le témoignage évangélique de nombreux saints et saintes et irriguée par le sang de nombreux martyrs qui, au cours des siècles, à travers le don de leur vie, ont scellé la fidélité à l’apôtre Pierre et à ses successeurs.
Très chers amis, la foi est un trésor à partager. Chaque époque porte en elle ses difficultés, ses peines et ses défis, mais aussi des opportunités pour croître dans la confiance et dans l’abandon à Dieu.
La foi de votre peuple est à présent mise à dure épreuve. Beaucoup d’entre vous, depuis que la guerre a commencé, se sont certainement demandé: Seigneur, pourquoi tout cela? Où es-tu? Que devons-nous faire pour sauver nos famille, nos maisons et notre patrie? Croire ne signifie pas avoir déjà toutes les réponses, mais avoir la certitude que Dieu est avec nous et nous donne sa grâce, qu’Il prononcera l’ultime parole et que la vie l’emportera sur la mort.
La Vierge Marie, si chère au peuple ukrainien, qui à travers son «oui» humble et courageux, a ouvert la porte à la rédemption du monde, nous assure que notre «oui», simple et sincère, peut devenir lui aussi un instrument entre les mains de Dieu pour réaliser quelque chose de grand. Confirmés dans la foi par le Successeur de Pierre, je vous exhorte à la partager avec vos proches, avec vos compatriotes, et avec tous ceux que le Seigneur vous fera rencontrer. Dire «oui» aujourd’hui peut permettre d’ouvrir de nouveaux horizons de foi, d’espérance et de paix, surtout à tous ceux qui souffrent.
Frères et sœurs, en vous accueillant ici, je désire exprimer ma proximité à l’Ukraine martyrisée, aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées et, en particulier, aux familles qui pleurent leurs proches. Je partage votre douleur pour les prisonniers et les victimes de cette guerre insensée. Je confie au Seigneur vos intentions, vos difficultés et tragédies quotidiennes et, surtout, vos désirs de paix et de sérénité.
Je vous encourage à marcher ensemble, pasteurs et fidèles, en gardant le regard fixé sur Jésus, notre salut. Que la Vierge Marie, qui précisément en vertu de son union à la passion du Christ est Mère de l’Espérance, vous guide et vous protège. Je vous bénis de tout cœur, ainsi que vos familles, votre Eglise et votre peuple. Merci.
Homélie à l’occasion de la Solennité des saints Pierre et Paul
Basilique Saint-Pierre, 29 juin 2025
Les diversités, laboratoire d’unité, de fraternité et de réconciliation
Chers frères et sœurs,
nous célébrons aujourd’hui deux frères dans la foi, Pierre et Paul, que nous reconnaissons comme les colonnes de l’Eglise et que nous vénérons comme patrons du diocèse et de la ville de Rome.
L’histoire de ces deux apôtres nous interpelle aussi de près, nous qui formons la communauté des disciples du Seigneur qui pérégrine en ces temps. En regardant leur témoignage, je voudrais souligner deux aspects en particulier: la communion ecclésiale et la vitalité de la foi.
Tout d’abord, la communion ecclésiale. La liturgie de cette Solennité nous montre en effet comment Pierre et Paul ont été appelés à vivre un destin unique, celui du martyre, qui les a unis définitivement au Christ. Dans la première lecture, nous trouvons Pierre qui, en prison, attend l’exécution de la sentence (cf. Ac 12, 1-11); dans la seconde, l’apôtre Paul, lui aussi enchaîné, affirme dans une sorte de testament que son sang va être versé et offert à Dieu (cf. 2 Tm 4, 6-8.17-18). Pierre et Paul donnent tous deux leur vie pour la cause de l’Evangile.
Cependant, cette communion dans l’unique confession de la foi n’est pas une conquête pacifique. Les deux apôtres l’atteignent comme un but auquel ils parviennent après un long cheminement, au cours duquel chacun a embrassé la foi et vécu l’apostolat d’une manière différente. Leur fraternité dans l’Esprit n’efface pas les différences qui étaient les leurs au départ: Simon était un pêcheur de Galilée, Saul était un intellectuel rigoureux appartenant au parti des pharisiens; le premier a tout quitté immédiatement pour suivre le Seigneur; le second a persécuté les chrétiens jusqu’à ce qu’il soit transformé par le Christ ressuscité; Pierre prêche surtout aux Juifs; Paul est poussé à apporter la Bonne Nouvelle aux nations.
Entre les deux, comme nous le savons, les conflits n’ont pas manqué au sujet de la relation avec les païens, au point que Paul affirma: «Quand Céphas est venu à Antioche, je lui ai résisté en face, car il était manifestement dans son tort» (Gal 2, 11). Et cette question, comme nous le savons, sera traitée par le Concile de Jérusalem, où les deux apôtres s’affronteront à nouveau.
Très chers amis, l’histoire de Pierre et Paul nous enseigne que la communion à laquelle le Seigneur nous appelle est une harmonie de voix et de visages qui n’annule pas la liberté de chacun. Nos Patrons ont suivi des chemins différents, ont eu des idées différentes, ils se sont parfois confrontés et affrontés avec une franchise évangélique. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de vivre la concordia apostolorum, c’est-à-dire une communion vivante dans l’Esprit, une harmonie féconde dans la diversité. Comme l’affirme saint Augustin, «un seul jour est consacré à la fête des deux apôtres. Mais eux aussi étaient une seule chose. Bien qu’ils aient été martyrisés à des jours différents, ils étaient une seule chose» (Discours 295, 7.7).
Tout cela nous interroge sur le chemin de la communion ecclésiale, qui naît de l’élan de l’Esprit, unit les diversités et crée des ponts d’unité dans la variété des charismes, des dons et des ministères. Il est important d’apprendre à vivre ainsi la communion, comme unité dans la diversité, afin que la variété des dons, reliée dans la confession de l’unique foi, contribue à l’annonce de l’Evangile. C’est sur cette voie que nous sommes appelés à marcher, en regardant précisément à Pierre et à Paul, car nous avons tous besoin de cette fraternité. L’Eglise en a besoin, les relations entre les laïcs et les prêtres, entre les prêtres et les évêques, entre les évêques et le Pape en ont besoin; tout comme en ont besoin la vie pastorale, le dialogue œcuménique et les relations d’amitié que l’Eglise souhaite entretenir avec le monde. Engageons-nous à faire de nos différences un laboratoire d’unité et de communion, de fraternité et de réconciliation, afin que chacun dans l’Eglise, avec son histoire personnelle, apprenne à marcher avec les autres.
Les saints Pierre et Paul nous interpellent également sur la vitalité de notre foi. Dans l’expérience du disciple, en effet, il y a toujours le risque de tomber dans l’habitude, dans le ritualisme, dans des schémas pastoraux qui se répètent sans se renouveler et sans relever les défis du présent. Dans l’histoire des deux Apôtres, en revanche, nous sommes inspirés par leur volonté de s’ouvrir aux changements, de se laisser interroger par les événements, les rencontres et les situations concrètes des communautés, de rechercher de nouvelles voies pour l’évangélisation à partir des problèmes et des questions posés par nos frères et sœurs dans la foi.
Au cœur de l’Evangile que nous avons entendu, il y a précisément la question que Jésus pose à ses disciples, et qu’il nous adresse aussi aujourd’hui, afin que nous puissions discerner si le cheminement de notre foi conserve son dynamisme et sa vitalité, si la flamme de la relation avec le Seigneur est encore allumée: «Mais vous, qui dites-vous que je suis?» (Mt 16, 15).
Chaque jour, à chaque heure de l’histoire, nous devons toujours prêter attention à cette question. Si nous ne voulons pas que notre être chrétien se réduise à un héritage du passé, comme nous l’a souvent rappelé le pape François, il est important de sortir du risque d’une foi fatiguée et statique, pour nous demander: qui est Jésus-Christ pour nous aujourd’hui? Quelle place occupe-t-il dans notre vie et dans l’action de l’Eglise? Comment pouvons-nous témoigner de cette espérance dans notre vie quotidienne et l’annoncer à ceux que nous rencontrons?
Frères et sœurs, l’exercice du discernement, qui naît de ces questions, permet à notre foi et à l’Eglise de se renouveler continuellement et d’expérimenter de nouvelles voies et de nouvelles pratiques pour l’annonce de l’Evangile. Cela, avec la communion, doit être notre premier désir. Je voudrais aujourd’hui m’adresser en particulier à l’Eglise qui est à Rome, car elle est appelée plus que toute autre à devenir signe d’unité et de communion, Eglise ardente d’une foi vivante, communauté de disciples qui témoignent de la joie et de la consolation de l’Evangile dans toutes les situations humaines.
Dans la joie de cette communion que le cheminement des saints Pierre et Paul nous invite à cultiver, je salue les frères archevêques qui reçoivent aujourd’hui le pallium. Très chers, ce signe, tout en rappelant la tâche pastorale qui vous est confiée, exprime la communion avec l’évêque de Rome, afin que, dans l’unité de la foi catholique, chacun de vous puisse la nourrir dans les Eglises locales qui vous sont confiées.
Je désire ensuite saluer les membres du Synode de l’Eglise gréco-catholique ukrainienne: merci de votre présence ici et de votre zèle pastoral. Que le Seigneur donne la paix à votre peuple!
Et c’est avec une vive reconnaissance que je salue la délégation du Patriarcat œcuménique, envoyée ici par mon très cher frère Sa Sainteté Bartholomée.
Chers frères et sœurs, édifiés par le témoignage des saints apôtres Pierre et Paul, marchons ensemble dans la foi et dans la communion et invoquons leur intercession sur nous tous, sur la ville de Rome, sur l’Eglise et sur le monde entier.
Angelus
Place Saint-Pierre, 29 juin 2025
Faire taire les armes et œuvrer pour la paix grâce au dialogue
Chers frères et sœurs, bon dimanche!
Aujourd’hui est une grande fête pour l’Eglise de Rome, née du témoignage des apôtres Pierre et Paul et fécondée par leur sang et celui de nombreux autres martyrs. De nos jours encore, partout dans le monde, il y a des chrétiens que l’Evangile rend généreux et audacieux, même au prix de leur vie. Il existe ainsi un œcuménisme du sang, une unité invisible et profonde entre les Eglises chrétiennes qui ne vivent pas encore entre elles la pleine communion visible. Je tiens donc à confirmer en cette solennelle fête que mon service épiscopal est un service à l’unité et que l’Eglise de Rome est engagée par le sang des saints Pierre et Paul à servir la communion entre toutes les Eglises.
La pierre, dont Pierre tire son nom, c’est le Christ. Une pierre rejetée par les hommes et que Dieu a faite pierre angulaire. Cette place et les basiliques papales Saint-Pierre et Saint-Paul nous racontent comment ce renversement se poursuit sans cesse. Elles se trouvent à la périphérie de la ville d’autrefois, «hors les murs», comme on dit encore aujourd’hui. Ce qui nous semble grand et glorieux a d’abord été rejeté et expulsé, parce que contraire à la mentalité mondaine. Ceux qui suivent Jésus se trouvent sur le chemin des Béatitudes, où la pauvreté d’esprit, la douceur, la miséricorde, la faim et la soif de justice, l’œuvre pour la paix rencontrent l’opposition et même la persécution. Et pourtant, la gloire de Dieu brille dans ses amis et, tout au long du chemin, elle les façonne, de conversion en conversion.
Chers frères et sœurs, sur les tombes des apôtres, destination millénaire des pèlerins, nous découvrons nous aussi que nous pouvons vivre de conversion en conversion. Le Nouveau Testament ne cache pas les erreurs, les contradictions, les péchés de ceux que nous vénérons comme les plus grands Apôtres. Leur grandeur, en effet, a été façonnée par le pardon. Le Ressuscité est allé les chercher, plus d’une fois, pour les remettre sur son chemin. Jésus n’appelle jamais une seule fois. C’est pourquoi nous pouvons toujours espérer, comme nous le rappelle aussi le Jubilé.
L’unité dans l’Eglise et entre les Eglises, frères et sœurs, se nourrit du pardon et de la confiance réciproque. A commencer par nos familles et nos communautés. En effet, si Jésus a confiance en nous, nous pouvons aussi nous faire confiance les uns aux autres, en son nom. Que les apôtres Pierre et Paul, avec la Vierge Marie, intercèdent pour nous, afin que dans ce monde déchiré, l’Eglise soit une maison et une école de communion.
Le Saint-Père a prononcé les appels suivants:
Chers frères et sœurs, j’assure de ma prière pour la communauté du lycée Barthélémy Boganda de Bangui, en République centrafricaine, en deuil après le tragique accident qui a fait de nombreux morts et blessés parmi les élèves. Que le Seigneur réconforte les familles et toute la Communauté!
Je salue chacun d’entre vous, aujourd’hui tout particulièrement les fidèles de Rome, en cette fête des saints patrons! Je voudrais adresser une pensée pleine d’affection, avec reconnaissance et encouragement pour leur service, aux curés et à tous les prêtres qui travaillent dans les paroisses romaines.
En cette fête, nous célébrons également la Journée du Denier de Saint-Pierre, signe de communion avec le Pape et de participation à son ministère apostolique. Je remercie de tout cœur tous ceux qui, par leur don, soutiennent mes premiers pas de Successeur de Pierre.
Je bénis tous ceux qui participent à l’événement intitulé Quo Vadis, à travers les lieux romains mémoires des saints Pierre et Paul. Je remercie tous ceux qui ont organisé avec dévouement cette initiative qui aide à connaître et à honorer les saints Patrons de Rome. Je salue les fidèles de divers pays venus accompagner leurs archevêques métropolites qui ont reçu aujourd’hui le pallium. Je salue les pèlerins venus d’Ukraine — je prie toujours pour votre peuple —, du Mexique, de Croatie, de Pologne, des Etats-Unis d’Amérique, du Venezuela, du Brésil, le chœur Saints Pierre et Paul d’Indonésie, ainsi que de nombreux fidèles Erythréens vivant en Europe; les groupes de Martina Franca, Pontedera, San Vendemiano et Corbetta; les servants de Santa Giustina in Colle et les jeunes de Sommariva del Bosco.
Je remercie la Pro Loco de Rome Capitale et les artistes qui ont réalisé la décoration florale, Via della Conciliazione et la place Pio XII. Merci! Sœurs et frères, continuons à prier pour que partout les armes se taisent et que l’on travaille pour la paix à travers le dialogue. Bon dimanche à tous!(Mt 16, 15).
Chaque jour, à chaque heure de l’histoire, nous devons toujours prêter attention à cette question. Si nous ne voulons pas que notre être chrétien se réduise à un héritage du passé, comme nous l’a souvent rappelé le pape François, il est important de sortir du risque d’une foi fatiguée et statique, pour nous demander: qui est Jésus-Christ pour nous aujourd’hui? Quelle place occupe-t-il dans notre vie et dans l’action de l’Eglise? Comment pouvons-nous témoigner de cette espérance dans notre vie quotidienne et l’annoncer à ceux que nous rencontrons?
Frères et sœurs, l’exercice du discernement, qui naît de ces questions, permet à notre foi et à l’Eglise de se renouveler continuellement et d’expérimenter de nouvelles voies et de nouvelles pratiques pour l’annonce de l’Evangile. Cela, avec la communion, doit être notre premier désir. Je voudrais aujourd’hui m’adresser en particulier à l’Eglise qui est à Rome, car elle est appelée plus que toute autre à devenir signe d’unité et de communion, Eglise ardente d’une foi vivante, communauté de disciples qui témoignent de la joie et de la consolation de l’Evangile dans toutes les situations humaines.
Dans la joie de cette communion que le cheminement des saints Pierre et Paul nous invite à cultiver, je salue les frères archevêques qui reçoivent aujourd’hui le pallium. Très chers, ce signe, tout en rappelant la tâche pastorale qui vous est confiée, exprime la communion avec l’évêque de Rome, afin que, dans l’unité de la foi catholique, chacun de vous puisse la nourrir dans les Eglises locales qui vous sont confiées.
Je désire ensuite saluer les membres du Synode de l’Eglise gréco-catholique ukrainienne: merci de votre présence ici et de votre zèle pastoral. Que le Seigneur donne la paix à votre peuple!
Et c’est avec une vive reconnaissance que je salue la délégation du Patriarcat œcuménique, envoyée ici par mon très cher frère Sa Sainteté Bartholomée.
Chers frères et sœurs, édifiés par le témoignage des saints apôtres Pierre et Paul, marchons ensemble dans la foi et dans la communion et invoquons leur intercession sur nous tous, sur la ville de Rome, sur l’Eglise et sur le monde entier.
Discours à quatre instituts féminins
Salle Clémentine, 30 juin 2025
Enracinées dans
le Christ pour semer le bien
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
La Paix soit avec vous!
Chères sœurs, bonjour et bienvenue! Je suis heureux de vous rencontrer, certaines d’entre vous à l’occasion de leur Chapitre général, d’autres pour leur pèlerinage jubilaire. Dans les deux cas, vous venez auprès de la tombe de Pierre pour renouveler votre amour au Seigneur et votre fidélité à l’Eglise.
Vous appartenez à des Congrégations nées à des périodes et dans des circonstances diverses: sœurs de l’Ordre de saint Basile le Grand, Filles de la Charité Divine, religieuses augustines «del Amparo», religieuses franciscaines des Sacrés-Cœurs. Pourtant, vos his-toires révèlent une dynamique commune, par laquelle la lumière de grands modèles de vie spirituelle du passé — comme Augustin, Basile, François — à travers l’ascèse, le courage et la sainteté de vie de fondateurs et fondatrices, a suscité et fait croître de nouveaux chemins de service, en particulier à l’égard des plus faibles; enfants, jeunes filles et jeunes garçons pauvres, orphelins, migrants, auxquels se sont ajoutés au fil du temps les personnes âgées et les malades, ainsi que nombreux autres ministères de charité.
Les vicissitudes de votre passé et la vivacité du présent montrent clairement que la fidélité à la sagesse antique de l’Evangile est le meilleur moteur pour ceux qui, poussés par l’Esprit Saint, s’engagent sur de nouvelles voies de don de soi, vouées à l’amour de Dieu et du prochain, dans une écoute attentive des signes des temps (cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, nn. 4; 11).
C’est précisément en pensant à cela que le Concile Vatican II, en parlant des instituts religieux con-sacrés aux services de la charité, a souligné à quel point il est important que «toute la vie religieuse de leurs membres doit être pénétrée d’esprit apostolique et toute l’action apostolique doit être animée d’esprit religieux» (Décr. Perfectae caritatis, 8), afin que les religieux puissent «répondre avant tout à leur vocation de suivre le Christ et servir le Christ lui-même dans ses membres […] en union intime avec lui» (ibid.).
A ce propos, saint Augustin, en parlant du primat de Dieu dans la vie chrétienne, affirme: «Dieu est tout pour toi. As-tu faim? Dieu te sert de pain. Es-tu altéré? Dieu te rafraîchit. Es-tu dans les ténèbres? Dieu est ta lumière, parce qu’il reste incorruptible. Es-tu nu? Dieu sera le vêtement de ton immortalité» (In Joannis Evangelium, 13, 5). Ce sont des paroles par lesquelles il est bon de se laisser interroger: dans quelle mesure cela est-il vrai pour moi? Dans quelle mesure le Seigneur étanche-t-il ma soif de vie, d’amour, de lumière? Ce sont des questions importantes. En effet, c’est cet enracinement dans le Christ qui a conduit ceux qui nous ont précédés — hommes et femmes comme nous, avec des dons et des limites comme les nôtres — à faire des choses qu’ils n’auraient sans doute jamais pensé pouvoir réaliser, leur permettant de jeter des graines de bien qui, traversant les siècles et les continents, ont atteint aujourd’hui pratiquement le monde entier, comme le démontre votre présence.
Certaines d’entre vous, comme je l’ai évoqué, sont engagées dans leur Chapitre général, d’autres sont ici pour leur Jubilé. Il s’agit quoi qu’il en soit de faire des choix importants dont dépend leur propre avenir, celui des religieuses et celui de l’Eglise. C’est pourquoi il me semble très opportun de conclure en répétant pour nous tous le très beau souhait que saint Paul adressait aux chrétiens d’Ephèse: «Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l’amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu’est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur, vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude de Dieu» (Ep 3, 17-19). Merci pour votre travail et pour votre fidélité. Que la Vierge Marie vous accompagne, avec ma Bénédiction.
Message à la 44e session
de la Conférence de la FAO
Cesser l’utilisation injuste
de la faim comme arme de guerre
Monsieur le président, Monsieur le directeur général de la FAO, Excellences, Mesdames et Messieurs, Je vous remercie de tout cœur de m’avoir donné l’occasion de m’adresser pour la première fois à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui célèbre cette année le 80e anniversaire de sa fondation. Je salue cordialement tous les participants à cette 44e session de la Conférence, son organe suprême de direction, et en particulier le directeur général, M. Qu Dongyu, le remerciant pour le travail que l’Organisation accomplit chaque jour pour chercher des réponses adéquates au problème de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition qui continue de représenter l’un des plus grands défis de notre temps.
L’Eglise encourage toutes les initiatives visant à mettre fin au scandale de la faim dans le monde, en faisant siens les sentiments de son Seigneur Jésus qui, comme le racontent les Evangiles, voyant une grande foule s’approcher de Lui pour écouter sa parole, se préoccupa avant tout de lui donner à manger et pour cela, demanda à ses disciples de prendre en main ce problème, bénissant avec abondance les efforts accomplis (cf. Jn 6, 1-13). Toutefois, quand nous lisons le récit de ce qui est communément appelé la «multiplication des pains» (cf. Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 12-17; Jn 6, 1-13), nous nous rendons compte que le véritable miracle accompli par le Christ a été de mettre en évidence que la clé pour vaincre la faim consiste davantage à partager qu’à accumuler de façon avide. Ce que nous avons sans doute oublié aujourd’hui parce que, bien que des pas importants aient été accomplis, la sécurité alimentaire mondiale continue de se détériorer, ce qui rend toujours plus improbable d’atteindre l’objectif «Faim zéro» de l’agenda 2030. Cela signifie que nous sommes loin de remplir le mandat qui, en 1945, a donné naissance à cette institution intergouvernementale.
Il y a des personnes qui souffrent cruellement et qui désirent voir leurs nombreux besoins satisfaits. Nous savons bien qu’elles ne peuvent pas les satisfaire seules. La tragédie constante de la faim et de la malnutrition généralisées, qui persiste aujourd’hui dans de nombreux pays, est encore plus triste et honteuse quand nous nous rendons compte que, bien que la terre soit capable de produire assez de nourriture pour tous les êtres humains, et en dépit des engagements internationaux en matière de sécurité alimentaire, malheureusement, de nombreux pauvres du monde continuent de ne pas recevoir leur pain quotidien.
D’autre part, nous assistons aujourd’hui avec tristesse à l’utilisation injuste de la faim comme arme de guerre. Faire mourir de faim la population est une façon très économique de faire la guerre. C’est pourquoi aujourd’hui, alors que la majorité des conflits n’est pas combattue par des armées régulières, mais par des groupes de civils armés disposant de faibles ressources, brûler les terres, voler le bétail, bloquer les aides sont des tactiques de plus en plus utilisées par ceux qui veulent contrôler des populations entières sans défense. Ainsi, dans ce type de conflits, les premiers objectifs militaires deviennent les réseaux d’approvisionnement hydriques et les voies de communication. Les agriculteurs ne peuvent pas vendre leurs produits dans des contextes menacés par la violence et l’inflation grimpe en flèche. Cela conduit un nombre immense de personnes à succomber au fléau de la famine et à périr, avec le facteur aggravant que, tandis que les civils dépérissent en raison de la misère, les dirigeants politiques s’engraissent à travers la corruption et l’impunité. Il est donc temps que le monde adopte des limites claires, reconnaissables et consensuelles, pour sanctionner ces abus et poursuivre en justice leurs responsables et leurs exécuteurs.
Retarder la recherche d’une solution à cet horizon déchirant n’aidera pas; au contraire, les angoisses et les privations des personnes dans le besoin continueront de s’accumuler, rendant le chemin encore plus difficile et complexe. C’est pourquoi il est impératif de passer des paroles aux faits, en mettant au centre des mesures efficaces qui permettent à ces personnes de regarder leur présent et leur avenir avec confiance et sérénité, et pas seulement avec résignation, mettant ainsi fin à l’époque des slogans et des promesses trompeuses. A cet égard, nous ne devons pas oublier que tôt ou tard, nous devrons rendre compte aux générations futures, qui recevront un héritage d’injustice et d’inégalités, si nous n’agissons pas à présent de façon sensée.
Les crises politiques, les conflits armés et les perturbations économiques jouent un rôle central dans l’aggravation de la crise alimentaire, en freinant les aides humanitaires et en compromettant la production agricole locale, niant ainsi non seulement l’accès à la nourriture, mais également le droit à mener une vie digne et riche d’opportunités. Ce serait une erreur fatale de ne pas soigner les blessures et les fractures provoquées par des années d’égoïsme et de superficialité. En outre, sans paix et sans stabilité, il ne sera pas possible de garantir des systèmes agro-alimentaires résilients, ni assurer une alimentation saine, accessible et durable pour tous. D’où le besoin d’un dialogue dans lequel les parties concernées aient la volonté non seulement de se parler, mais aussi de s’écouter, de se comprendre réciproquement et d’agir ensemble. Les obstacles ne manqueront pas, mais avec un sens d’humanité et de fraternité, les résultats ne pourront être que positifs.
Les systèmes alimentaires ont une grande influence sur le changement climatique et inversement. L’injustice sociale provoquée par les catastrophes naturelles et par la perte de la biodiversité doit être renversée pour réaliser une transition écologique juste, qui place au centre l’environnement et les personnes. Pour protéger les écosystèmes et les communautés les plus défavorisées, parmi lesquelles figurent les peuples autochtones, il faut une mobilisation de ressources de la part des gouvernements, des institutions publiques et privées, des organis-mes nationaux et locaux, afin que l’on adopte des stratégies qui donnent la priorité à la régénération de la biodiversité et de la richesse du sol. Sans une action climatique résolue et coordonnée, il sera impossible de garantir des systèmes agroalimentaires capables d’alimenter une population mondiale en croissance. Produire de la nourriture ne suffit pas, il est également important de garantir que les systèmes alimentaires soient durables et fournissent des régimes sains et accessibles à tous. Il s’agit donc de repenser et de renouveler nos systèmes alimentaires, dans une perspective solidaire, en dépassant la logique de l’exploitation sauvage de la création et en orientant mieux notre engagement à cultiver et à sauvegarder l’environnement et ses ressources, pour garantir la sécurité alimentaire et progresser vers une nourriture suffisante et saine pour tous.
Monsieur le président, en ce moment, nous assistons à une énorme polarisation des relations internationales à cause des crises et des conflits en cours. Des ressources financières et technologiques innovatrices en faveur de l’éradication de la pauvreté et de la faim dans le monde sont déviées pour les destiner à la fabrication et au commerce d’armes. De cette façon, des idéologies discutables se fomentent, et l’on assiste dans le même temps au refroidissement des relations humaines, qui avilit la communion et éloigne la fraternité et l’amitié sociale.
Il n’a jamais été aussi impératif que nous devenions des artisans de paix, œuvrant dans ce sens pour le bien commun, pour ce qui est bon pour tous et pas seulement pour quelques-uns, qui sont d’ailleurs toujours les mêmes. Pour garantir la paix et le développement, entendu comme amélioration des conditions de vie des populations qui souffrent de la faim, de la guerre et de la pauvreté, des actions concrètes, fondées sur des approches sérieuses et clairvoyantes, sont nécessaires. Il faut donc mettre de côté les rhétoriques stériles pour régler, avec une ferme volonté politique, comme l’a dit le Pape François, «les différends dans le but de favoriser un climat de collaboration réciproque et de confiance pour satisfaire des besoins communs» (Discours aux membres du Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, 9 janvier 2023).
Mesdames et Messieurs, dans la réalisation de cette noble cause, je désire assurer que le Saint-Siège sera toujours au service de la concorde entre les peuples et ne se lassera pas de coopérer au bien commun de la famille des nations, en tenant compte en particulier des êtres humains les plus éprouvés, qui souffrent de la faim et de la soif, et aussi des régions reculées qui n’arrivent pas à se relever de leur état de prostration à cause de l’indifférence de ceux qui devraient avoir comme emblème de leur vie l’exercice d’une inlassable solidarité. Avec cette espérance, et me faisant le porte-parole de ceux qui se sentent brisés par l’indigence dans le monde, je demande à Dieu tout-puissant que vos travaux soient riches de fruits, au profit des plus faibles et de l’humanité tout entière.
Du Vatican, le 30 juin 2025
Léon PP. XIV









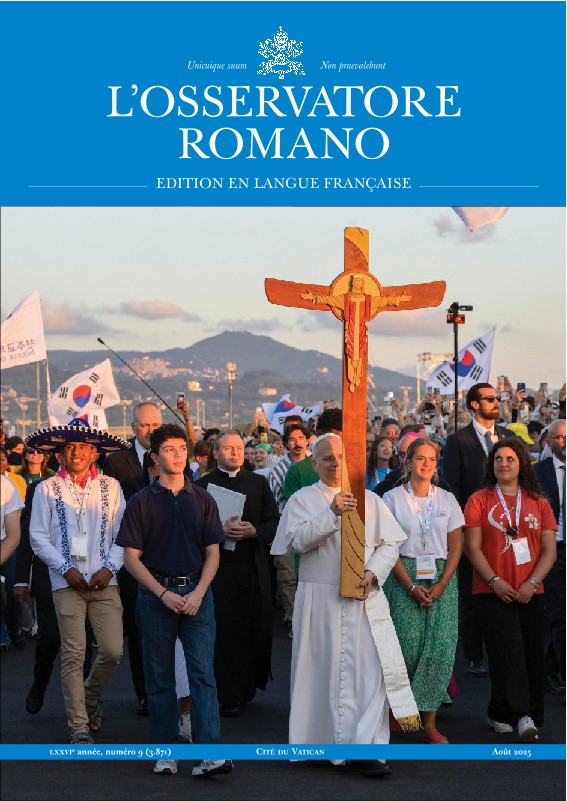



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
