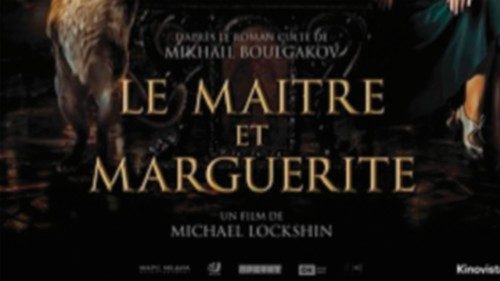
Denis Dupont-Fauville
Chanoine de la basilique Saint-Pierre du Vatican
Il y a au moins trois raisons d’aller voir Le Maître et Marguerite de Michael Lockshin. D’abord parce que, après de nombreuses tentatives, voici enfin une adaptation réussie, voire brillante, du chef d’œuvre de Mikhaïl Boulgakov. Bien sûr, des choix ont dû être faits pour transposer à l’écran l’intrigue infiniment complexe du roman. Ici, le parti-pris consiste à souligner l’histoire d’amour entre les deux personnages éponymes, ainsi que la figure de Satan (le film devait d’ailleurs d’abord s’appeler Woland, du nom d’emprunt du diable). De plus, un niveau de récit supplémentaire est introduit pour montrer comment le texte lui-même a été composé, faisant du Maître un double de Boulgakov. Malgré cela, nous voici emportés dans la complexité du récit et ses multiples strates sans en perdre le fil: amours à Moscou, histoire de Jésus et répression soviétique s’entrecroisent, avec un surprenant pouvoir d’évocation et de miroirs. Le charisme des deux interprètes de Woland et Marguerite, l’un riant d’une ironie cinglante et l’autre suggérant des univers par sa réserve gracieuse, ainsi que l’option courageuse de mêler des dialogues en allemand (quand le mal tranche), latin, hébreu (à Jérusalem) et même français à l’intérieur de la trame russe, donnent au spectateur même non polyglotte de passer d’une émotion à l’autre sans effort.
Ensuite parce que le film nous adresse un avertissement salutaire sur le pouvoir du mal, l’asservissement au totalitarisme, les illusions des fausses libertés et la facile perte progressive du sens moral. Le communisme en prend pour son grade, mais la dimension parabolique est évidente et trouverait bien des applications actuelles: face à la magie du verbe et à l’importance du dialogue, tant de censures peuvent entraîner tant de perversions, parfois inattendues. A cet égard, il est remarquable que le film, financé par des fonds russes et confié à un réalisateur vivant aux Etats-Unis, ait remporté un énorme succès en Russie tout en déclenchant les foudres de diverses instances politiques. La réalité dépasse les lectures idéologiques, l’histoire de l’œuvre rejoignant ici son message.
Enfin et paradoxalement parce que, malgré toutes ces qualités, la richesse du roman se trouve loin d’être épuisée. Pas seulement à cause d’insuffisances techniques (effets spéciaux, musique ou mise en scène se relâchent par moments), mais surtout parce que, au-delà du grand spectacle et de l’histoire passionnelle, la dimension métaphysique est curieusement absente. Peu de silences, une manière de filmer la chair qui oscille entre superficialité et voyeurisme, jusqu’à un Jésus presque benêt en regard du charme luciférien, autant d’incitations à (re)lire l’œuvre originale, pour retrouver le vertige des ques-tions existentielles et la soif inassouvie d’un désir pourtant plus fort que la mort. Le film se clôt sur un incendie là où le livre débouchait sur Pâques: comment transmettre aujourd’hui une telle espérance?









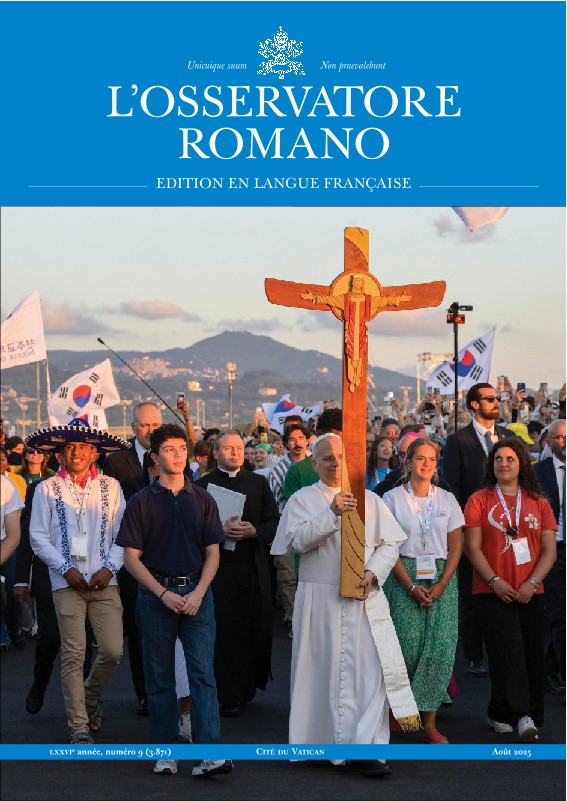



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
