
Gaetano Vallini
La couverture du dernier numéro de la revue Voci di dentro (revue écrite en collaboration avec des détenus des prisons italiennes de Chieti et Pescara, ndlr) représente sur une pleine page des personnes élégamment vêtues, tranquillement assises aux tables d’un restaurant, tandis qu’à l’extérieur, derrière les vitres, le monde brûle. Le titre qui l’accompagne est significatif: «La zone d’intérêt», une référence au très beau film homonyme de Martin Amis, sorti il y a deux ans, récompensé par deux Oscars, qui, en renversant les points de vue, montre l’horreur d’Auschwitz depuis la maison du commandant du camps d’extermination, Rudolf Höss, construite à proximité des murs d’enceinte du camp, dans la «zone d’intérêt», précisément, comme les nazis appelaient la zone qui entouraient l’usine de mort la plus meurtrière de l’histoire. Une maison d’où l’on ne voit rien de ce qui se passe à l’intérieur du camp, mais d’où l’on entend les cris des SS et des prisonniers, les coups de fusils, les aboiements des chiens, le bruit incessant des crématoriums, jour et nuit, avec la cendre humaine emportée parfois par le vent dans le jardin. Tout le monde est au courant dans la maison, mais la vie s’écoule dans une apparente et troublante normalité.
C’est une intuition intéressante qu’a eue la direction de la belle revue qui s’occupe du monde carcéral, parce qu’elle offre une lecture amère de ce qui se passe aujourd’hui dans le monde. Face aux guerres qui ensanglantent la Palestine, l’Iran, Israël, le Liban, le Yémen, l’Ukraine, la République démocratique du Congo, le Soudan, la Birmanie — pour ne rappeler que celles qui sont le plus citées de cette troisième guerre mondiale par morceaux évoquée par le Pape François — on risque de devenir comme les clients de ce restaurant: conscients de ce qui se passe à l’extérieur, mais désintéressés, comme si tout cela ne nous regardait pas. Comme si nous étions en train de nous habituer aux morts, aux destructions, à la douleur et à la terreur de ceux qui sont sous les bombes. Pire, après avoir vu pendant des années ces images — qui auparavant au moins nous indignaient — peut-être commencent-elles même à nous agacer, car elles perturbent nos vies tranquilles. Nous ne nous préoccupons même plus quand nous entendons quelqu’un menacer d’em-ployer des armes atomiques. Pourtant, jusqu’il y a peu de temps, cela était le spectre de la pire et presque innommable des catastrophes, au point que l’on avait construit sur cette peur un équilibre de paix qui a tenu pendant des décennies.
Mais nous ne sommes pas les seuls à risquer de rester indifférents. Et c’est l’aspect le plus alarmant. La communauté internationale semble désormais assister comme un spectateur impartial, sans trouver la force d’intervenir pour arrêter ces guerres, dont certaines semblent vraiment ne susciter aucun intérêt. La diplomatie ne trouve même pas les mots pour condamner des actions abominables, otage d’intérêts partisans et d’un passé qui étouffe la vérité, même la plus évidente.
L’apathie ou la connivence silencieuse de cette époque seront jugées par l’histoire comme l’ont été sans ambiguïtés celles du passé. Mais faudra-t-il vraiment attendre ce jugement, tardif, ou ne serait-il pas préférable de passer à l’histoire pour avoir évité d’autres massacres inutiles? Il y a une paix désarmée et désarmante à construire dès à présent et à préserver, pour reprendre les paroles de Léon XIV, qui à l’Audience générale du 18 juin, a demandé de ne pas s’habituer à la guerre, c’est-à-dire de sortir de la «zone d’intérêt». Parce qu’il n’est jamais trop tard pour la paix. Même si l’on a déjà fait preuve d’un retard coupable.









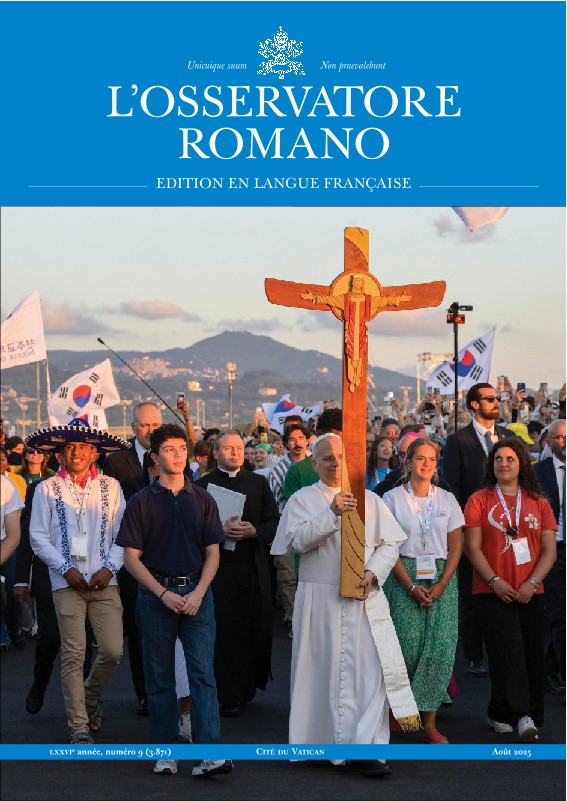



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
