
Le philosophe Jean-Luc Nancy a écrit que « le spirituel ne peut se manifester que comme une tension corporelle » et si cela est vrai, alors le cinéma, l’art du visible, du sensoriel, du corps mis en scène, se révèle être, de manière surprenante, un langage approprié pour raconter la spiritualité et la mystique des corps.
Pendant des siècles, le corps a été pour la spiritualité chrétienne un champ de tension, voire un obstacle : siège fragile du péché, lieu du désir, barrière à franchir pour accéder à la dimension du divin. Mais dans la vie de nombreuses mystiques, cette vision est inversée. Le corps devient l’instrument privilégié de la révélation, le véhicule par lequel Dieu se manifeste. C’est le corps lui-même, dans sa vulnérabilité et son excès, qui devient un espace sacré.
Représenter l’expérience mystique n’est cependant pas une entreprise aisée. Le mysticisme échappe au langage ordinaire et dépasse de par sa nature la forme : il est vision, silence, vide. Mais ici aussi, dans cet échec constant de la parole, le cinéma trouve un terrain fertile : à travers le visage, le rythme, la lumière, le temps suspendu, il peut évoquer ce qu’il ne peut pas montrer.
Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver, dans son livre Transcendental Style in Film (Le film transcendantal au cinéma, publié en français aux éd. Circe), a décrit la façon dont des réalisateurs comme Dreyer, Bresson et Ozu ont fait du style la porte d’entrée pour suggérer l’invisible : en éliminant le superflu, en ralentissant l’action, en faisant du temps une expérience intérieure. Une forme d’ascèse esthétique qui devient, pour le spectateur, une expérience quasi contemplative.
Mais l’inverse peut aussi se produire : que le sacré entre dans le cinéma à travers l’excès, le conflit et la chair. Dans Benedetta (2021), un film récent du « scandaleux » Paul Verhoeven inspiré par la figure historique de la religieuse Benedetta Carlini, les visions divines s’alternent aux expériences sensuelles et la sainteté se confond avec le pouvoir et la transgression. Le film, controversé et délibérément ambigu, met en scène la spiritualité comme corps qui brûle et qui saigne, remettant en question toute distinction rassurante entre foi et folie. Le sacré, au cinéma, peut déranger, scandaliser, et même séduire.
Parmi les figures les plus représentées et discutées au cinéma, il y a certainement celle de Jeanne d’Arc. Symbole de pureté et de rébellion, d’obéissance et de subversion, la sainte guerrière a traversé le cinéma du XXe siècle, incarnant les tensions de l’époque. Dans La passion de Jeanne d’Arc (1928), Dreyer filme le visage de Renée Falconetti en gros plans dépouillés et poignants : la sainteté s’écrit dans la chair, dans la souffrance muette, dans la vérité qui transparaît des yeux. Dans Jeanne d’Arc de Luc Besson (1999), Jeanne est au contraire une jeune femme perturbée, déchirée entre la voix divine et la réalité. Combattante, prophétesse, femme d’action plutôt que de silences.
Si dans le visage martyrisé de Renée Falconetti, le cinéma trouve son icône mystique et n’a pas besoin d’effets ou de miracles, c’est parce que Dreyer filme la spiritualité sans médiation, à travers la pure exposition du corps comme lieu sacré. Dans la Jeanne de Besson, le corps est vu comme un champ de tension contradictoire et oscille entre deux pôles : d’une part la sainte guerrière, inspirée par Dieu, et d’autre part, la jeune femme hallucinée, victime de son temps.
Une Jeanne représentée de façon plus hagiographique est en revanche celle incarnée par Ingrid Bergman dans Jeanne d’Arc de Victor Fleming (1948). Le cinéma hollywoodien classique préfère un récit équilibré dans lequel la puissance du mysticisme et du corps n’est pas soulignée, au profit d’une biographie à la mise en scène simple et rigoureuse, qui ne parvient cependant pas à donner la pleine dimension de la profondeur de la figure racontée.
Thérèse (1986) d’Alain Cavalier est un autre film à la structure plus traditionnelle, mais qui réussit nettement mieux dans sa représentation du mysticisme. Le film raconte la courte vie de Sainte Thérèse de Lisieux sans tomber dans la rhétorique religieuse. Alain Cavalier adopte une mise en scène essentielle : des décors réduits au minimum, un faible éclairage, des milieux clos et silencieux. La forme est au service du fond : il ne s’agit pas de montrer des miracles ou des extases spectaculaires, mais de faire ressortir avec délicatesse la relation intime et poignante que Thérèse entretient avec Dieu à travers le quotidien, la maladie et la fragilité du corps.
Le réalisateur construit le récit comme une liturgie intime. Les gestes de la jeune carmélite, comme laver un verre, réciter une prière ou écrire une lettre, acquièrent peu à peu une valeur sacramentelle. L’expérience spirituelle de Thérèse s’exprime à travers la patience, l’obéissance et la tendresse qu’elle réserve à ses consœurs. Le corps, dans ce contexte, est un objet d’ascèse mais aussi un espace de don : Thérèse se consume littéralement dans la maladie et transforme la souffrance en un acte d’amour radical.
Le film raconte la mystique non pas comme un spectacle exceptionnel, mais comme une expérience quotidienne, cachée, incarnée. Thérèse n’a pas de visions, ne reçoit pas de stigmates, ne prêche pas, mais aime, sert, offre. Le film nous invite à redécouvrir la puissance spirituelle de la faiblesse, la foi comme forme extrême d’abandon et de confiance.
Le corps mystique est également un lieu de pouvoir. Les mystiques médiévales, d’Angèle de Foligno à Catherine de Sienne, de Thérèse d’Avila à Veronica Giuliani, ont vécu des expériences spirituelles qui passaient par le corps : visions, extases, stigmates, jeûnes, privations. Il ne s’agit pas de simples expériences intérieures, mais de véritables langages incarnés. Comme cela a été écrit dans plusieurs études, pour de nombreuses femmes médiévales, le corps était l’unique instrument disponible pour exprimer sa relation avec Dieu, dans un contexte qui leur refusait la parole publique et le pouvoir ecclésial. Le corps devient alors non seulement un temple, mais aussi une voix, un geste, une résistance.
Cette dimension profonde et subversive de la mystique féminine est au centre du film La septième demeure (1995) de Márta Mészáros, consacré à la figure d’Edith Stein, philosophe juive convertie au catholicisme, carmélite et finalement martyrisée à Auschwitz, où elle mourra. Le titre fait explicitement référence à l’œuvre de Thérèse d’Avila, Le château intérieur, où l’âme, traversant sept pièces, atteint l’union mystique avec Dieu. Dans la septième pièce, qui pour Edith est le lager, se consume non seulement la fin de la vie, mais aussi l’acte d’offrande le plus élevé. Márta Mészáros filme avec pudeur et rigueur la spiritualité incarnée d’Edith : le silence, la douceur, le dévouement. Il n’y a ni spectacle ni miracle, mais une foi qui traverse le corps et résiste dans la douleur.
Et c’est une autre réalisatrice qui nous offre un autre récit intense de mysticisme féminin. Il s’agit de Margarethe Von Trotta qui, dans Vision de 2009, met en scène la vie de sainte Hildegarde de Bingen, moniale bénédictine, mystique, guérisseuse, philosophe et musicienne du XIIe siècle. La réalisatrice allemande, toujours attentive aux biographies de femmes « hérétiques » en dehors des canons, restitue avec rigueur historique et profondeur émotionnelle la complexité d’une figure capable de conjuguer foi, savoir et autorité dans un monde dominé par les hommes.
Le film évite délibérément les effets spéciaux et la spectacularisation des visions pour se concentrer sur les effets perturbateurs qu’elles produisent sur la communauté et sur les institutions ecclésiastiques. La vision, dans le film, n’est donc pas une image à montrer, mais une expérience à incarner : dans le visage absorbé d’Hildegarde, dans sa voix ferme demandant une audience aux évêques et aux abbés, dans ses gestes concrets. Même le corps, dans la narration de Margarethe von Trotta, n’est pas nié : au contraire, il est un lieu de médiation mystique, un instrument de lutte et de guérison. Hildegarde, souvent immobilisée au lit par des maladies soudaines, réagit avec fierté et créativité, transformant la souffrance en un élan propulseur pour la mission.
C’est précisément cette image de corps silencieux et offert qui nous amène, de manière surprenante, à l’œuvre baroque sans doute la plus célèbre de la mystique sculptée : L’extase de sainte Thérèse de Gian Lorenzo Bernini. Dans cette représentation de la chair qui s’élève et s’abandonne au souffle de l’ange, le corps est l’expression d’une expérience spirituelle si intense qu’elle semble érotique. « La douceur douloureuse de ce contact était si grande que je ne pouvais désirer qu’il cesse », écrit Thérèse dans son journal. Certains observateurs, comme le marquis de Sade, ont noté avec ironie qu’« on a peine à croire qu’elle soit sainte ». Pourtant, c’est précisément dans cette contradiction, entre l’extase et le désir, entre l’esprit et la chair, que se joue le mystère de la mystique féminine.
Cette conscience traverse également la réflexion d’Andreï Tarkovski, qui n’a jamais mis en scène directement des figures de saintes ou de mystiques. Pourtant, son cinéma est empreint d’une profonde spiritualité, d’une tension vers l’absolu qui se manifeste dans la matière même de l’image. Dans Le temps scellé, il écrit : « L’art est une prière. C’est un acte de foi. C’est une tentative d’entrer en contact avec l’absolu ». Pour Tarkovski, le temps sculpté par les images est comme l’âme qui se laisse transformer par la grâce. Ses personnages traversent la douleur, le vide, l’attente : ce sont des pèlerins du sens, des corps offerts à l’inconnu. « La vraie image est celle qui porte en elle un secret », écrit-il. Et en ce sens, même sans saints ni extase, son cinéma est mystique.
Le cinéma, art de la lumière projetée dans l’obscurité, est donc peut-être le langage le plus proche de l’expérience mystique. Non pas parce qu’il peut représenter le divin, mais parce qu’il sait l’évoquer. Comme les saintes qui parlaient à travers la chair, le cinéma parle à travers le corps, la lumière, le visage. Et il laisse le spectateur approcher, en silence, le mystère. Egalement à travers une prise de vue.
Paola Dalla Torre









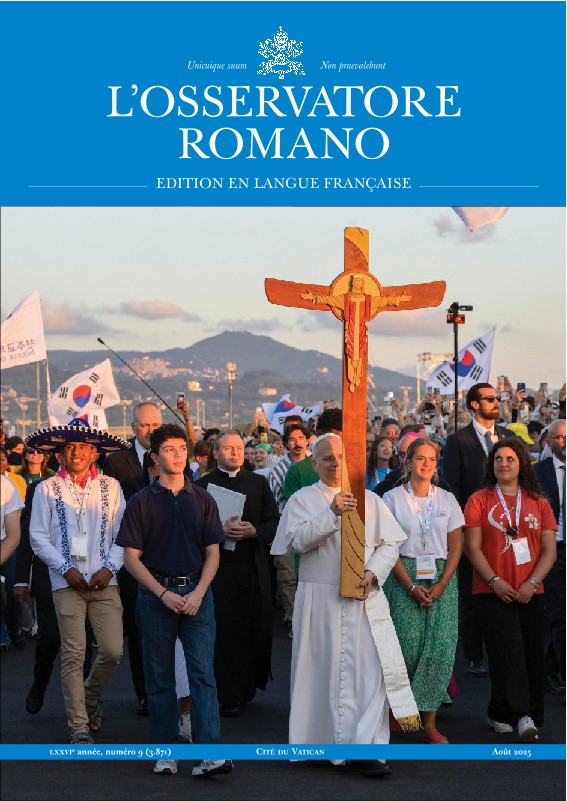



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
