
Si le cinéma, de par sa nature art de la vision, nécessite, formellement, un langage non verbal et, thématiquement, une dramaturgie qui explore les phénoménologies de la crise, le cinéma d'auteur les propose d'autant plus avec une poétique originale, entre recherche et mystère, dans la pluralité des genres : du drame à la comédie, de la comédie musicale à la fantaisie, du film biographique au film d’horreur et dans la stature d’artistes-interprètes comme Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Jennifer Jones, Sophia Loren, Anna Karina, Silvana Mangano, Vanessa Redgrave, Julie Andrews, Susan Sarandon et Meryl Streep.
Et si le regard sur la crise a inclu également la sphère spirituelle, nous le devons aux théoriciens qui ont enquêté sur la présence/absence de Dieu et aux auteurs qui, de manière directe ou indirecte sinon provocatrice, irrévérencieuse sinon blasphématoire, ont élaboré des itinéraires intérieurs de correspondance ou de désaccord entre la foi et l'hérésie, la vocation et la rébellion, la vie active et la vie contemplative. Du classicisme ascétique des Anges du péché (1943) de Robert Bresson à la provocation surréaliste de Viridiana (1961) de Luis Buñuel, de la conflictualité politico-religieuse de Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot (1966) de Jacques Rivette au pamphlet grotesque de The Devils (Les Diables - 1971) de Ken Russell, de la dérision boccacienne du Décaméron (1971) de Pier Paolo Pasolini, reprise par les frères Taviani dans Maraviglioso Boccaccio (2015) jusqu’aux suggestions du regard féminin de Márta Mészáros, Margarethe von Trotta, Liliana Cavani, Anne Fontaine, Margaret Betts et Maura Delpero.
Dans une casuistique aussi variée, un bon début de réflexion peut être la lecture de la crise proposée dans Europe ’51 (1952) de Roberto Rossellini, inspiré de Simone Weil, Herbert Marcuse et d'un fait divers.
La protagoniste, Irène (Ingrid Bergman), femme de la haute bourgeoisie, est choquée, dans le vide de son existence, par la mort de son propre enfant qui s'est suicidé par manque d'affection. Confrontée à un vide impossible à combler, elle s'interroge, dans une démarche ascétique, sur le sens ultime de sa propre douleur et tombe ainsi dans le « péché mortel » de l'anticonformisme, ne se conformant pas à l'insincérité programmatique de l'ensemble des institutions. Ni les membres de la famille, ni le cousin marxiste, ni le prêtre, ni le juge, ni le psychiatre, représentants de l’ordre établi, ne pourront comprendre l’élaboration par Irène de sa douleur, de sa dystopie et des choix radicaux qui en découlent, endurant la nudité dont Simone Weil parle dans ses Carnets. Internée dans une clinique psychiatrique, elle sera au contraire considérée comme une sainte par ceux qu'elle a aimés de manière désintéressée et non conventionnelle.
Avec une surprenante actualité, Roberto Rossellini, anticipant les thèmes des banlieues et des derniers, met en scène l'attention d'Irène pour les déshérités qui vivent en marge et la dure vie des ouvriers d’usines. Avec un « documentaire sur le visage » (« dans l’objectif »), l'auteur raconte un itinéraire existentiel douloureux au terme duquel émergent la folie et la marginalisation, mais aussi l'espérance et la force morale dans un processus de purification dans les traversées de la douleur. L'énonciation « Rossellinienne » révèle ainsi que tout geste d'amour est une expérience du divin et une recherche de l’Absolu.
L'évocation de la clôture, induite par la séquence finale de la grille, vient confirmer ce qu'Irène avait déclaré au juge qui la pressait sur le sens de ses intentions réelles : «… je veux partager la joie de ceux qui sont heureux, la douleur de tous ceux qui souffrent, l'angoisse de ceux qui désespèrent. Je préfère me perdre avec les autres plutôt que de me sauver seule. Seul celui qui est complètement libre peut se mêler à tous, seul celui qui n'est lié à rien est lié à tous les êtres humains ».
Dans la séquence finale ouverte, la protagoniste, à travers son regard « dans l’objectif », interpelle directement le spectateur. A partir des images, épurées à l'exception du visage, filtre, dans l'espace laissé vide par les corps, l'idée du transcendant.
Le recours à la représentation du visage entendu non comme objet partiel, mais comme abstraction de toute coordonnée spatio-temporelle est repris par la stylisation personnelle d'Alain Cavalier dans Thérèse (1986), interprétée par Catherine Mouchet. Avec sa relecture de la figure historique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on pénètre au cœur du claustrum, où l'essentialité du visage fonctionne ici aussi comme une clé herméneutique, un vis-à-vis avec Thérèse, dans une récit sans hiatus entre légèreté et profondeur, vie et mort. Le résultat de cette démarche, qui fait appel à une virtuosité iconographique marquée, n'est pas un portrait apologétique/hagiographique, mais celui d'une adolescente ayant un objectif précis et définitif : devenir sainte.
La nouveauté réside dans un itinéraire d'ascèse stylistique analogue à l'itinéraire spirituel de la protagoniste et, conformément à ce choix, le claustrum fonctionne comme un espace/temps de réflexion sur la vocation, laissant parler les vides plus que les pleins, la raréfaction plus que la condensation, les silences plus que les sons.
La dramaturgie du lieu clos a également captivé un auteur comme Michelangelo Antonioni, apparemment éloigné des thèmes spirituels, mais extrêmement sensible au vide existentiel et à l'absence de sens.
C’est le réalisateur lui-même qui révèle sa fascination après avoir lu le journal d'une religieuse cloîtrée, Catherine Thomas, intitulé My Beloved. The Story of a Carmelite Nun (Mio Amato. La storia di una monaca carmelitana). Tout en avouant son propre désintérêt pour l'ascétisme, mais conscient que la raison n’est pas en mesure d'expliquer la clôture, Michelangelo Antonioni affirme : « Quelle réponse peuvent donner ces religieuses si elles ont choisi par discipline de ne pas donner de réponse ? La difficulté de comprendre leur vie ne dépend ni de la rigueur de la Règle, ni de la manière dont elles l'appliquent. Elle dépend de nous qui ne cherchons pas un temps de réflexion dans le mystère de leur expérience » et cite sainte Thérèse d'Avila : « Souffrir ou mourir, voilà ce que doivent être nos désirs ».
Des trois premières pages du journal, le réalisateur tire, à la fin des années 1970, le sujet de Patire o morire (Souffrir ou mourir), qui l’amène à visiter 14 monastères de clôture et à établir une correspondance avec diverses moniales. A l'une d'entre elles, Antonioni pose une question indiscrète : « Et si je tombais amoureux de vous ? », à laquelle succède une réponse fulgurante : « Ce serait comme allumer une bougie dans une pièce pleine de lumière ». Le long métrage ne verra pas le jour, mais le sujet et le dialogue seront repris dans Par-delà les nuages (1995), les distillant dans l'épisode intitulé Questo corpo di fango (Ce corps de boue), où une jeune fille (Irène Jacob) accepte de faire un bout de chemin dans la ville aux cent fontaines, Aix-en-Provence, où l'eau des fontaines et de la pluie évoque la régénération, avec un inconnu (Vincent Pérez) qui s'enquiert de sa vie, fasciné par sa mystérieuse sérénité. La caméra suit ces déambulations de l'église jusqu'au seuil de la maison où, à la question de savoir si il pourra la revoir, la jeune fille répond comme un éclair : « demain j'entre au couvent ».
A partir de la conscience d'une vocation épanouie, avec Le sang de mon sang (Sangue del mio sangue) de Marco Bellocchio (2015), évolution d'un court-métrage précédent La monaca (Sorelle mai) (2010), est abordé, bien que de manière accessoire, le thème opposé des « monacations » forcées (entrée forcée au couvent) au XVIIème siècle, liées à l'institution du majorat, qui prévoyait l'héritage exclusif des premiers-nés, violant la liberté de choix individuelle, et à l'institution du serviteur de la foi (« fedecommissum »). Un phénomène diffus bien que le Concile de Trente, dans son Decretum de regularibus et monialibus (1563), ait déclaré l'anathème contre ceux qui violaient le libre arbitre, même à travers la contrainte de nature psychologique.
Il existe une vaste littérature sur ce drame dans l'histoire du genre, y compris des adaptations cinématographiques qui ont raconté la vie de la clôture, pour certaines femmes lieu d'affirmation de soi, pour d'autres une demeure forcée, donnant également naissance à un sous-genre particulier, la nonnesploitation (sous-genre du cinéma d’exploitation ), qui a insisté, souvent avec une complaisance morbide, sur la sexualité, la torture et les possessions.
Dans un tout autre registre et jouant sur les différentes époques, le film de Marco Bellocchio raconte l'histoire d'une moniale « forcée », Benedetta (Lidiya Liberman), qui séduit son confesseur Fabrizio (Pier Giorgio Bellocchio) et le pousse à se suicider. Son frère jumeau Federico, un homme d'armes, tente en vain de la convaincre d'avouer qu'elle est une sorcière, et malgré tout, la femme sera enfermée et murée dans une minuscule cellule qui ne possède qu’une fente. Tourné à Bobbio, dans la province de Piacenza, dans la prison aménagée dans une aile de l’abbaye de San Colombano, comme une histoire d'espaces textuellement et métalinguistiquement interconnectés, le film s'appuie sur une série d'éléments pour représenter la mentalité d'une époque imprégnée de pratiques magiques, ascétiques et disciplinaires.
En effet, le film commence par une porte fermée, élément qui relie de manière figurative, entre dissimulation et dévoilement, différentes époques comme un « univers de l'entrebâillement », selon la conception de Gaston Bachelard, qui ferme/ouvre sur des topographies intérieures.
La métaphore de la dualité intérieur/extérieur, lumière/ombre, trouve son point culminant dans la maçonnerie/démolition de la cellule, dans la force imaginative d'une libération, non seulement matérielle, dans la ré-émergence à la lumière. Nous assistons en effet à l'ascension de Benedetta, dans la nudité de son corps non corrompu après une purification/désincarnation atroce, comme une sorte d'anastasis, de résurrection de cet éternel féminin, mémoire et âme du temps.
Tiziana M. Di Blasio
Historienne, professeure émérite du cours de « Théorie et histoire du cinéma » à l'Université pontificale grégorienne.









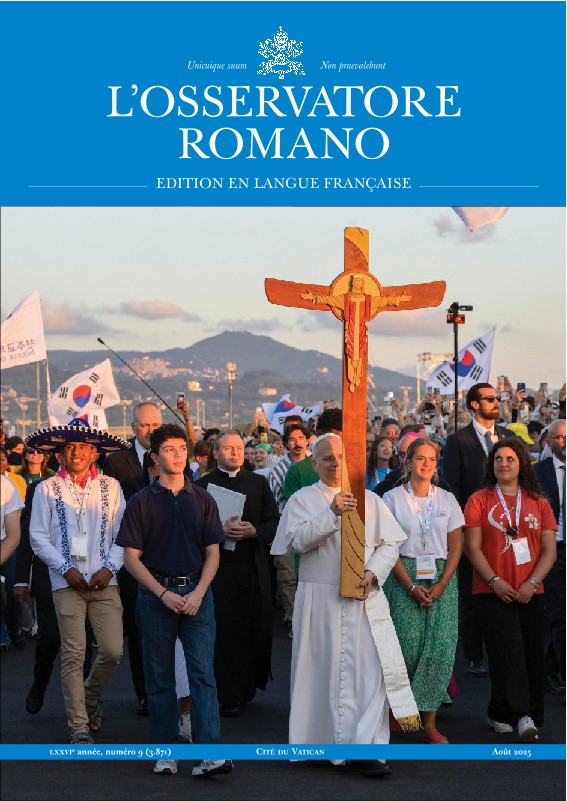



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
