
La contemporanéité étant un concept très instable, pour développer une réflexion qui lui est liée, il est nécessaire de se fixer un point de départ. Ainsi, pour un excursus sur la dimension sacrée de la maternité aujourd’hui au cinéma, il est intéressant de partir de la 75e Mostra de Venise (2018), où concouraient Roma d’Alfonso Cuarón (qui remportera le Lion d’or et trois Oscars) et Suspiria de Luca Guadagnino (remake du film homonyme de Dario Argento). Il s’agit de deux films opposés sur le papier, mais liés par la force puissante avec laquelle ils explorent (se développant dans des directions antithétiques) l’idée de la « mère spirituelle ».
De l’aube de la civilisation à nos jours, le domaine de la maternité reste lié à celui du sacré. La science a analysé l’ensemble du processus dans ses moindres détails, mais l’étincelle « ineffable » d’où jaillit une autre vie continue de susciter un émerveillement sans fin et (il est inutile de le nier) une peur profonde. Cette duplicité se reflète dans la perception que chacun a de sa propre mère. En citant Carl Gustav Jung, l’archétype de la figure maternelle « est projeté sur la mère concrète, lui attribuant pouvoir et fascination ». Le prototype de mère dont hérite l’enfant influence de façon décisive l’idée qu’il se fera de sa propre mère ». Et étant donné que chaque archétype comporte des aspects d’ombre et de lumière, l’image maternelle peut se manifester soit sous une forme resplendissante (liée à une sphère divine de sagesse, de tendresse, de générosité et de fécondité), soit sous une forme ténébreuse (d’où la figure de la « sorcière » ou de la « mater terribilis »). La dimension sacrée humaine étant directement liée à la dimension archétypale, l’idée de maternité spirituelle est aussi bien au centre de Roma (où l’humble servante Cleo devient le pivot émotionnel de la riche famille dont elle s’occupe) que de Suspiria (où la protagoniste, répudiée par sa mère et déçue par l’alternative ésotérique, devient elle-même la Mater suprême, embrassant un matriarcat païen caché au regard masculin).
Au-delà du genre du film d’horreur (où l’angoisse gestationnelle prospère depuis toujours), le cinéma contemporain, surtout féminin, s’attache particulièrement à rejeter ce qu’il définit « la propagande mensongère sur les joies de la maternité », en sondant ses aspects les plus controversés, des enfants de la violence (sujet désormais également débattu par des auteures non occidentales, comme Meryem Benm’Barek dans Sofia, 2018) à la dépression post-partum (il suffit de penser aux très récents Night Bitch de Marielle Heller, 2024, et Die, My Love de Lynne Ramsay, 2025), du déchirement pour la perte d’un enfant (Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó, 2020) au désir obsessionnel d’en avoir un (Lamb de Valdimar Jóhannsson, 2021, Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski, 2022), en passant par le refus de poursuivre une grossesse (L’événement d’Audrey Diwan, 2021).
On peut donc se demander s’il y a encore de la place sur le grand écran pour exprimer une conception de la maternité qui va au-delà du traumatisme (ou de la béatification acritique) et la réponse, étonnamment, est oui. En effet, ces dernières années, il semble presque que le septième art redécouvre sa profonde spiritualité. Capables d’aimer sans réserve des enfants adoptés ou moins chanceux (Vittoria d’Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott, 2025), les nouvelles mères cinématographiques ne se limitent pas à remettre en question les conventions sociales (Madres paralelas de Pedro Almodóvar, 2021, Les Bonnes étoiles, de Hirokazu Kore’eda, 2022, Holy Rosita de Wannes Destoop, 2024), mais vont jusqu’à transcender les limites de la vie elle-même, à la fois dans un sens existentiel (Piccolo Corpo de Laura Samani, 2021, The Eternal Daughter de Joanna Hogg, 2022) et dans un sens spatio-temporel (Petite Maman de Céline Sciamma, 2021, Everything Everywhere All At Once de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, 2022). Et si du regard compatissant de Maura Delpero (déjà auteure de Maternal, 2019) il était presque licite d’attendre une réflexion aux implications mystiques comme Vermiglio (2024), je défie quiconque de s’être attendu à ce que la chirurgicale Julia Ducournau passe de l’hybride fœtus-machine qui dévaste l’utérus féminin (Titane, 2021) à l’apologie de l’étreinte maternelle comme rempart extrême contre la dissolution du monde environnant (Alpha, 2025).
Peut-être parce que nous vivons une époque de solitude désespérée et que, comme l’a suggéré le Pape François, les mères (de sang et de cœur) restent l’antidote le plus puissant contre la propagation de l’individualisme égoïste.
Angela Bosetto









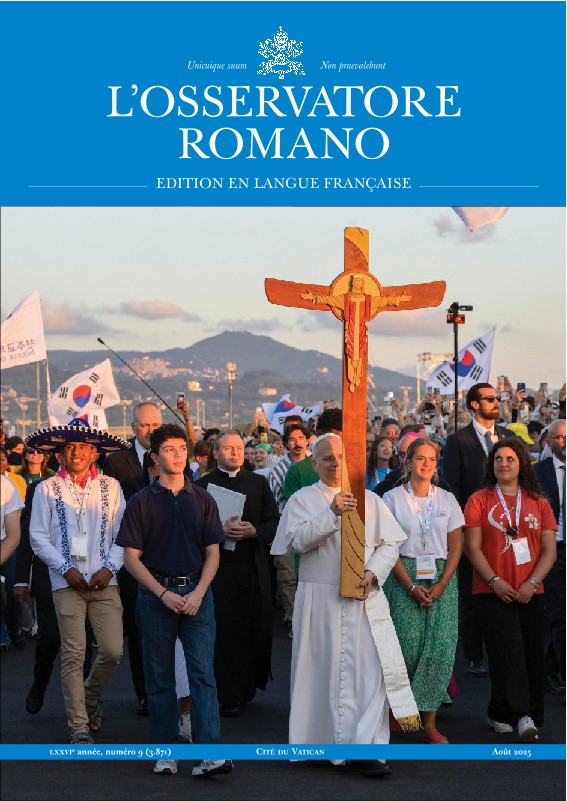



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
