
« Même si, en tant que religieuses, nous devrions être invisibles, Dieu nous a tout de même donné des yeux et des oreilles », déclare avec force sœur Agnes, responsable de la gestion de la Casa Santa Marta au Vatican, au milieu des cardinaux divisés et coupables de scandales et de tromperies, dans Conclave (2024) d’Edward Berger. Un rôle fait notamment de regards et de très peu de mots — mais choisis avec précision — qui a valu à la légendaire Isabella Rossellini sa première nomination aux Oscars.
Et cette aura d’« invisibilité », qui rime pourtant le plus souvent avec une présence attentive, discrète et indispensable dans la vie de l’Église, n’a pas empêché le cinéma de représenter ces figures de consécration féminine — qu’elles soient sœurs, moniales ou abbesses, réelles ou fictives — et de leur accorder toute leur importance, notamment grâce à l’interprétation de grandes actrices, qui ont parfois même été révélées au public par ce rôle.
En portant tout d’abord notre regard sur la représentation de figures de sainteté, apparaît la diversité des lectures avec lesquelles a été interprétée sainte Claire d’Assise, fondatrice de l’ordre des Clarisses : du portrait hagiographique dans Frère Soleil, Sœur Lune (1972) de Franco Zeffirelli à celui, révolutionnaire et féministe, signé Susanna Nicchiarelli dans Chiara (2022). Sainte Thérèse de Lisieux a eu les traits de Catherine Mouchet, alors débutante, dans Thérèse (1986) d’Alain Cavalier, une relecture assez libre de la vie de la carmélite française. C’est l’actrice roumaine Maia Morgenstern qui incarne Edith Stein dans les années les plus difficiles de sa vie, marquées par la quête d’un sens et d’un but à donner à l’existence — quête qu’elle mènera jusqu’à l’abandon total à Dieu et à sa consécration sous le nom de Thérèse-Bénédicte de la Croix — dans La Septième Chambre (1995). Sainte Teresa de Calcutta, alors encore en vie, a été incarnée par Geraldine Chaplin dans Mère Teresa (1997) et plus récemment par Juliet Stevenson dans Les Lettres de Mère Teresa (2014), basé sur la correspondance épistolaire entre la fondatrice des Missionnaires de la Charité et son père spirituel, qui a duré pendant près de cinquante ans. Ce qui ressort de ces figures de sainteté, c’est avant tout la volonté — plus ou moins aboutie — de faire ressortir leur aspect le plus singulier et inédit par rapport à la vie de l’Église de leur temps, sans renoncer à la dimension humaine, faite de fragilité et de lutte personnelle, ou encore de confrontation avec la société (souvent dépeinte comme patriarcale).
Les protagonistes d’œuvres de fiction, ou vaguement inspirées d’événements réels, qui se distinguent par une certaine complexité narrative et un approfondissement psychologique sont plus intéressantes. Au risque de se perdre (1953) de Fred Zinnemann est inspiré de la vie de Marie Louise Habets, ancienne religieuse de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie, ici interprétée par Audrey Hepburn. Sœur Lucie se heurte à la rigidité des règles et à l’obéissance imposée par le couvent dans lequel elle est pourtant entrée librement, malgré les réserves de son père. Après dix-sept ans, passés notamment dans une maison de soins à Anvers et en mission au Congo, elle finit par quitter la vie religieuse pour se consacrer plus pleinement à la charité envers les personnes qui souffrent. Dans Les Lys des champs (1963), un ouvrier afro-américain itinérant croise des sœurs allemandes pauvres et sans grands moyens en Arizona. Celles-ci accueillent évangéliquement cet homme, qui finira par construire une église pour la communauté mexicaine voisine. La Mère Supérieure interprétée par Lilia Skala est un exemple de résistance et de résilience, de confiance en la providence divine — d’où le titre du film, qui évoque le célèbre passage de Matthieu 6, 28-29 — et d’un zèle missionnaire fondé sur l’accueil et le partage.
Dans Agnes of God (1985), les religieuses sont deux et sont interprétées par Anne Bancroft et Meg Tilly, confrontées à l’énigme d’un infanticide impliquant un nouveau-né mis au monde par une jeune sœur. Il ne faut pas non plus oublier sœur Helen Prejean, toujours en vie, de la congrégation des Sisters of Saint Joseph of Medaille, incarnée par Susan Sarandon — récompensée par un Oscar — dans La Dernière Marche (Dead Man Walking, 1995). Appelée à devenir l’aumônière spirituelle d’un meurtrier condamné à mort, sa foi lui donne une lucidité telle qu’elle parvient à concilier la compassion et le sens de la justice, et à aider l’homme à affronter les conséquences de ses actes. Des religieuses en conflit apparaissent dans deux films marquants : le film américain Doute (Doubt, 2008) et le français Les Innocentes (Agnus Dei, 2016). Dans le premier, Amy Adams se retrouve malgré elle à alimenter les soupçons de la supérieure, jouée par Meryl Streep, déterminée à accuser un prêtre de violences sexuelles sur mineurs. Dans le second, les sœurs d’un couvent polonais, tiraillées entre leur nature de femmes et leur choix d’être des épouses du Christ, cherchent dans la maternité — fruit d’un viol collectif — une réponse inédite à leur vocation. Toujours en contexte polonais, il faut également mentionner Anna, la jeune novice protagoniste d’Ida (2013) de Paweł Pawlikowski, qui à la veille de ses vœux perpétuels est envoyée rendre visite à une tante pas très orthodoxe, qui lui révélera les blessures enfouies de son passé.
Un autre domaine à ne pas sous-estimer est celui lié à des thèmes scandaleux et volontairement provocateurs, voire provocants. Associer la figure « virginale » ou du moins vouée à la chasteté d’une religieuse à la dimension sexuelle — que ce soit dans des récits romantiques ou dans des narrations érotiques — stimule l’intérêt voyeuriste du spectateur. Dans Dieu seul le sait (Heaven Knows, Mr. Allison, 1957), réalisé par John Huston, un caporal des marines fait naufrage pendant la Seconde Guerre mondiale sur une île du Pacifique, où il rencontre sœur Angela (Deborah Kerr), restée seule après la fuite de la population locale effrayée par une possible invasion. Le soldat tente alors de l’éloigner du droit chemin vers la perdition. Dans Viridiana (1961), premier film tourné par Luis Buñuel après son exil, Silvia Pinal incarne une novice sur le point de prononcer ses vœux définitifs. Lors d’une visite chez son oncle, bien qu’elle tente de rester fidèle à ses idéaux en accomplissant de bonnes actions, elle se retrouve entraînée dans des situations nettement à la limite de la transgression. Les Diables (1971) raconte l’histoire de sœur Jeanne des Anges (Vanessa Redgrave), supérieure des Ursulines de Loudun, défigurée par une bosse qui l’oblige à une posture bancale. Éperdument amoureuse du prêtre Urbain et jalouse de sa relation avec la douce Madeleine, elle utilisera tous les moyens à sa disposition pour se venger. Dans le film Dans les ténèbres (Entre tinieblas, 1983), œuvre de jeunesse du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, on découvre le couvent des Rédemptrices humiliées, une congrégation fictive dont les sœurs, pour mieux comprendre et sauver les âmes perdues, vont jusqu’à elles-mêmes expérimenter le péché. Parmi les œuvres plus récentes, on peut citer Benedetta (2021), où Paul Verhoeven met en scène — à la limite du blasphème — l’histoire vraie de la religieuse italienne du XVIIe siècle Benedetta Carlini et de la relation charnelle et sentimentale qu’elle entretient pour la première fois avec la jeune novice Bartolomea.
Sur le thème des scandales, c’est la terre catholique d’Irlande qui domine, avec des œuvres, plus ou moins féroces, qui dépeignent la sévérité souvent sadique des religieuses confrontées aux jeunes mères célibataires, comme dans Magdalene (2002), Philomena (2013) et De petites choses comme celles-ci (Small Things Like These, 2024).
Deux autres genres diamétralement opposés dans lesquels on trouve des religieuses comme protagonistes sont le genre de la comédie et, plus récemment, de l’horror. Dans le premier, on peut citer des films très aimés tels que La Cloche du Rhin (The Bells of St. Mary’s, 1945), La Mélodie du bonheur (The Sound of Music, 1965), Dominique (1966), Les Vautours ont faim (The Battle of Neretva, 1970), les deux Sister Act (1992 et 1993) et Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto (2021). En revanche, le public a éprouvé de la frayeur avec les moniales de Conjuring 2 (2016) et les spin-offs The Nun (2018 et 2023), Crucifixion (2017) et Immaculate (2024).
Davide Brambilla









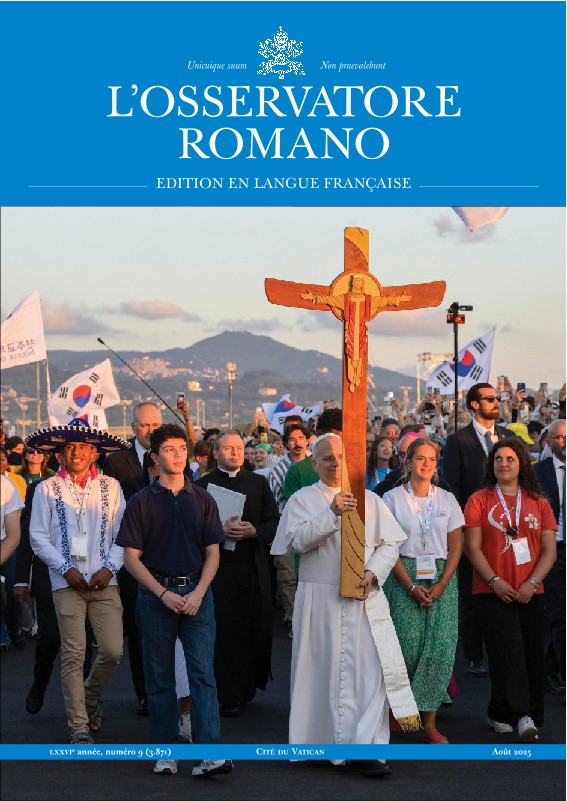



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
