
« C’est ce que je suis », murmure solennellement Arsa, se refusant à la compagnie de quiconque.
Signé par le duo de vidéastes et cinéastes Masbedo (Nicolò Massazza et Iacopo Bedogni), Arsa (2024) est le dernier film en date à raconter le parcours solitaire de plusieurs femmes qui, poussées par des motivations diverses et selon des modalités différentes, ont choisi l’érémitisme comme dimension spirituelle, entendue de manière laïque. Un thème que le cinéma contemporain décline sous diverses formes, mais toujours animé par la même conviction : à travers l’isolement volontaire, les protagonistes peuvent faire l’expérience intime du sacré dans les gestes simples du quotidien, en dehors de tout dogme.
Des femmes qui marchent, attendent, écoutent, cherchent, créent, résistent et préservent la mémoire.
Arsa est une adolescente orpheline de père — artiste et artisan — qui choisit de vivre seule dans une cabane sur l’île de Stromboli. Croyant en l’autosuffisance à tout prix, elle se protège de la « contamination » touristique en vivant en symbiose écologique avec une nature sauvage mais aussi généreuse.
La révolution d’Arsa est une forme de révolution résiliente et silencieuse, consacrée à l’écoute du silence et à l’observation de l’invisible qui se cache en toute chose — y compris dans les déchets abandonnés par les humains et ramenés sur le rivage par la mer, que la jeune fille ramasse chaque jour sur les plages. Car pour cette jeune ermite, la nature est un autel à contempler quotidiennement et à préserver de toute tentative de profanation. Et dans son existence vouée à la solitude, à l’indépendance et à l’écologie, Arsa devient aussi la gardienne de la mémoire paternelle, celle qui lui a appris à régénérer les rebuts en les transformant en petites œuvres d’art.
Bien que dans un contexte spatio-temporel et historique différent, la sédentarité recluse d’Arsa entre en résonance avec celle de Fani, la jeune épouse de Franz restée à la maison dans l’attente des lettres de son mari, objecteur de conscience catholique, mais enrôlé de force dans l’armée de l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Inspiré de la vie de l’Autrichien Franz Jägerstätter à travers sa correspondance, La vie cachée (A Hidden Life, 2019) de Terrence Malick met en scène la co-protagoniste Fani comme l’expression d’une spiritualité silencieuse, vivant l’attente dans l’intimité domestique d’un village isolé au cœur des Alpes, où les gestes simples du quotidien deviennent prière : un érémitisme forcé qui, librement, change de signification pour se transformer en un sacré quotidien comme forme de résistance et de résilience, en parallèle à l’emprisonnement du mari.
En nette opposition avec le fait de résider, le voyage en solitaire comme dimension identitaire — et donc comme geste éthico-spirituel au sein de la laïcité — caractérise au moins deux des œuvres les plus significatives mettant en scène des femmes seules on the road. Il s’agit de Wild, du regretté Jean-Marc Vallée sur un scénario de Nick Hornby, et de Nomadland de Chloé Zhao.
Inspiré du mémorial autobiographique éponyme de Cheryl Strayed, Wild – Une histoire sauvage d’aventure et de renaissance, le film suit une jeune femme dans son périple le long des sentiers du Pacific Crest Trail : un véritable « pèlerinage » à la recherche de guérison et de rédemption pour le corps, l’esprit et l’âme, blessés par les épreuves de la vie (deuils, séparations, drogue). Le sanctuaire auquel aspire Cheryl est intérieur et, selon elle, atteignable par une osmose mystique — faite à la fois de fusion et de résistance — avec la nature sauvage (le « wild » du titre), ainsi que par le renoncement aux conforts habituels, afin d’apprendre à affronter chaque jour ses propres fragilités dans une solitude choisie avec difficulté.
Alors que le parcours presque « expiatoire » de la jeune Américaine correspond à un segment existentiel, le voyage de sa compatriote — plus mûre — Fern définit un choix de vie nomade permanent : la protagoniste de Nomadland est une figure érémitique et errante contemporaine. En opposition directe aux diktats d’un capitalisme déshumanisant, Fern propose une alternative existentielle éthique, dans une autonomie et une solitude totales, tout en restant ouverte à la communication et à la solidarité avec ceux qui l’entourent. Son nomadisme érémitique prend ainsi la forme d’un espace de transcendance, de contemplation, et de sacralité laïque.
Anna Maria Pasetti









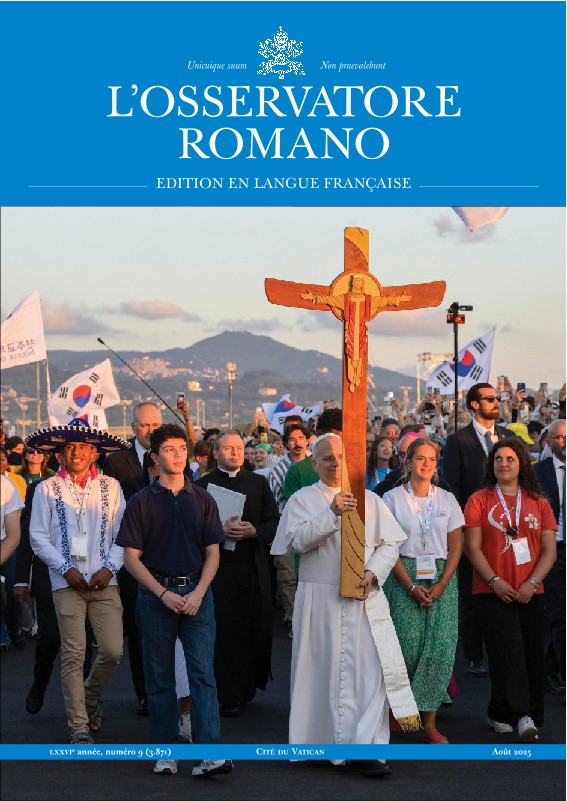



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
