
Une spiritualité féminine qui regarde la personne avant le dogme. Les femmes racontées non plus uniquement victimes, saintes ou madones, mais protagonistes de parcours complexes qui traversent toutes les traditions religieuses : de l’Islam au christianisme, du judaïsme aux spiritualités orientales. Ce numéro de Femmes Eglise Monde explore la façon dont le cinéma construit une mémoire collective inédite de la spiritualité féminine dans laquelle les femmes sont des vraies femmes : fragiles, rebelles, parfois scandaleuses, qui tombent et se relèvent, aiment et doutent, se consacrent et s’égarent. Un nouveau féminin sacré, libre d’être humain.
Ce nouveau modèle émerge clairement dans l’évolution de la figure de la religieuse au cinéma. Dans Doute, Meryl Streep incarne une religieuse américaine conservatrice, sévère et peu encline aux changements, qui se heurte à un curé progressiste, introduisant dans le film le thème du renouveau de l’Eglise dans les années 1960 ; dans Dead Man Walking (La Dernière Marche), Susan Sarandon est une religieuse qui décide d’aider courageusement un condamné à mort qui clame son innocence (l’histoire vraie de sœur Helen Prejean, aujourd’hui âgée de 86 ans, connue pour son engagement contre la peine de mort). En bref, la religieuse du grand écran n’est plus seulement l’épouse silencieuse du Christ, mais une femme qui vit son époque et s’interroge, choisit, s’oppose. Le chemin de la vocation se mêle à celui de la rébellion. La sainteté moderne ne cherche pas la perfection, mais est la capacité d’habiter le doute sans perdre la foi.
Toutefois, la sainteté n’appartient pas seulement à qui prend les vœux. Le cinéma contemporain révèle des formes de sacralité qui se manifestent dans la vie ordinaire : la mère douce et protectrice de The Tree of Life de Terrence Malick, qui introduit la distinction entre deux manières de vivre la vie – la voie de la Nature (égoïsme, survie, orgueil) et la voie de la grâce (amour, humilité, compassion) – et la femme itinérante de Nomadland de Chloé Zhao, qui après avoir tout perdu, choisit de vivre en nomade, sont des figures qui cultivent une relation avec le divin faite de silences, de gestes simples, de fidélité quotidienne. C’est une spiritualité du seuil, discrète, essentielle, non institutionnalisée, que certains considèrent comme une forme puissante de prière contemporaine.
Poursuivant cette exploration, le cinéma ne craint pas de raconter l’histoire de femmes qui semblent prédisposées à une spiritualité plus charnelle, totale, mystique : le corps féminin n’est pas un obstacle à la révélation, il en est l’instrument. La sainteté passe à travers la chair, la douleur, l’amour, l’accouchement, la caresse. C’est une spiritualité incarnée qui ne fuit pas le monde, mais le transforme de l’intérieur. Ingrid Bergman, dans Europe 51 de Roberto Rossellini, est emblématique : elle incarne l’épouse d’un diplomate qui, après la mort de son fils encore adolescent (qui s’est suicidé parce qu’il se sentait abandonné), décide de consacrer son existence à soulager les souffrances de son prochain. De même, Laura Samani dans Piccolo corpo raconte l’histoire d’Agata, une jeune femme du nord-est de l’Italie au début du XXe siècle qui donne naissance à un bébé mort-né et n’accepte pas que sa fille reste « une âme perdue dans les limbes » parce que le prêtre ne peut pas la baptiser.
Dans ces récits, la maternité devient une porte d’accès vers le sacré. Pas seulement biologique, mais aussi symbolique, spirituelle et communautaire. La servante Cleo de Roma d’Alfonso Cuarón, qui s’occupe du mari, de la femme, de la grand-mère, des quatre enfants et du chien d’une famille aisée, accueille la vie, l’accompagne, la protège. Les mères spirituelles du cinéma nous enseignent que la générativité féminine va au-delà de la biologie : c’est la prédisposition de l’âme à nourrir, à faire grandir.
En élargissant le regard aux différentes traditions religieuses, nous découvrons encore au cinéma que la quête spirituelle des femmes ne se laisse pas enfermer dans une foi unique. Les protagonistes de La bicyclette verte, Persepolis et The Breadwinner (Parvana, une enfance en Afghanistan) défient la soumission, mais conservent leur foi et réinventent une relation personnelle avec Dieu. Wadjda, dans le film La bicyclette verte, est une fillette de dix ans qui vit dans la banlieue de Riyad et qui est déterminée à surmonter les limites imposées par sa culture. Marjane, dans Persepolis, est une fillette de 9 ans de Téhéran, rebelle et anticonformiste, qui refuse les règles rigides de la société iranienne. Parvana, dans The Breadwinner, est une fille de 11 ans qui a grandi à Kaboul sous le régime taliban.
La tension entre religion et modernité apparaît donc dans le cinéma comme un thème constant. Le judaïsme orthodoxe de Kadosh, l’islam de What Will People Say (La Mauvaise Réputation), le milieu chrétien orthodoxe de Dieu existe, son nom est Petrunya sont des contextes où les protagonistes sont appelées à choisir entre hériter, se rebeller ou reconstruire. La foi est mise à l’épreuve et les femmes trouvent la force de tracer de nouvelles voies. Dans cette perspective, l’image du pèlerinage est particulièrement significative et revient dans le cinéma contemporain comme métaphore du cheminement spirituel des femmes, dans lequel les voyages physiques deviennent des représentations de transformations profondes. La jeune Cheryl de Wild, à un moment difficile de sa vie, après la fin de son mariage, des problèmes de drogue et la mort de sa mère, entreprend un long voyage solitaire dans les montagnes de l’ouest des Etats-Unis : trois mois de marche, des déserts qui sont aussi intérieurs, puis un second mariage et deux enfants.
Le miracle de notre époque – comme le suggère le grand écran – est d’avoir appris que l’on peut chercher Dieu sans renoncer à son humanité. Dans un monde qui demande aux femmes d’être tout – fortes, douces, pures, résolues – le cinéma reconnaît le sacré dans les visages imparfaits de ceux qui cherchent un sens à leur vie et nous rappelle que l’on peut être simplement humain. Et que dans cette humanité, même blessée, se cache quelque chose d’éternel ; quelque chose qui, pour ceux qui croient, ressemble à Dieu.
* * *
Nous avons décidé de consacrer un numéro spécial de Femmes Eglise Monde à ce récit choral, en collaboration avec la Rivista del Cinematografo et avec l’aide de Don Davide Milani, qui en est le rédacteur en chef, et de Valerio Sammarco, de la rédaction.
Il Cinematografo est une revue mensuelle italienne d’information cinématographique fondé en 1928. Il fait partie des premières publications italiennes du secteur et est le plus ancien encore en activité. Il s’agit d’une revue spéciale, publiée par la Fondazione Ente dello Spettacolo, qui promeut la culture cinématographique en Italie pour le compte de la Conférence épiscopale italienne.
Depuis 2019, la Fondation organise également le Lecco Film Fest. Promu par Confindustria Lecco et Sondrio, il s’agit d’un festival innovateur dans le contexte italien en vertu des contenus et des langages utilisés, car il offre un regard entièrement féminin sur le monde du cinéma, de la culture et de la société.









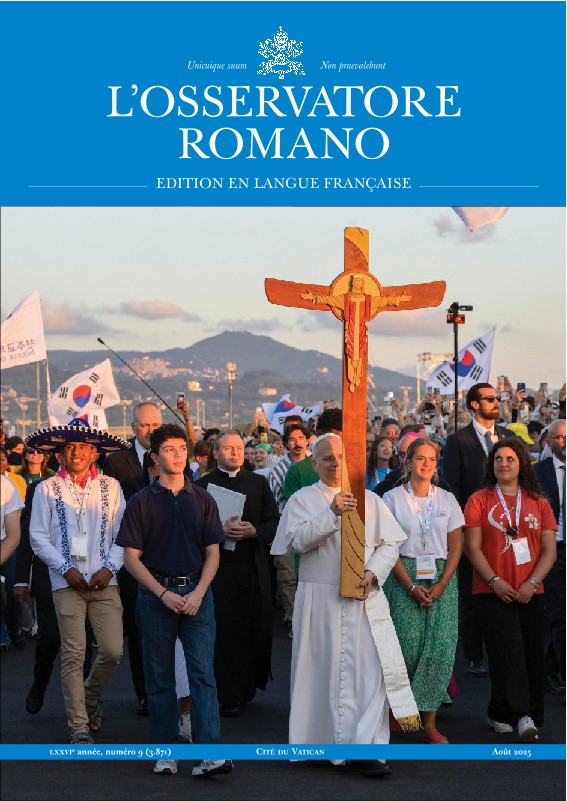



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
