
« La femme est celle qui rend le monde beau... Elle vous apporte la grâce qui rend les choses nouvelles ». Les mots du Pape François introduisent parfaitement la relation symbiotique, viscérale, qui existe entre le féminin et le septième art. Pont entre le visible et l'invisible, le « féminin » dans le cinéma d’auteur est la voie privilégiée de la transcendance, c'est l'espace dans lequel le divin se manifeste dans la fragilité de la condition humaine.
A travers les œuvres de cinéastes du monde entier, gnostiques et agnostiques, athées ou croyants, s’esquisse un fil rouge qui unit la femme à la recherche spirituelle, au combat intérieur et à la révélation de la grâce. Les femmes, dans les films des grands auteurs, ne sont pas de simples personnages, mais deviennent des figures qui incarnent le mystère, la souffrance rédemptrice et, parfois, l'altérité radicale de Dieu.
Le sacrifice et la rébellion
Le grand cinéaste russe Andreï Tarkovski a souvent associé le féminin à la mémoire, à la nostalgie et au sacrifice. Dans son film Le Sacrifice (1986), Marie, — l'épouse du protagoniste Alexandre —, se distingue par une attitude de résilience silencieuse, une acceptation du destin qui rappelle à bien des égards l'iconographie et la spiritualité mariales. Marie ne s’oppose pas au destin qui pèse sur la famille — la menace d'une guerre nucléaire et l'effondrement de l'ordre existentiel. Contrairement à d'autres personnages qui réagissent par l'angoisse, l'hystérie ou la fuite, Marie reste inébranlable, embrassant la douleur et l'incertitude avec un calme presque surnaturel.
Cette attitude rappelle la figure de Marie au pied de la croix, témoin silencieuse du sacrifice de son fils. C'est également le cas dans Stalker (1979) où le monologue final de la femme du Stalker est une profession de foi en l'amour, seule force capable de résister au chaos.
La réalisatrice italienne Liliana Cavani, dans François (1966) et Au-delà du bien et du mal (1977), explore le mysticisme à travers des femmes qui défient les conventions : Claire d'Assise, qui embrasse la pauvreté comme une liberté (on se souviendra également de Claire de Susanna Nicchiarelli), et Lou Salomé, qui cherche une vérité au-delà des dogmes. Pour Liliana Cavani, le féminin est une force prophétique, déstabilisante, comme les saintes rebelles de la tradition chrétienne.
Le lieu où se manifeste la grâce
Chez Krzysztof Kieślowski, la femme n'est jamais un simple personnage : elle est souvent le véhicule de questions métaphysiques, une figure liminale entre le visible et l'invisible, entre le destin et la liberté, entre le corps et la transcendance. Elle est, dans bien des cas, la face humaine du mystère.
Dans les films de la Trilogie des couleurs, le réalisateur polonais se concentre sur des personnages féminins qui traversent la douleur et la perte et qui, précisément dans ce traumatisme, entrent en contact avec une dimension plus profonde et donc spirituelle de l'existence.
Dans le film Trois couleurs Bleu (1993), Julie (interprétée par Juliette Binoche) perd son mari et sa fille dans un accident et tente d'effacer tous les liens, tous les souvenirs. Mais c'est précisément dans cette tentative de se dissoudre qu'elle entame un voyage intérieur. Julie découvre que la liberté absolue est vide, et que seul le lien avec les autres, la compassion, l'amour, lui permet de retrouver un sens.
Ici la spiritualité n'est pas religieuse, mais radicalement humaine, faite de deuil, de silence, de musique, de visions soudaines — et la femme est la figure à travers laquelle tout cela s'incarne.
Dans le film Trois couleurs Rouge (1994), Irene Jacob interprète Valentine, une jeune femme qui incarne la compassion, l'écoute et l'attention à l’autre. Sa rencontre avec le juge misanthrope les change tous les deux. Elle ne prêche ni ne juge, mais écoute. Et l'écoute devient un acte spirituel.
Dans le cinéma de Kieślowski, où le lieu physique de l'église est quasiment absent, les femmes deviennent le lieu même de la manifestation de cette grâce. Elles ne prêchent pas, elles agissent. Elles n'expliquent pas, mais ressentent. Elles ne dominent pas, mais s'exposent. Leur force réside dans la compassion, dans la capacité à accueillir le mystère sans besoin de réponses.
Roberto Rossellini, dans sa phase religieuse, confie à des femmes comme Ingrid Bergman (dans Europe’51, film de 1952) le rôle de Christophora : Irène, la bourgeoise qui découvre la sainteté chez les déshérités, devient une moderne Thérèse d'Avila, folle d’amour.
La spiritualité, cependant, peut ne pas être mystique au sens traditionnel du terme : elle s'incarne plutôt dans des gestes simples, dans le travail, dans l'attente, dans la patience. Dans les films d'Ermanno Olmi, les femmes sont souvent des présences silencieuses mais centrales, gardiennes d'une éthique du faire et du sentir, qui se manifeste dans le concret de la vie quotidienne. Dans L’arbre aux sabots (1978), par exemple, les femmes sont celles qui s'occupent de la famille, soutiennent leur mari, élèvent leurs enfants, mais aussi celles qui transmettent la foi, qui prient, qui transmettent des valeurs plus que des mots. Dans des films comme Le métier des armes (2001) ou Centochiodi (2007), bien que le protagoniste soit un homme, c’est dans la relation avec la femme qu’émerge la possibilité d'une autre voie, non violente, humaine, miséricordieuse.
Nous ne pouvons manquer de mentionner ici Voyage à Tokyo (1953), où le réalisateur japonais Yasujirō Ozu, bien que non chrétien, a créé un portrait de l'abnégation féminine : Noriko, la belle-fille dévouée, incarne une bonté sans récompense, semblable aux vierges prudentes de l'Evangile.
Le féminin pour l’autre
La femme devient aussi un guide spirituel pour l'homme — par sa simple présence, son regard, sa capacité à écouter, à vivre le temps sans le dominer. Dans le Journal d'un curé de campagne (1951, d'après le roman du même nom de Georges Bernanos) de Robert Bresson, réalisateur ascétique et rigoureux, la comtesse, avec sa douleur silencieuse, est l'interlocutrice d'un curé en crise, et c'est à travers elle qu'une révélation est faite : la grâce agit dans l'humilité. De même, dans A la merveille (2012) de Terrence Malick, le protagoniste masculin est partagé, rationnel, incapable d'aimer complètement — et la femme représente ce qu'il ne peut contenir : l'infini sous une forme fragile et concrète. Elle danse dans les champs, aime avec intensité et grâce, souffre : elle est matière et esprit, ensemble.
Cette grâce qui, par la suite, devient une référence directe dans The Tree of Life (2011). Dans la voix off, le personnage de la mère devient le porte-parole d'une voie spirituelle : « Il y a deux voies dans la vie : la voie de la nature et la voie de la grâce. C'est à vous de choisir laquelle vous voulez suivre ».
Chez tous ces auteurs, la figure féminine n'est jamais simplement un objet de narration, mais devient le véhicule d'une expérience du sacré, d'une tension vers l'absolu qui s'incarne dans les plis du réel. Qu'il s’agisse de la pureté mystique de Jeanne d’Arc, de l’humanité douloureuse d’Irène dans Europe’51 de Rossellini, de la révélation silencieuse de la mère chez Malick, le féminin devient le véhicule d'une transcendance qui, comme dans le cinéma lui-même, se manifeste à travers l'image, le visage, la lumière qui filtre à travers l'obscurité de la condition.
Emanuela Genovese









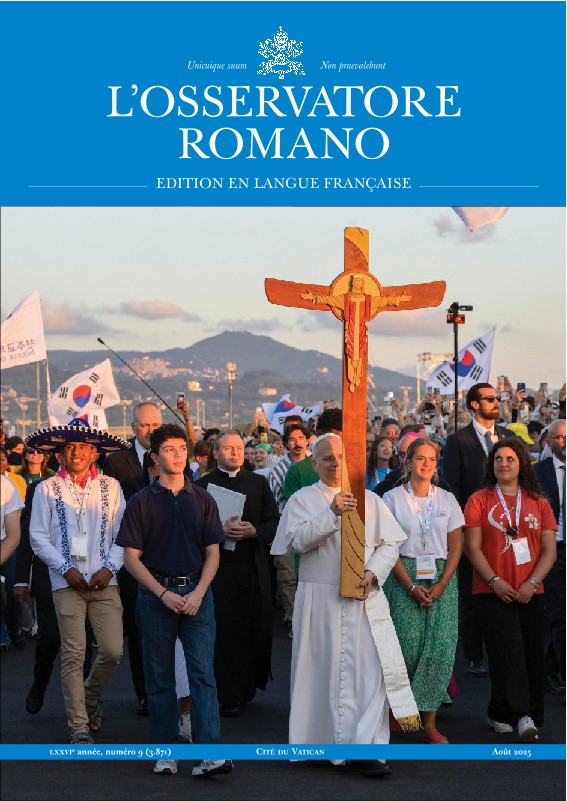



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
