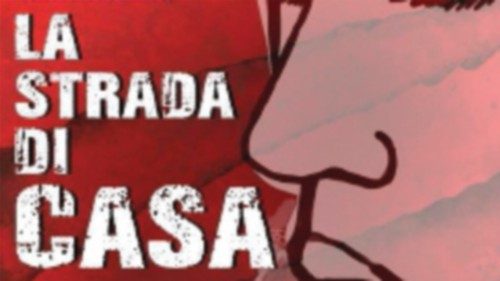
« Quelle est mon origine ? » est la question qui habite chaque existence. Pour des milliers de personnes nées dans des lieux anonymes, adoptées ou placées en famille d’accueil, c’est bien plus qu’une simple réflexion intérieure. C’est un besoin physiologique, une recherche entravée par des lacunes législatives et des lenteurs institutionnelles.
C’est à ces vies suspendues entre identités niées et désir de vérité, que Melania Petriello donne la parole dans La strada di casa (Round Robin), un livre écrit avec rigueur civique et proximité humaine. Melania Petriello allume son enregistreur et, sans pathos, s’assoit face à Anna, confiée à l’orphelinat de Naples par une « femme qui ne permet pas qu’on la nomme ».
Anna cherche ses origines alors qu’une maladie l’oblige à une greffe qui doit provenir d’un membre de sa famille. Elle fouille parmi les papiers et les documents jaunis, comme si la vérité était une enquête à résoudre. Elle trouve la réponse sur une pierre tombale, au Canada. « As-tu pardonné ? », demande Melania Petriello à voix basse. « J’aurais voulu lui dire : je te comprends », répond Anna.
Voici le fil rouge du livre : ce sont toutes des filles qui ne ressentent aucune rancune.
C’est ici qu’a lieu la rencontre entre la douleur d’avoir été abandonnées et la compréhension de celles qui ont choisi ou ont été contraintes d’abandonner. Comme Rossella, victime de violences, qui a accouché dans l’anonymat alors qu’elle était mineure, sur le conseil d’« un ami de la famille ». Quand elle comprend la tromperie, il est déjà trop tard. Rossella ne saura jamais ce qu’est devenu son enfant. À moins que la loi ne change. Le livre est à la fois un témoignage et une dénonciation politique. L’auteure reconstitue le cadre législatif et analyse les paradoxes.
Notamment l’un d’eux : comment deux droits divergents peuvent-ils coexister ? D’un côté, la naissance anonyme, fruit de combats féministes précieux ; de l’autre, le besoin de connaître ses racines. Melania Petriello soutient que, comme journaliste, elle préfère la précision des questions au baume des réponses.
Pourtant, une réponse émerge : si une fille et une mère, au fil du temps, décident de se retrouver, pourquoi une loi devrait-elle s’y opposer ? À propos de chemins, peut-être existe-t-il une troisième voie : le consentement. Aucun choix ne devrait être irréversible.
Carmen Vogani









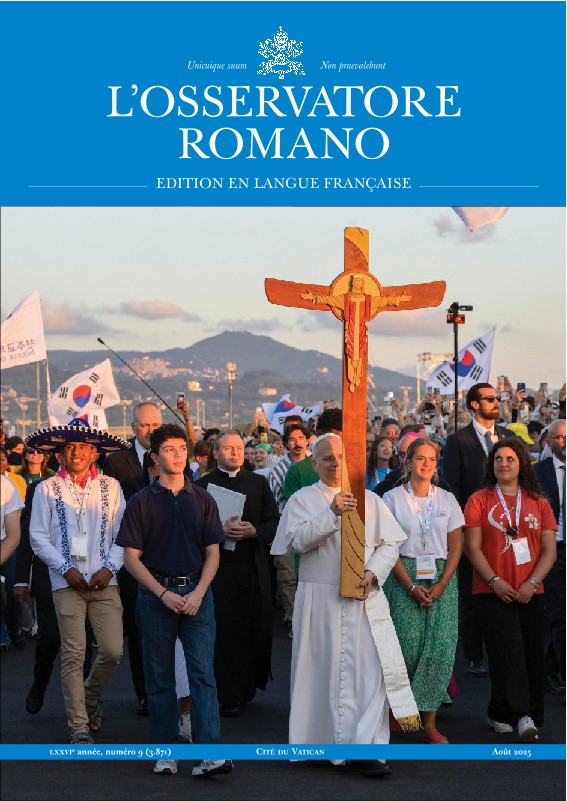



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
