
Rivka et Malka, Nisha, Petrunya : ce sont des femmes de notre temps. Elles appartiennent à des cultures et à des religions différentes et ont en commun un puissant sentiment de liberté conditionné par l’appartenance à une tradition religieuse spécifique vécue, ou subie, à la limite d’une observance rigide et tranchée. Elles ne veulent pas diffamer la religion à laquelle elles sont attachées, mais exprimer leur désir convaincu de liberté soutenu par la nécessité et l’urgence du respect de leur condition de femme. Raconter leur histoire nous aidera à saisir les éléments qui se prêtent à une réflexion qui, dans le respect des traditions des différentes « religions du livre », ramène l’humanité à sa qualité la plus originelle : la ressemblance avec Dieu. Une compréhension qui ne peut ignorer la religiosité, mais pas non plus les instances de notre temps.
Rivka et Malka sont sœurs, protagonistes de Kadosh (Amos Gitai, 1999). L’aînée est mariée à un rabbin qui pratique le judaïsme orthodoxe. Tous deux voudraient un enfant qui n’arrive pas. Rivka est accusée à tort de stérilité. En plus du préjudice, elle doit subir les moqueries de la répudiation. Malka est promise à un homme qui lui est destiné par la communauté et qu’elle n’aime pas parce qu’il est violent. Elle est attirée en revanche par un jeune musicien qui partage ses sentiments. Rivka et Malka subissent à leur manière la violence de la communauté qui, au nom de l’orthodoxie, les oblige à se soumettre à des règles fondamentalistes, souvent « irrespectueuses » des marques de liberté et de dignité conférées par le Créateur. Leur destin se déroule de façon différente, entre résignation tragique et abandon rebelle.
L’intégrisme et la soumission (Islam) sont également au centre de La Mauvaise Réputation (Iram Haq, 2017). Les deux « valeurs » religieuses apparaissent encore plus éclatantes et éloignées de la Norvège occidentale et indifférente. C’est ici que Nisha est née et vit avec sa famille pakistanaise, avec des arrangements qui lui permettent de rassurer ses parents et de ne pas être isolée de ses amis. Mais les règles lui imposent d’épouser un homme qu’elle ne connaît pas. La tentative de la ramener à la soumission se révèle douloureuse et inutile. Elle échappe à un épilogue tragique, à la différence d’autres filles pakistanaises d’Occident (Saman Abbas, ou Hina Saleem). Nisha a la « chance » d’avoir un père tourmenté mais compréhensif, qui a su trouver l’équilibre entre la réalité du milieu où il vit et les règles de la tradition (charia), à mille lieux de distance, sur le plan géographique, culturel et temporel.
Le milieu culturel et religieux de l’histoire de Petrunya, la protagoniste de Dieu est femme, elle s’appelle Petrunya (Teona Mitevska, 2019), est celui chrétien orthodoxe de Macédoine. Diplômée de 32 ans et sans emploi, elle est entreprenante et déterminée à s’épanouir dans une société entièrement contrôlée par les hommes. Même les règles d’une fête traditionnelle de son pays (entre religiosité et superstition) l’excluent d’une épreuve réservée aux seuls hommes. Le geste impulsif qu’elle accomplit – sauter pour attraper une petite croix jetée dans les eaux glacées de la rivière – est considéré comme scandaleux et irrévérencieux par la mentalité étroite de la communauté et la place dans la situation absurde d’être arrêtée pour la gravité de l’« infraction ». Outre la soumission, les règles entraînent la discrimination.
Le christianisme « catholique » a lui aussi sa protagoniste, Hypatie, victime d’un intégrisme qui, dans l’Antiquité, a produit des actes odieux à rappeler pour ne pas répéter ces erreurs tragiques. Hypatie, dont l’histoire est racontée dans Agora (Alejandro Amenábar, 2009), est la victime-martyre d’une religiosité fondamentaliste qui a perdu le sens de la charité et de la miséricorde « chrétienne ».
Les films passés en revue nous interpellent sur la question de la condition des femmes dans le rapport entre religion et contemporanéité. Il faut convenir que les « religions du livre », au nom de la foi, ont souvent réduit les aspirations, les désirs et la liberté des femmes jusqu’à les soumettre à des traditions où le machisme a pris le dessus de façon exagérée. L’ensemble des préceptes et des croyances constitue la religio à laquelle on est « lié ». Mais lorsque les règles perdent leur esprit et deviennent des fardeaux insupportables qui limitent et alourdissent la vie, la religion ne peut qu’engendrer le malheur, la frustration et l’inhumanité. « A vous aussi… malheur, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous-mêmes ne touchez pas à ces fardeaux d’un seul de vos doigts », est-il écrit dans l’évangile de Luc (11,46). Souvent, ces fardeaux se traduisent par des subordinations déraisonnables et excessives.
Renato Butera









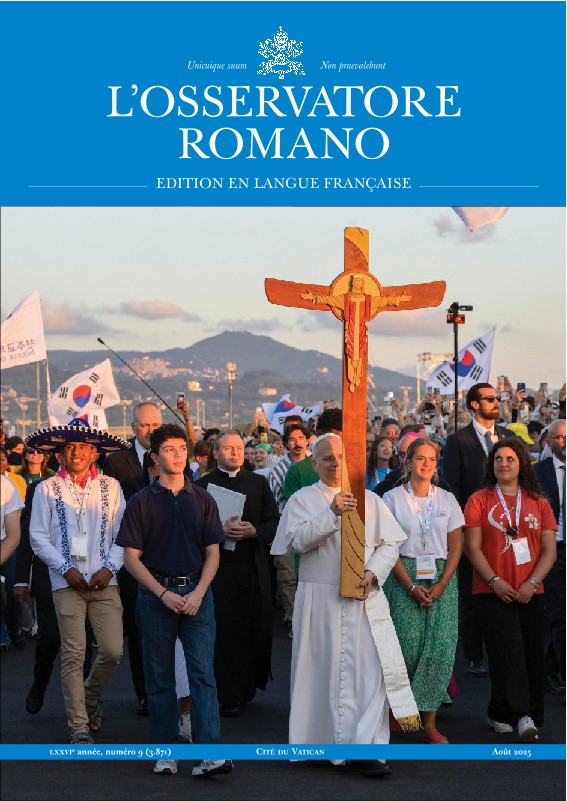



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
