
Quand je pense à l’espérance — ce qui m’arrive souvent — la première chose qui me vient à l’esprit est l’idée de « natalité » chez Hannah Arendt : le simple fait que de nouveaux êtres humains, des petites filles et des petits garçons, continuent de naître oriente notre condition vers la surprise et l’imprévu. C’est une irruption constante de la nouveauté, qui fait que le monde, tel qu’il a toujours été, n’a pas à rester ainsi. Souvent, nous sommes si effrayés ou si blessés que nous nous berçons dans le cynisme, l’abattement, l’épuisement — tout, pourvu que nous n’ayons pas à courir le risque d’être surpris, de voir l’imprévu frapper à la porte. Car espérer implique un grand poids et beaucoup d’incertitude. Ce n’est pas cette pensée vague, ni cette prière déformée (et pourtant si courante) : que le mal ne m’arrive pas à moi. C’est tout le contraire : si tu espères, tu avances. Certains d’entre nous ont peut-être vécu ce que racontent, avec des dessins et des mots, Olga Tokarczuk et Joanna Concejo dans un album illustré publié chez Topipittori. C’est l’histoire d’un homme « qui travaillait très dur et très vite, et qui avait depuis longtemps laissé son âme derrière lui ». Tokarczuk nous dit que sans son âme, il ne vivait même pas si mal : il courait de-ci de-là, travaillait, mangeait, participait même à des tournois de tennis — mais parfois, le monde lui paraissait terriblement plat. Cet homme qui avait oublié son nom se rendit compte après quelques recherches qu’il s’appelait Jan et, quand il réussit à se laisser rattraper par son âme, il releva la tête et réalisa que les plantes poussaient — et que c’était surprenant de les voir pousser (c’est ce que raconte Concejo, en images). Cet homme, Jan, avait retrouvé la capacité de comprendre ce qu’est l’espérance.
Il arrive, quand on a à boire et à manger et que tout aille trop vite, qu’on laisse son âme derrière soi et qu’on ne voie plus aucune raison d’espérer — qu’on ne sache même plus ce que cela signifie. Mais quand il y a la guerre, quand la nourriture ou un toit manquent, l’espérance devient un moteur très concret. Chimamanda Ngozi Adichie, dans son roman L’Autre moitié du soleil (Metà di un sole giallo, Einaudi), raconte la guerre qui suivit la proclamation de l’indépendance de la République du Biafra en 1967, se détachant du Nigeria. Elle montre de manière poignante comment la recherche d’eau et de nourriture est portée par l’espérance de nourrir et d’abreuver les êtres chers. L’espérance n’est pas toujours récompensée par le succès, mais une chose est certaine : sans elle, les personnes en détresse laisseraient mourir leurs proches et elles-mêmes. Il existe un lien profondément intime entre l’amour concret et l’espérance : l’amour conduit à espérer et l’espérance pousse à agir. Comme l’utopie, l’espérance indique un horizon — mais un horizon plus modeste, plus incarné, plus charnel. Quand on est encore dans la guerre ou à peine sorti de ses ruines, on essaie de demander à l’espérance de nous offrir un horizon collectif, de nous montrer une issue. Mais il y a un obstacle, peut-être le plus grand : la haine, qui n’a cessé de croître et qui pousse les haïs à haïr à leur tour. Marilynne Robinson, dans Lire la Genèse (Leggere Genesi, Marietti1820), s’arrête longuement sur Caïn, qui a tué son frère, et sur ce qui s’est passé ensuite. Elle évoque le fait que Dieu ne l’a pas puni, mais l’a marqué pour empêcher qu’il soit lui-même tué. Il est difficile pour celui qui entend cette histoire pour la première fois, de ne pas penser à la justice refusée à Abel, ou de ne pas ressentir que Caïn devrait payer sa faute. À défaut, nous essayons de nous convaincre que le « signe de Caïn » est une malédiction, une marque de culpabilité. Mais Caïn ne paie pas sa faute comme on s’y attendrait — au contraire, il la porte avec lui — et ses descendants ne sont pas punis pour cette faute. La vengeance contre Caïn est suspendue par ce signe. Une nouvelle forme de justice remplace alors celle à laquelle nous sommes habitués : déconcertante et tournée vers l’avenir, elle suspend la vengeance. C’est une justice empreinte d’espérance.
Carola Susani









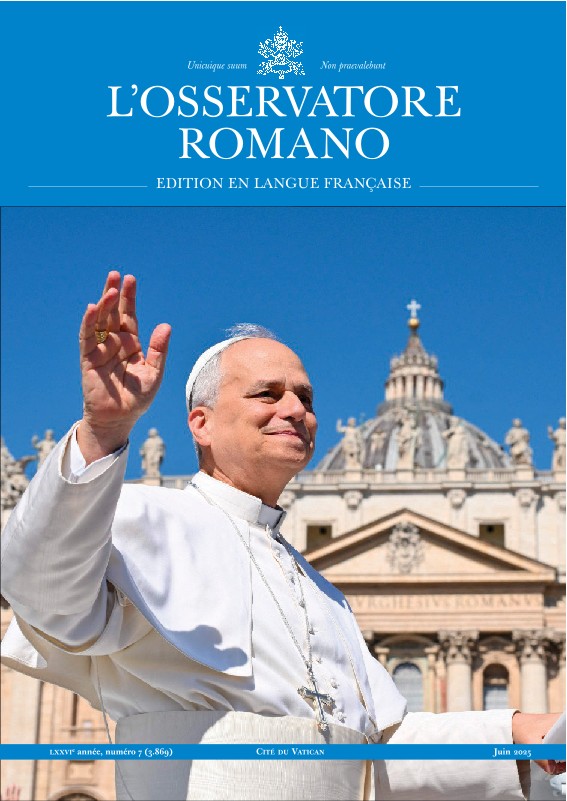



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
