
Delphine Allaire
Monseigneur Michel Calvet a eu la charge du diocèse de Nouméa de 1981 jusqu’en avril 2025. Il nous raconte ses 43 années d’épiscopat, ponctuées de grâces et de difficultés dans un territoire en développement, aux traditions mélanésiennes ancrées.
Quelle est la spécificité historique de la vie d’Eglise dans ce territoire missionnaire?
Il y a des continuités. L’histoire de l’évangélisation a commencé en 1843, une Eglise avec des missionnaires qui étaient des Pères maristes, tous venant du diocèse de Clermont. Ils ont fait avec les moyens qui étaient les leurs, en se mettant au service de la population, en apprenant la langue et surtout en travaillant avec ceux qui sont devenus les catéchistes. Les catéchistes ont également servi pour toute l’évangélisation, et encore aujourd’hui. Dans de nombreuses paroisses et communautés catholiques où les prêtres sont présents tous les mois ou trimestres, les catéchistes assurent la continuité de la vie chrétienne. Ainsi, quand il y a un bon catéchiste dans «une tribu», comme l’on dit ici, la vie chrétienne se développe de manière considérable. C’est d’ailleurs une joie d’apprendre la canonisation du bienheureux Peter To Rot de Papouasie-Nouvelle-Guinée, considéré comme le patron des catéchistes d’Océanie.
Quelles évolutions majeures avez-vous constatées dans la vie de foi à Nouméa de 1981 à 2025?
La sécularisation est forte et la présence d’une société moderne met une pression considérable, même si la vie traditionnelle demeure. Malgré cela, la participation à la vie chrétienne par la liturgie, le pèlerinage ou les activités continue à se développer. Nous ne pouvons pas mesurer la profondeur de l’évangélisation, mais il est admirable que, dès la première génération, au xixe siècle, des chrétiens aient été exemplaires. C’est un encouragement.
En ces plus de 40 ans de ministère épiscopal, quels défis majeurs se sont présentés à vous?
Essentiellement des défis symptomatiques d’un territoire en développement, qui parvient difficilement à proposer un développement pour l’ensemble de sa population, et très particulièrement la jeunesse. Dans les années 1984-1988, nous avons eu des moments difficiles, mais nous avons peut-être aussi un peu oublié les jeunes. Les jeunes déstructurés perdent leurs repères, c’est redoutable car ils peuvent être utilisés par certains pour arriver à leurs fins, c’est-à-dire pour essayer de prendre le pouvoir.
En résultent les émeutes de 2024, notamment contre les églises. Comment les fidèles s’en sont-ils remis et les blessures ont-elles commencé a être pansées?
Les fidèles se sont aperçus que les églises étaient les leurs. Ils les ont même gardées, parfois jour et nuit, encore maintenant. Ces jeunes ont du mal à comprendre le fonctionnement de la société moderne, c’est à dire une société dans laquelle tout n’est pas possible immédiatement, où il y a des mécanismes économiques qu’il faut savoir analyser. Nous avons beaucoup à faire. Les politiques s’en sont aperçus et ont souhaité que nous formions nos jeunes.
L’Eglise locale néocalédonienne est de plus en plus inculturée. Jusqu’où l’est-elle devenue aujourd’hui?
C’est un travail de longue haleine qui a été fait par toutes les Eglises, avec les traductions, dès les premiers temps de la mission de l’Eglise, des catéchismes dans les différentes langues. En Nouvelle-Calédonie, il y a 25 langues différentes, des langues mélanésiennes, et la langue du Pacifique la plus parlée en Nouvelle-Calédonie est la wallisienne. Nous avons aussi des communautés vietnamiennes. Outre la question des langues, c’est la question des cultures qui se pose plus profondément.
Un des moments les plus riches de réflexion à ce sujet a été la préparation, le déroulement, puis l’utilisation du document Ecclesia in Oceania après le Synode spécial pour l’Océanie, convoqué par Jean-Paul ii. La totalité des évêques et des responsables de juridiction de l’Océanie étaient présents avec le Pape et ses collaborateurs à Rome.
Pour moi, qui ai suivi cette opération de bout en bout dans la préparation comme secrétaire spécial de ce synode et comme membre de la commission synodale, cela a été un moment de l’évangélisation et de l’inculturation véritable qui était passionnant, c’est-à-dire dans la profondeur de l’Evangile et en prenant les cultures locales au sérieux.
Un quart de siècle après le Synode pour l’Océanie et l’Exhortation apostolique, quels en seraient les premiers fruits spirituels? Car la synodalité en Océanie, mosaïque d’îles éparses, semble vitale et innée.
Il y a tous les aspects particuliers des cultures océaniennes, où la question du dialogue est essentielle, avec des manières de vivre différentes. Une certaine unité culturelle et linguistique prévaut dans les îles polynésiennes, mais la situation est très différente dans l’aire mélanésienne où la diversité linguistique est prégnante: 24 langues en Nouvelle-Calédonie, près d’une centaine dans le diocèse voisin de Port-Vila, Vanuatu, autrefois Nouvelles-Hébrides, et puis un summum en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui -compte 800 langues différentes.
Comment la synodalité se traduirait-elle aussi dans le dialogue œcuménique régional?
Les protestants se sont installés en Nouvelle-Calédonie quelques années avant les catholiques. Ils sont plus nombreux que les catholiques dans les îles -Loyautés. Ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle l’œcuménisme n’était pas très bien vu. La compétition était vive. Depuis le Concile Vatican ii, il y a une collaboration entre les Eglises.
Quand il y a un mariage dans des communautés dans lesquelles il y a des branches catholiques et des branches protestantes, s’il est organisé chez les protestants, vous trouverez les catholiques à la cuisine et réciproquement. Les relations sont bonnes avec les responsables des communautés, mais l’essentiel se produit chez les fidèles.
Jean-Paul ii s’est beaucoup rendu en Océanie, Benoît xvi a eu les jmj à Sydney, François le mémorable voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quels rapports entretiennent les Néo-Calédoniens, les Océaniens, à la figure géographiquement lointaine du Pape?
L’attachement au Pape a toujours été caractéristique des diocèses des petites îles d’Océanie. De manière naturelle, traditionnelle et constante. Cela tient au fait que l’évangélisation a été menée par des congrégations religieuses, singulièrement, pour notre région d’Océanie, par les pères maristes. Ils étaient ultramontains, c’est à dire des gens pour qui leurs évêques, dans tous ces premiers temps de l’Eglise, étaient des vicaires apostoliques. Des vicaires qui représentaient le Pape dans ces diocèses. C’est seulement après le Concile Vatican ii que tous ces vicariats apostoliques ont été transformés en diocèses de plein droit.









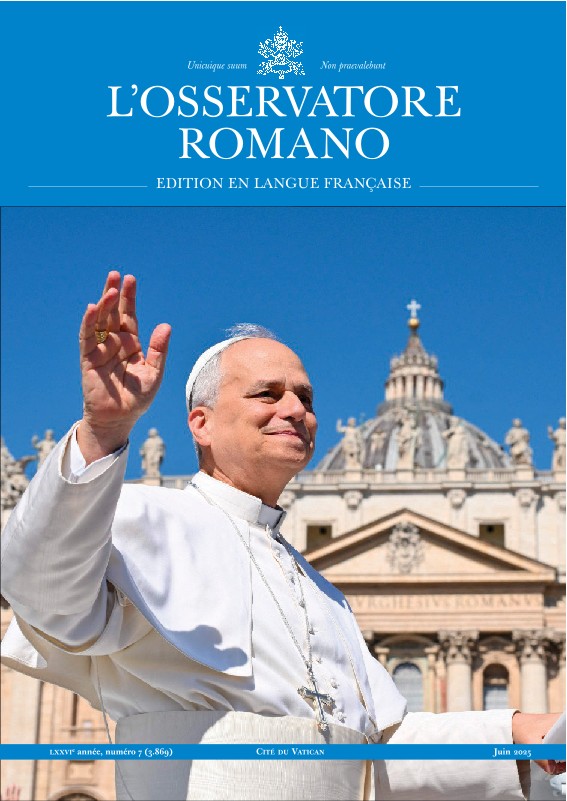



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
