
Federico Piana
L’archidiocèse de Papeete est composé d’un si vaste territoire que le père Sandro Lafranconi fait une comparaison efficace pour faire comprendre cette grandeur à ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans cette zone reculée du monde en Océanie, plus exactement en Polynésie française: «Il occupe un espace similaire à celui qui sépare la Tunisie de la Scandinavie, pour donner un exemple. C’est l’archidiocèse le plus vaste de toute l’Eglise catholique». Le prêtre, d’origine italienne et membre de la Société des missions africaines, se trouve depuis plusieurs années dans les îles Sous-le-Vent, un groupe d’îles de l’un des cinq archipels qui sont sous la juridiction de l’archidiocèse: les îles de la Société (dont les îles Sous-le-Vent font partie, avec les îles du Vent), les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Marquises et les îles Gambier.
Prendre soin des quelque cent mille fidèles dispersés dans de petites agglomérations urbaines séparées les unes des autres par des milliers de kilomètres a comme une saveur d’aventure pour lui et les vingt-trois prêtres archidiocésains, auxquels s’ajoutent cinquante diacres. Un nombre assurément inférieur aux réels besoins, mais qui permet tout de même à l’Eglise locale d’être plus vivante que jamais. «L’archevêque Jean-Pierre Cottanceau m’a demandé d’assurer ma présence dans les paroisses de la Sainte-Famille à Huahine, Saint-André à Raiatea, Saint-Pierre-Célestin et Saint-Clément à Taha’a et en outre de prendre soin de la famille paroissiale de Saint-Célestin à Bora Bora» raconte le père Lafranconi à «L’Osservatore Romano». Sur chacune des îles qui composent les îles Sous-le-Vent, une résidence a été mise à la disposition du missionnaire, où il peut séjourner pendant quelques jours avant de repartir pour sa prochaine étape. Les voyages se font toujours en avion et les vols durent tout au plus 45 minutes mais couvrent des distances énormes; il suffit de penser que les communautés paroissiales qui lui ont été confiées sont réparties sur une superficie égale à la moitié de la Lombardie (ou Lorraine pour la France, ndlr). «Lorsque ni moi, ni le diacre ne réussissons à aller dans les paroisses, alors les catéchistes qui sont présents dans la communauté animent les liturgies de la Parole suivies, les jours fériés, de la distribution de l’Eucharistie», déclare-t-il.
A l’occasion de l’Année Sainte, Mgr Cottanceau a indiqué cinq paroisses jubilaires sur l’île de Tahiti et sept autres sur tout le reste du territoire archidiocésain; parmi ces églises, il y également celle de Saint-André, à Raiatea, confiée au missionnaire italien. «Nous avons commencé — explique le père Lafranconi — à penser au Jubilé la nuit de Noël dernier. Dans les îles Sous-le-Vent, en effet, une grande ancre avait été placée au centre de nos crèches pour qu’il soit clair que, au cours de cette période de Noël, ce Dieu qui naît est l’ancre de l’espérance qui nous est offerte gratuitement».
Les habitants de l’une des îles Sous-le-Vent ont également préparé cinq grands draps finement décorés où l’on peut lire une citation, en français et en tahitien, de l’Epître aux Romains: «Et l’espérance ne déçoit point, parce que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné» (5, 5). Ces grands draps, explique le père Sandro, «ont été offert à chacune des îles de façon à ce qu’un signe tangible du Jubilé soit toujours présent. Mais c’est juste l’aspect formel. Il y a ensuite tout un travail plus important qui a été entrepris pour faire comprendre le véritable sens de l’indulgence: un père qui ouvre son cœur quand il voit que son fils fait des efforts pour se racheter. Et il ne se préoccupe pas de savoir si son fils est bon ou mauvais ou s’il a été grossier avec lui. Il l’aime simplement en comprenant ses faiblesses».
Insister sur cet aspect jubilaire signifie aussi se rappeler que, si Dieu n’est pas avare en indulgences, la réponse de l’homme doit être de mettre en pratique les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle: «Et c’est pour cela que, après l’ouverture du Jubilé, nous avons pensé à faire une Via Crucis à laquelle, à chaque station, nous avons associé une des œuvres de miséricorde. De plus, d’ici peu, nous essaierons d’organiser des pèlerinages afin que ceux qui ne peuvent pas se rendre dans la cathédrale de Tahiti, siège archiépiscopal, puissent au moins le faire dans notre église Saint-André».
L’exercice de l’espérance, thème central du Jubilé, se concrétise dans le grand archidiocèse de Papeete avant tout par un aspect particulier: «Ici, il y beaucoup de personnes non catholiques: des protestants aux sectes. Dans une telle situation, parler d’espérance signifie croire que, au-delà des divisions, tous peuvent devenir un. Et ce Jubilé est une possibilité d’y parvenir». Mais pas seulement. Cette vertu théologale, l’Eglise locale doit la mettre en pratique aussi en affrontant certains des problèmes sociaux les plus importants des dernières années: la consommation de drogue et d’alcool, surtout parmi les jeunes, et la destruction des familles provoquée par la violence et l’infidélité conjugale. «Pour sortir de ces situations humainement ingérables — conclut le missionnaire — il reste uniquement l’ancre de l’espérance qui est Dieu, comme le Jubilé nous l’enseigne et nous le rappelle».









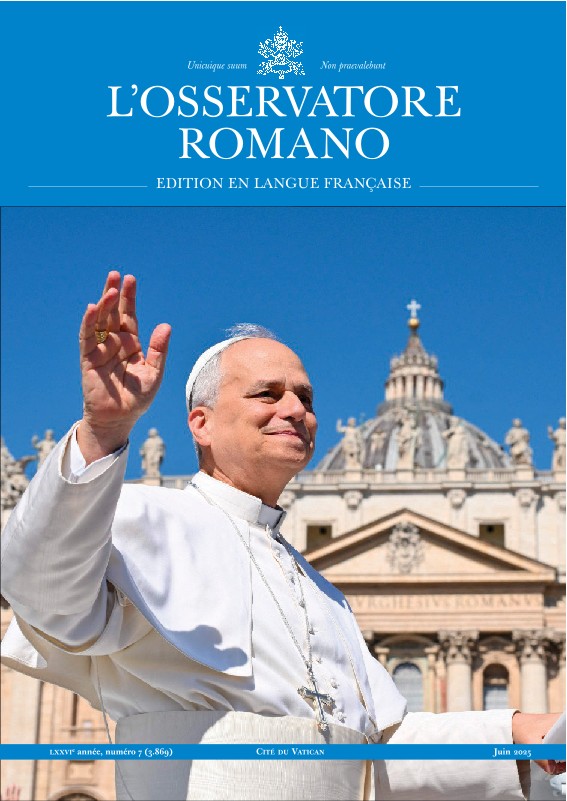



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
