
Lorsqu'une femme parle trop fort, ose dire des vérités dérangeantes, remet en cause l'ordre établi, elle est souvent qualifiée de « folle ». Les folles ont été les premières femmes à briser l'omertà mafieuse. « Locas », les mères argentines de la Plaza de Mayo qui ont exigé que leurs fils desaparecidos (personnes portées disparues) leur soient rendus, au moins leurs corps. C’est aux limites de la raison qu’était vu le comportement des mystiques qui trouvaient dans les extases et dans les visions un canal pour exprimer une spiritualité profonde et souvent révolutionnaire. Possédées, sorcières, étaient considérées comme des hérétiques. Tout comme les jurodivaja, les folles du Christ de la tradition russe, qui vivaient en marge de la société semblaient avoir perdu la tête.
Bien sûr, le prix à payer a souvent été très élevé. De nombreuses femmes « folles » ont été persécutées, emprisonnées, torturées, brûlées sur le bûcher. D'autres ont été enfermées dans des instituts psychiatriques, soumises à des « traitements » brutaux, privées de leur dignité et de leur voix. La société a tenté par tous les moyens de se protéger de ces consciences inquiètes.
Il y a le fait que les femmes, historiquement privées du droit de s'exprimer en public, ont appris à utiliser cette étiquette comme une protection, transformant la stigmatisation en pouvoir.
Les suffragettes du début du XXème siècle ont consciemment abandonné la retenue exigée des dames de leur temps et se rendirent protagonistes d'actions considérées folles : s'enchaîner aux grilles, jeûner jusqu'à l'épuisement, affronter la violence et les moqueries. Le féminisme lui-même, à ses débuts, était considéré comme une manifestation de folie collective.
Pourtant, grâce à ces femmes qui ont osé embrasser la folie comme attitude existentielle, qui ont brisé le silence et l'immobilisme, nous pouvons imaginer des mondes différents aujourd'hui. Leur fureur a été génératrice, avant-garde du changement, anticipation des révolutions sociales et culturelles qui ont transformé notre façon de vivre. Hildegarde von Bingen, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, aujourd'hui docteurs de l’Eglise, ont été prophétiques.
La bibliste Marinella Perroni écrit que cette dynamique émerge aux racines mêmes du christianisme. Les femmes furent les premiers témoins de la Résurrection du Christ. Marie-Madeleine et les autres qui se rendirent au tombeau, le trouvant vide, apportèrent la nouvelle extraordinaire aux apôtres qui, tout d'abord, « leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas » (Luc 24, 11).









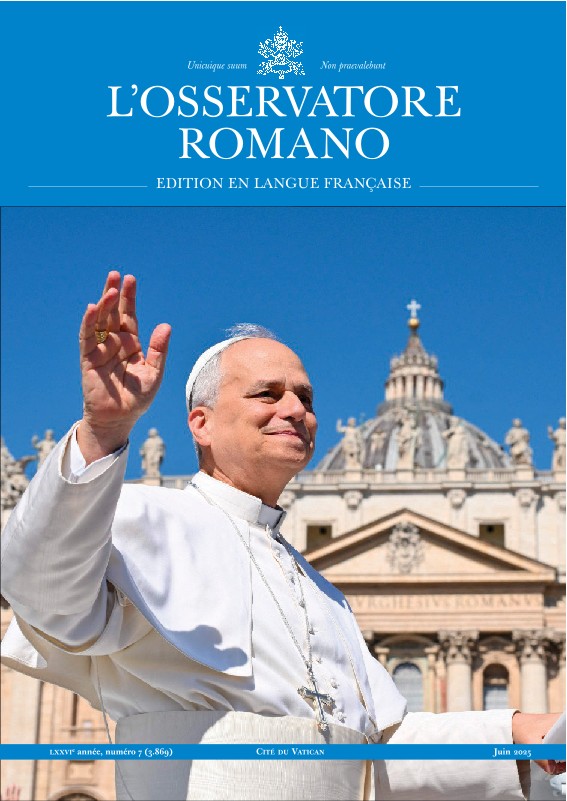



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
