
Discours au Tribunal de la Rote romaine
Salle Clémentine, vendredi 31 janvier 2025
Dans les causes matrimoniales viser au bien des fidèles
Chers prélats auditeurs,
L’inauguration de l’Année judiciaire du Tribunal de la Rote romaine me donne l’occasion de renouveler l’expression de mon appréciation et de ma gratitude pour votre travail. Je salue cordialement Monsieur le doyen, ainsi que vous tous qui prêtez service dans ce Tribunal.
Cette année marque le dixième anniversaire des deux Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus et Mitis et Misericors Iesus, par lesquels j’ai réformé la procédure de déclaration de nullité du mariage. Il me semble opportun de saisir cette traditionnelle occasion de rencontre avec vous pour rappeler l’esprit qui a empreint cette réforme, que vous appliquez avec compétence et diligence au service de tous les fidèles.
La nécessité de modifier les normes relatives au processus de nullité avait été exprimée par les Pères synodaux réunis lors de l’Assemblée extraordinaire de 2014, qui demandaient que les procédures soient plus accessibles et plus souples (cf. Relatio Synodi 2014, n. 48). Les pères synodaux exprimaient de cette façon l’urgence de réaliser une conversion pastorale des structures, déjà souhaitée dans l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium (cf. n. 27).
Il était très opportun que cette conversion touche également l’administration de la justice afin qu’elle réponde mieux aux attentes de ceux qui s’adressent à l’Eglise pour clarifier leur situation matrimoniale (cf. Discours au Tribunal de la Rote romaine, 23 janvier 2015).
J’ai voulu placer l’évêque diocésain au centre de la réforme. En effet, c’est à lui que revient la responsabilité d’administrer la justice dans le diocèse, tant pour garantir la proximité des tribunaux et veiller sur eux, que comme juge qui doit décider personaliter les cas où la nullité est manifeste, c’est-à-dire à travers le processus brevior comme expression de sa sollicitude pour le salus animarum.
C’est pourquoi j’ai sollicité l’intégration de l’activité des tribunaux dans la pastorale diocésaine, en demandant aux évêques de s’assurer que les fidèles connaissent l’existence de cette procédure comme possible remède à la situation de besoin dans laquelle ils se trouvent. Il est parfois attristant d’apprendre que les fidèles ignorent cette possibilité. Par ailleurs, il est important «que soit assurée la gratuité des procédures, pour que l’Eglise […] manifeste l’amour gratuit du Christ, par lequel tous nous avons été sauvés (cf. Préambule, vi).
En particulier, la sollicitude de l’évêque est de garantir par la loi la constitution dans son diocèse du tribunal, composé de personnes — clercs et laïcs — bien formées, aptes à cette fonction, et de veiller à ce qu’elles accomplissent leur travail avec justice et diligence. L’investissement dans la formation de ces professionnels — formation scientifique, humaine et spirituelle — est toujours au bénéfice des fidèles, qui ont le droit de voir leurs requêtes examinées avec attention, même lorsqu’elles reçoivent une réponse négative.
La préoccupation pour le salut des âmes a guidé la réforme et doit guider sa mise en œuvre (cf. Mitis Iudex, préambule). Nous sommes interpellés par la douleur et l’espérance de tant de fidèles qui cherchent à clarifier la vérité de leur situation personnelle et, par conséquent, la possibilité de participer pleinement à la vie sacramentelle. Pour des personnes qui ont «vécu une expérience matrimoniale malheureuse, la vérification de la validité ou non de leur mariage représente une possibilité importante; et ces personnes doivent être aidées à parcourir cette route le plus aisément possible» (Discours aux participants au Cours promu par la Rote romaine, 12 mars 2016).
Les normes qui établissent les procédures doivent garantir certains droits et principes fondamentaux, en particulier le droit à la défense et la présomption de validité du mariage. Le but de la procédure n’est pas «de compliquer inutilement la vie aux fidèles, encore moins d’en exacerber l’esprit de litige, mais seulement de rendre un service à la vérité» (Benoît xvi, Discours à la Rote romaine, 28 janvier 2006).
Il me vient à l’esprit ce que disait saint Paul vi après avoir porté à terme la réforme réalisée avec le Motu Proprio Causas matrimoniales. Il observait «comment il tend, par les simplifications introduites dans l’examen des causes matrimoniales, à en rendre l’exercice plus aisé, et du même fait plus pastoral, sans porter préjudice aux critères de vérité et de justice auxquels un procès doit honnêtement se tenir, dans la confiance que la responsabilité et la sagesse des pasteurs y seront plus directement et religieusement engagées» (Discours à la Rote romaine, 30 janvier 1975).
La récente réforme a elle aussi voulu favoriser «non pas la nullité des mariages, mais la rapidité des procès et une juste simplicité, de sorte que, à cause du retard des décisions judiciaires, le cœur des fidèles qui attendent une clarification de leur statut ne soit pas longtemps opprimé par les ténèbres du doute» (Mitis Iudex, Préambule).
En effet, pour éviter que, à cause de procédures trop souvent complexes, se vérifie l’adage «summum ius summa iniuria» (Cicéron, De Officiis i, 10, 33), j’ai supprimé la nécessité de la double sentence conforme et j’ai encouragé une décision plus rapide dans les causes où la nullité est manifeste, en recherchant le bien des fidèles et en voulant apporter la paix à leur conscience. Il est évident — mais je tiens à le rappeler ici — que la réforme appelle fortement votre prudence dans l’application des normes. Et cela «requiert deux grandes vertus: la prudence et la justice, qui doivent être informées par la charité. Il existe un lien intime entre prudence et justice, car l'exercice de la prudentia iuris vise à la connaissance de ce qui est juste dans le cas concret» (Discours à la Rote romaine, 25 janvier 2024).
Chaque protagoniste du procès aborde la réalité conjugale et familiale avec révérence, parce que la famille est un reflet vivant de la communion d’amour qu’est Dieu Trinité (cf. Amoris laetitia, n. 11). En outre, les époux unis par le mariage ont reçu le don de l’indissolubilité, qui n’est pas un but à atteindre par leurs propres efforts, ni même une limite à leur liberté, mais une promesse de Dieu, dont la fidélité rend possible la fidélité des êtres humains. Votre travail de discernement sur l’existence ou non d’un mariage valide est un service au salus animarum, car il permet aux fidèles de connaître et d’accepter la vérité de leur réalité personnelle. En effet, «toute sentence juste de validité ou de nullité de mariage est une contribution à la culture de l’indissolubilité, que ce soit dans l’Eglise ou dans le monde» (saint Jean-
Paul ii, Discours à la Rote romaine, 29 janvier 2002).
Chers frères et sœurs, l’Eglise vous confie une tâche de grande responsabilité, mais surtout de grande beauté: contribuer à purifier et à restaurer les relations interpersonnelles. Le contexte jubilaire dans lequel nous nous trouvons remplit votre travail d’espérance, l’espérance qui ne déçoit pas (cf. Rm 5, 5). J’invoque sur vous tous, peregrinantes in spem, la grâce d’une conversion joyeuse et la lumière pour accompagner les fidèles vers le Christ, qui est le Juge doux et miséricordieux. Je vous bénis de tout cœur et vous demande de prier pour moi Merci!
Audience jubilaire
Salle Paul vi, 1er février 2025
Espérer, c’est se retourner
vers Dieu
Chers frères et sœurs!
Le Jubilé est pour les personnes et pour la Terre un nouveau départ; c’est un temps où tout doit être repensé dans le cadre du rêve de Dieu. Et nous savons que le mot conversion signifie changement de direction. Tout peut enfin être vu d’une autre perspective et nos pas se dirigent donc aussi vers de nouvelles destinations. C’est ainsi que naît l’espérance qui ne déçoit jamais. La Bible en parle de multiples façons. Et pour nous aussi, l’expérience de la foi a été stimulée par des rencontres avec des personnes qui ont su changer de vie et qui sont pour ainsi dire entrées dans les rêves de Dieu. En effet, même s’il y a beaucoup de mal dans le monde, nous pouvons distinguer ceux qui sont différents: leur grandeur, qui coïncide souvent avec la petitesse, nous conquiert.
Dans les Evangiles, la figure de Marie Madeleine se distingue de toutes les autres pour cette raison. Jésus l’a guérie avec miséricorde (cf. Lc 8, 2) et elle a été transformée. Sœurs et frères, la miséricorde change, change le cœur. Et Marie Madeleine, la miséricorde l’a ramenée dans les rêves de Dieu et a donné de nouvelles destinations à son chemin.
L’Evangile de Jean raconte sa rencontre avec Jésus Ressuscité d’une manière qui fait réfléchir. Il est répété à plusieurs reprises que Marie s’est retournée. L’évangéliste choisit bien ses mots! En larmes, Marie regarde d’abord à l’intérieur du tombeau, puis se retourne: le Ressuscité n’est pas du côté de la mort, mais du côté de la vie. Il peut être confondu avec l’une des personnes que nous rencontrons chaque jour. Puis, lorsqu’elle entend prononcer son propre nom, l’Evangile dit que Marie se retourne à nouveau. C’est ainsi que son espérance grandit: elle regarde maintenant le tombeau, mais pas comme avant. Elle peut sécher ses larmes, car elle a entendu son propre nom: seul son Maître le prononce ainsi. L’ancien monde semble encore être là, mais il n’est plus. Quand nous sentons que l’Esprit Saint agit dans notre cœur et quand nous sentons que le Seigneur nous appelle, savons-nous distinguer la voix du Maître?
Chers frères et sœurs, de Marie Madeleine, que la tradition appelle «l’apôtre des apôtres», nous apprenons l’espérance. On entre dans le monde nouveau en se convertissant plus d’une fois. Notre cheminement est une invitation constante à changer de perspective. Le Ressuscité nous fait entrer dans son monde, pas à pas, à condition que nous ne prétendions pas tout savoir.
Posons-nous la question aujourd’hui: est-ce que je sais me retourner et regarder les choses différemment, avec un regard différent? Ai-je le désir de me convertir?
Un ego trop confiant et trop orgueilleux nous empêche de reconnaître Jésus ressuscité: aujourd’hui encore, son apparence est celle des gens ordinaires qui restent facilement derrière nous. Même quand nous pleurons et désespérons, nous le laissons derrière nous. Au lieu de regarder dans les ténèbres du passé, dans le vide d’un tombeau, nous apprenons de Marie Madeleine à nous tourner vers la vie. C’est là que notre Maître nous attend. C’est là que notre nom est prononcé. Car dans la vie réelle, il y a une place pour nous, toujours et partout. Il y a une place pour toi, pour moi, pour chacun. Personne ne peut la prendre, car elle nous a toujours été destinée. C’est moche, comme on le dit vulgairement, c’est moche de laisser la chaise vide. Cette place est pour moi, si je n’y vais pas… Chacun peut dire: j’ai une place, je suis une mission! Pensez à cela: quelle est ma place? Quelle est la mission que le Seigneur me donne? Que cette pensée nous aide à avoir une attitude courageuse dans la vie. Merci.
A l’issue de l’Audience jubilaire, le Pape a prononcé les saluts suivants:
J’adresse une cordiale bienvenue aux pèlerins présents dans cette salle et à ceux reliés depuis la basilique vaticane. Aujourd’hui vous êtes nombreux et il est nécessaire de le faire en deux lieux, mais reliés.
Chers frères et sœurs, je vous encourage à comprendre et accueillir toujours plus l’amour de Dieu, source et raison de notre véritable joie.
Je donne à tous ma bénédiction!
Angelus Domini
Place Saint-Pierre, 2 février 2025
Que les responsables chrétiens fassent tout le possible pour mettre fin aux conflits en cours
Chers frères et sœurs, bon dimanche!
Aujourd’hui, l’Evangile de la liturgie (Lc 2, 22-40) nous raconte comment Marie et Joseph portent l’enfant Jésus au Temple de Jérusalem. Selon la Loi, ils le présentent dans la demeure de Dieu, pour rappeler que la vie vient du Seigneur. Alors que la Sainte Famille fait ce qui a toujours été fait par le peuple d’Israël, de génération en génération, il se produit quelque chose qui n’était jamais arrivé auparavant.
Deux personnes âgées, Siméon et Anne, prophétisent sur Jésus: tous les deux louent Dieu et parlent de l’enfant «à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem» (v. 38). Leurs voix émues résonnent parmi les vieilles pierres du Temple, annonçant la réalisation des attentes d’Israël. Dieu est vraiment présent au milieu de son peuple, non pas parce qu’il habite entre quatre murs, mais parce qu’il vit comme un homme parmi les hommes. Telle est la nouveauté de Jésus. Dans la vieillesse de Siméon et d’Anne, se produit la nouveauté qui change l’histoire du monde.
De leur côté, Marie et Joseph étaient étonnés de ce qu’ils entendaient au sujet de Jésus (cf. 33). En effet, lorsque Siméon prend l’enfant dans ses bras, il l’appelle de trois belles manières, qui méritent réflexion. Trois manières, trois noms qu’il lui donne. Jésus est le salut; Jésus est la lumière; Jésus est signe de contradiction.
Tout d’abord, cet enfant est le salut. C’est ce que dit Siméon en priant Dieu: «car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples» (vv. 30-31). Cela nous laisse toujours stupéfaits: le salut universel concentré en un seul! Oui, parce qu’en Jésus habite toute la plénitude de Dieu, de son Amour (cf. Col 2, 9).
Deuxième aspect: Jésus est «lumière pour éclairer les nations» (v. 32). Comme le soleil qui se lève sur le monde, cet enfant le délivrera des ténèbres du mal, de la douleur et de la mort. Nous avons grand besoin, aujourd’hui encore, de lumière, de cette lumière!
Enfin, l’enfant embrassé par Siméon est un signe de contradiction «afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs» (v. 35). Jésus révèle le critère de jugement de toute l’histoire et de son drame, et aussi de la vie de chacun de nous. Et quel est ce critère? C’est l’amour: celui qui aime vit, celui qui hait meurt.
Jésus est le salut, Jésus est la lumière et Jésus est le signe de contradiction.
Eclairés par cette rencontre avec Jésus, nous pouvons alors nous demander: moi, qu’est-ce que j’attends de ma vie? Quelle est ma grande espérance? Mon cœur désire-t-il voir le visage du Seigneur? Est-ce que j’attends la manifestation de son dessein de salut pour l’humanité?
Prions ensemble Marie, Mère très pure, pour qu’elle nous accompagne, à travers les lumières et les ombres de l’histoire, qu’elle nous accompagne toujours à la rencontre avec le Seigneur.
Au terme de l’Angelus, le Pape a prononcé les paroles suivantes:
Chers frères et sœurs!
Aujourd’hui, en Italie, est célébrée la Journée pour la vie, dont le thème est «Transmettre la vie, espérance pour le monde». Je m’unis aux évêques italiens pour exprimer la reconnaissance envers les nombreuses familles qui accueillent volontiers le don de la vie et pour encourager les jeunes couples à ne pas avoir peur d’avoir des enfants. Et je salue le Mouvement pour la vie italien, qui célèbre 50 ans de fondation. Joyeux anniversaire!
Demain aura lieu au Vatican le Sommet international sur les droits des enfants, dont le thème est «Aimons-les et protégeons-les», que j’ai eu la joie de promouvoir et auquel je participerai. C’est une occasion unique de mettre au centre de l’attention les questions les plus urgentes concernant les vies des enfants. Je vous invite à vous unir dans la prière pour sa réussite.
Et à propos de la valeur primaire de la vie humaine, je répète mon «non» à la guerre, qui détruit, détruit tout, détruit la vie et incite à la mépriser. Et n’oublions pas que la guerre est toujours une défaite. En cette année jubilaire, je renouvelle l’appel, spécialement à l’égard des responsables de foi chrétienne, afin que tout soit fait au cours des négociations pour mettre fin à tous les conflits en cours. Prions pour la paix dans l’Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël, au Liban, en Birmanie, au Soudan, dans le Nord -Kivu.
Je vous salue tous, pèlerins d’Italie et venus du monde entier. Je salue les fidèles de l’Ecole de Provence de Marseille et le groupe paroissial de Nanterre.
Je souhaite à tous un bon dimanche. S’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir!
Premières Vêpres
de la Présentation du Seigneur
Basilique Saint-Pierre, 2 février 2025
Un témoignage qui est levain dans l’Eglise
«Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté» (He 10, 7). Par ces paroles, l’auteur de la Lettre aux Hébreux manifeste la pleine adhésion de Jésus au projet du Père. Nous les lisons aujourd’hui en la fête de la Présentation du Seigneur, Journée mondiale de la vie consacrée, au cours du Jubilé de l’espérance, dans un contexte liturgique caractérisé par le symbole de la lumière. Et vous tous, sœurs et frères, qui avez choisi la voie des conseils évangéliques, vous vous êtes consacrés, comme une «Epouse devant l’Epoux […] entourée de sa lumière» (saint Jean-Paul ii, Exhort. ap. Vita consecrata, n. 15); vous vous êtes consacrés à ce même projet lumineux du Père qui remonte aux origines du monde. Il s’accomplira pleinement à la fin des temps, mais dès maintenant il se rend visible à travers «les merveilles opérées par Dieu dans la fragile humanité des personnes qu’il appelle» (ibid., n. 20). Réfléchissons donc à la manière dont, à travers les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance que vous avez prononcés, vous pouvez vous aussi être porteurs de lumière pour les femmes et les hommes de notre temps.
Premier aspect: la lumière de la pauvreté. Elle s’enracine dans la vie même de Dieu, don mutuel éternel et total du Père, du Fils et de l’Esprit Saint (ibid., n. 21). En exerçant la pauvreté, la personne consacrée, par un usage libre et généreux de toutes les choses, se fait porteuse de bénédiction à travers elles: manifeste leur bonté dans l’ordre de l’amour, rejette tout ce qui peut en ternir leur beauté — égoïsme, cupidité, dépendance, l’usage violent et à des fins de mort — et embrasse au contraire tout ce qui peut l’en exalter: la sobriété, la générosité, le partage, la solidarité. Et Paul le dit: «Tout est à vous! Mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu» (1 Co 3, 22-23). C’est cela la pauvreté.
Le deuxième élément est la lumière de la chasteté. Elle aussi trouve son origine dans la Trinité et manifeste un «reflet de l’amour infini qui relie les trois Personnes divines» (Vita consecrata, n. 21). Sa profession, dans le renoncement à l’amour conjugal et sur la voie de la continence, réaffirme la primauté absolue, pour l’être humain, de l’amour de Dieu, reçu avec un cœur indivis et sponsal (cf. 1 Co 7, 32-36), et l’indique comme la source et le modèle de tout autre amour. Nous le savons, nous vivons dans un monde souvent marqué par des formes déformées d’affectivité, où le principe du «ce qui me plaît» — ce principe — pousse à chercher dans l’autre davantage la satisfaction de ses besoins que la joie d’une rencontre féconde. C’est vrai. Cela engendre, dans les relations, des attitudes de superficialité et de précarité, l’égocentrisme, l’hédonisme, l’immaturité et l’irres-ponsabilité morale, où l’époux et l’épouse de toute la vie sont remplacés par le partenaire du moment, les enfants accueillis comme un don par ceux revendiqués comme un «droit» ou éliminés comme une «nuisance».
Sœurs, frères, dans un tel contexte, face à «un besoin croissant de transparence dans les rapports humains» (Vita consecrata, n. 88) et à l’humanisation des liens entre les personnes et les communautés, la chasteté consacrée nous montre — montre à l’homme et à la femme du vingt et unième siècle — une voie pour guérir du mal de l’isolement, dans l’exercice d’une manière d’aimer libre et libératrice, qui accueille et respecte tout le monde et ne contraint ni ne rejette personne. Quel remède pour l’âme que de rencontrer des religieuses et des religieux capables d’une telle relation mûre et joyeuse! Ils sont un reflet de l’amour divin (cf. Lc 2, 30-32). Mais pour cela, il est important, dans nos communautés, de prendre soin de la croissance spirituelle et affective des personnes, dès la formation initiale, et aussi dans la permanente, afin que la chasteté manifeste vraiment la beauté de l’amour donné et que ne s’installent pas des phénomènes délétères tels que l’aigreur du cœur ou l’ambiguïté des choix, source de tristesse, d’insatisfaction et cause, parfois, chez des sujets plus fragiles,
le développement de véritables «doubles vies». La lutte contre la tentation de la double vie est quotidienne. Elle est quotidienne.
Et nous arrivons au troisième aspect: la lumière de l’obéissance. Le texte que nous avons écouté nous en parle également, en nous présentant, dans le rapport entre Jésus et le Père, la «la beauté libérante d’une dépendance filiale et non servile, riche d’un sens de la responsabilité et animée par une confiance réciproque» (Vita consecrata, n. 21). C’est vraiment la lumière de la Parole qui se fait don et réponse d’amour, un signe pour notre société, dans laquelle on a tendance à beaucoup parler mais peu écouter: en famille, au travail et surtout sur les réseaux sociaux, où l’on peut échanger des fleuves de mots et d’images sans jamais se rencontrer vraiment, parce qu’on ne s’engage pas vraiment les uns pour les autres. Et c’est une chose intéressante. Bien souvent, dans le dialogue quotidien, avant que l’on ait fini de parler, la réponse est déjà là. On n’écoute pas. Ecouter avant de répondre. Accueillir la parole de l’autre comme un message, comme un trésor, même comme une aide pour moi. L’obéissance consacrée est un antidote à cet individualisme solitaire, en promouvant comme alternative un modèle de relation basé sur l’écoute active, dans lequel le «dire» et le «sentir» sont suivis par le concret de l’«agir», et cela même au prix d’un renoncement à mes goûts, projets et préférences. Ce n’est qu’ain-si, en effet, que l’on peut faire pleinement l’expérience de la joie du don, en surmontant la solitude et en découvrant le sens de son existence dans le grand dessein de Dieu.
Je voudrais conclure en rappelant un autre point: le «retour aux origines», dont on parle tant aujourd’hui dans la vie consacrée. Mais pas un retour aux origines comme un retour au musée, non. Un vrai retour à l’origine même de notre vie. A ce propos, la Parole de Dieu que nous avons entendue nous rappelle que le premier et le plus important «retour aux origines» de toute consécration est, pour nous tous, le retour au Christ et à son «oui» au Père. Elle nous rappelle que le renouveau, avant les réunions et les «tables rondes» se fait devant le Tabernacle, dans l’adoration. Sœurs, frères, nous avons un peu perdu le sens de l’adoration. Nous sommes trop pratiques, nous voulons faire des choses, mais… Adorer. Adoration. La capacité d’adorer en silence. C’est ainsi que nous redécouvrons nos nos propres Fondatrices et Fondateurs avant tout comme des femmes et des hommes de foi, répétant avec eux dans la prière et l’offrande: «Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté» (He 10, 7).
Merci beaucoup à vous pour votre témoignage. Il est un levain dans l’Eglise. Merci.
Discours aux participants au Sommet mondial sur les droits des enfants
Salle Clémentine, 3 février 2025
Tuer les enfants, c’est nier l’avenir
Maître,
chers frères et sœurs, bonjour!
Je salue Messieurs les Cardinaux et les personnalités présentes à l’occasion de la Rencontre mondiale sur les droits des enfants dont le thème est «Aimons-les et protégeons-les». Je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation et je suis confiant que, en mettant en commun vos expériences et compétences, vous pourrez ouvrir de nouvelles voies pour secourir et protéger les enfants dont les droits sont chaque jour bafoués et ignorés.
Aujourd’hui encore, la vie de millions d’enfants est marquée par la pauvreté, la guerre, la privation d’éducation, l’injustice et l’exploitation. Les enfants et les adolescents des pays les plus pauvres ou déchirés par des conflits tragiques sont contraints de faire face à des épreuves terribles. Même le monde le plus riche n’est pas épargné par les injustices. Là où, grâce à Dieu, on ne souffre ni de la guerre ni de la faim, il existe néanmoins des périphéries difficiles où les enfants sont souvent victimes de fragilités et de problèmes que nous ne pouvons sous-estimer. En effet, plus que jamais, les écoles et les services de santé doivent faire face à des enfants déjà éprouvés par de nombreuses difficultés, à des jeunes anxieux ou déprimés, à des adolescents qui empruntent les chemins de l’agressivité ou de l’automutilation. De plus, selon la culture de l’efficacité, l’enfance elle-même, tout comme la vieillesse, est reléguée aux «périphéries» de l’existence.
De plus en plus souvent, ceux qui ont la vie devant eux ne parviennent pas à la regarder avec confiance et optimisme. Ce sont pourtant les jeunes qui, dans la société, sont les signes d’espérance, mais ils ont du mal à percevoir cette espérance en eux-mêmes. C’est à la fois triste et préoccupant. «Lorsque l’avenir est incertain et imperméable aux rêves, lorsque les études n’offrent pas de débouchés et que le manque de travail ou d’emploi suffisamment stable risque d’annihiler les désirs, il est inévitable que le présent soit vécu dans la mélancolie et l’ennui» (Bulle Spes non confundit, n. 12).
Ce qui se passe presque chaque jour ces derniers temps est inacceptable: des enfants meurent sous les bombes, sacrifiés aux idoles du pouvoir, de l’idéologie, des intérêts nationalistes. En réalité, rien ne vaut la vie d’un enfant. Tuer les enfants, c’est nier l’avenir. Dans certains cas, des mineurs sont contraints de combattre sous l’effet de drogues. Même dans des pays qui ne sont pas en guerre, la violence entre bandes criminelles devient tout aussi meurtrière pour les jeunes, les laissant souvent orphelins et marginalisés.
L’individualisme exacerbé des pays développés nuit également aux enfants. Parfois, ils sont maltraités ou même supprimés par ceux qui devraient les protéger et les nourrir; ils sont victimes de conflits, de détresse sociale ou mentale, et des dépendances de leurs parents.
Beaucoup d’enfants meurent comme migrants, en mer, dans le désert ou sur les nombreuses routes des voyages de l’espoir désespéré. Beaucoup d’autres succombent faute de soins ou à cause de diverses formes d’exploitation. Ce sont des situations différentes, mais devant lesquelles nous nous posons la même question: comment est-il possible que la vie d’un enfant puisse finir ainsi?
Non. Ce n’est pas acceptable et nous ne devons pas nous y habituer. L’enfance niée est un cri silencieux dénonçant l’iniquité du système économique, la criminalité des guerres, le manque de soins médicaux et d’éducation scolaire. Ces injustices pèsent surtout sur les enfants et les plus faibles. Dans les organisations internationales, on parle de «crise morale mondiale».
Aujourd’hui, nous sommes ici pour affirmer que nous refusons que cela devienne une nouvelle normalité. Nous ne pouvons pas accepter de nous y habituer. Certaines dynamiques médiatiques tendent à rendre l’humanité insensible, provoquant un endurcissement général des mentalités. Nous risquons de perdre ce qu’il y a de plus noble dans le cœur humain: la pitié, la miséricorde. Plus d’une fois, nous avons partagé cette préoccupation avec certains d’entre vous qui représentent des communautés religieuses.
Aujourd’hui, plus de quarante millions d’enfants sont déplacés à cause des conflits, et environ cent millions sont sans domicile fixe. Il existe le drame de l’esclavage infantile: environ cent -soixante millions d’enfants sont victimes du travail forcé, de la traite, d’abus et d’exploitation en tout genre, dont des mariages forcés. Des millions d’enfants migrants, parfois avec leur famille, mais souvent seuls, sont concernés: le phénomène des mineurs non accompagnés est de plus en plus fréquent et grave.
De nombreux autres mineurs vivent dans un vide administratif car leur naissance n’a pas été déclarée. On estime qu’environ cent cinquante millions d’enfants «invisibles» n’ont pas d’existence légale. Cela constitue un obstacle à l’accès à l’éducation ou aux soins de santé, mais surtout, ces enfants ne bénéficient d’aucune protection légale et peuvent être facilement maltraités ou vendus comme esclaves. Et cela se produit! Pensons aux enfants Rohingyas, souvent en difficulté pour être déclarés, aux enfants indocumentados à la frontière des Etats-Unis, premières victimes de cet exode de désespoir et d’espérance de milliers de personnes montant du Sud vers les Etats-Unis, et à de nombreux d’autres.
Malheureusement, cette histoire d’oppression des enfants se répète: si nous interrogeons les personnes âgées, nos grands-parents, sur la guerre vécue lorsqu’ils étaient petits, nous verrons émerger de leur mémoire la tragédie: l’obscurité — tout est sombre pendant la guerre, les couleurs disparaissent presque —, les odeurs nauséabondes, le froid, la faim, la saleté, la peur, la vie errante, la perte des parents, de la maison, l’abandon, les violences. J’ai grandi avec les récits de la Première Guerre mondiale de mon grand-père, et cela m’a ouvert les yeux et le cœur sur l’horreur de la guerre.
Regarder avec les yeux de ceux qui ont vécu la guerre est le meilleur moyen de comprendre la valeur inestimable de la vie. Mais écouter aussi les enfants qui aujourd’hui vivent dans la violence, l’exploitation ou l’injustice nous aide à renforcer notre «non» à la guerre, à la culture du déchet et du profit, où tout s’achète et se vend sans respect ni soin pour la vie, surtout celle des enfants et des personnes vulnérables. Au nom de cette logique du rejet, où l’être humain se prend pour un être tout-puissant, la vie qui naît est sacrifiée par la pratique homicide de l’avortement. L’avortement supprime la vie des enfants et coupe à la source l’espérance de toute la société.
Sœurs et frères, il est important d’écouter: nous devons nous rendre compte que les enfants observent, comprennent et se souviennent. Et par leurs regards et leurs silences, ils nous parlent. Ecoutons-les!
Chers amis, je vous remercie et vous encourage à valoriser au maximum, avec l’aide de Dieu, l’opportunité de cette rencontre. Je prie pour que votre contribution puisse aider à bâtir un monde meilleur pour les enfants, et donc pour tous! Voir que nous sommes ici, tous ensemble, pour mettre au centre les enfants, leurs droits, leurs rêves, leur aspiration à un avenir, me donne de l’espérance. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse!
Le Pape est également intervenu à la session de l’après-midi, en concluant les travaux par les paroles de remerciement suivantes:
Je souhaite exprimer du fond du cœur ma gratitude au terme de cette rencontre sur les droits des enfants.
Grâce à vous, les salles du Palais apostolique sont devenues un «observatoire» ouvert sur la réalité de l’enfance dans le monde entier, une enfance qui malheureusement est souvent meurtrie, exploitée, niée. Votre présence, votre expérience et votre compassion ont donné vie à un observatoire et surtout à un «atelier»: en différents groupes thématiques, vous avez élaboré des propositions pour protéger les droits des enfants, en les considérant non pas comme des nombres, mais comme des visages.
Tour cela donne de la gloire à Dieu, et nous nous confions à Lui, car son Esprit Saint le rend fécond et fructueux. Le père Faltas a prononcé une parole, une phrase que j’aime beaucoup: «Les enfants nous regardent». C’est également le titre d’un film connu. Les enfants nous regardent: ils nous regardent pour voir comment nous allons de l’avant dans la vie.
Pour ma part, pour donner une continuité à cet engagement et pour le promouvoir dans toute l’Eglise, j’ai l’intention de préparer une Lettre, ou une Exhortation, je ne sais pas encore, consacrée aux enfants.
Merci encore à tous! Merci à tous et chacun d’entre vous.
Audience générale
Salle Paul vi, 5 février 2025
Aller à la rencontre des autres comme Marie sans craindre
les dangers et les préjugés
Chers frères et sœurs, bonjour!
Nous contemplons aujourd’hui la beauté de Jésus-Christ, notre espérance, dans le mystère de la Visitation. La Vierge Marie rend visite à sainte Elisabeth, mais c’est surtout Jésus, dans le sein de sa mère, qui visite son peuple (cf. Lc 1, 68), comme le dit Zacharie dans son hymne de louange.
Après l’étonnement et l’émerveillement face à ce que lui a annoncé l’Ange, Marie se lève et se met en route, comme tous ceux qui sont appelés dans la Bible, car «le seul acte par lequel un homme peut correspondre au Dieu de la révélation consiste à se rendre disponible sans limites» (Hans Urs von Balthasar, Vocation, Saint John Publications, 2022). Cette jeune fille d’Israël ne choisit pas de se protéger du monde, ne craint pas les dangers et les jugements des autres, mais va à la rencontre des autres.
Quand on se sent aimé, on fait l’expérience d’une force qui met l’amour en mouvement; comme le dit l’apôtre Paul, «l’amour du Christ nous saisit» (2 Co 5, 14), il nous pousse, il nous met en mouvement. Marie ressent la poussée de l’amour et va aider une femme qui est sa parente, mais aussi une vieille femme qui, après une longue attente, accueille une grossesse inespérée, lourde à gérer à son âge. Mais la Vierge se rend aussi auprès d’Elisabeth pour partager sa foi dans le Dieu de l’impossible et son espérance dans l’accomplissement de ses promesses.
La rencontre entre les deux femmes produit un effet surprenant: la voix de la «pleine de grâce» qui salue Elisabeth provoque la prophétie dans l’enfant que la vieille femme porte en son sein et suscite en elle une double bénédiction: «tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni» (Lc 1, 42). Et aussi une béatitude: «Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur» (v. 45).
Face à la reconnaissance de l’identité messianique de son Fils et de sa mission de mère, Marie ne parle pas d’elle-même mais de Dieu et élève une louange pleine de foi, d’espérance et de joie, un chant qui résonne chaque jour dans l’Eglise lors de la prière des vêpres: le Magnificat (Lc 1, 46-55).
Cette louange du Dieu Sauveur, qui a jailli du cœur de son humble servante, est un mémorial solennel qui synthétise et accomplit la prière d’Israël. Elle est tissée de résonances bibliques, signe que Marie ne veut pas chanter «hors du chœur» mais se mettre au diapason des pères, en exaltant sa compassion envers les humbles, ces petits que Jésus, dans sa prédication, déclarera «bienheureux» (cf. Mt 5, 1-12).
La présence massive du motif pascal fait également du Magnificat un chant de rédemption, qui a pour toile de fond le souvenir de la libération d’Israël de l’Egypte. Les verbes sont tous au passé, imprégnés d’une mémoire d’amour qui embrase de foi le présent et illumine d’espérance l’avenir: Marie chante la grâce du passé, mais elle est la femme du présent qui porte l’avenir en ses entrailles.
La première partie de ce cantique loue l’action de Dieu en Marie, microcosme du peuple de Dieu qui adhère pleinement à l’alliance (v. 46-50); la seconde partie embrasse l’œuvre du Père dans le macrocosme de l’histoire de ses enfants (v. 51-55), à travers trois mots-clés: mémoire — miséricorde — promesse.
Le Seigneur, qui s’est penché sur la petite Marie pour faire en elle «de grandes choses» et la rendre mère du Seigneur, a commencé à sauver son peuple à partir de l’exode, en se souvenant de la bénédiction universelle promise à Abraham (cf. Gn 12, 1-3). Le Seigneur, Dieu fidèle pour toujours, a déversé un flot ininterrompu d’amour miséricordieux «de génération en génération» (v. 50) sur le peuple fidèle à l’alliance, et il manifeste maintenant la plénitude du salut en son Fils, envoyé pour sauver le peuple de ses péchés. D’Abraham à Jésus-Christ et à la communauté des croyants, la Pâque apparaît donc comme la catégorie herméneutique pour comprendre toute libération ultérieure, jusqu’à celle réalisée par le Messie à la plénitude des temps.
Chers frères et sœurs, demandons aujourd’hui au Seigneur la grâce de savoir attendre l’accomplissement de toute sa promesse et de nous aider à accueillir la présence de Marie dans notre vie. En nous mettant à son école, puissions-nous tous découvrir que toute âme qui croit et espère «conçoit et engendre la Parole de Dieu» (Saint Ambroise, Traité sur l’Evangile de S. Luc, ii, n. 26).
Au terme de l’Audience générale, le Pape a lancé les appels suivants:
J’adresse une cordiale bienvenue aux pèlerins.
Pensons aux pays qui souffrent de la guerre: l’Ukraine martyrisée, Israël, la Palestine… De nombreux pays qui souffrent là-bas. Rappelons les déplacés de Palestine et prions pour eux.
Comme l’exhorte l’apôtre Paul, je vous encourage à être joyeux dans l’espérance, constants dans les tribulations, assidus dans la prière, prenant part aux besoins des frères (cf. Rm 12, 12-13).
Je donne à tous ma bénédiction!
Parmi les pèlerins ayant assisté à l’Audience générale étaient présents les groupes francophones suivants:
De France: Groupe de pèlerins du diocèse de Bordeaux, avec S.Exc. Mgr. Jean-Paul James; Communauté du Chemin Neuf; lycée Notre-Dame-de-Sion, de Marseille; lycée Saint-Louis, de Lorient; lycée Notre-Dame, de Boulogne; collège Stanislas, de Paris; collège Jeanne d’Arc, de -Bayeux; collège Saint-Joseph, de Fouesnant; collège La Rochefoucauld, de Paris; groupe d’étudiants, du Loiret; centre Madeleine Daniélou, de Rueil-Malmaison; groupe Saint-Pierre, de Lebisey; groupe de la Diaconie de la Beauté.
De Belgique: Groupe d’étudiants, de Bruxelles.
Je salue cordialement les groupes de pèlerins de langue française, venus de France et de Belgique, en particulier le diocèse de Bordeaux, les collèges Stanislas et La Rochefoucauld, de Paris, le centre Madeleine Daniélou et les étudiants du Loiret et de Bruxelles.
Demandons au Seigneur de renforcer notre foi dans l’accomplissement de ses promesses et mettons-nous à l’école de Marie, en cultivant un cœur disponible pour Dieu et les frères pour rendre notre monde plus joyeux et plus fraternel. Que Dieu vous bénisse.
Message pour la Journée mondiale
des missions 2025
Missionnaires de l’espérance
parmi les peuples
Chers frères et sœurs!
Pour la Journée mondiale des missions de l’Année jubilaire 2025, dont le message central est l’espérance (cf. Bulle Spes non confundit, n. 1), j’ai choisi cette devise: «Missionnaires de l’espérance parmi les peuples». Elle rappelle à chaque chrétien et à l’Eglise, communauté des baptisés, la vocation fondamentale d’être, à la suite du Christ, des messagers et des bâtisseurs d’espérance. Je souhaite à tous un temps de grâce avec le Dieu fidèle qui nous a fait renaître dans le Christ ressuscité «pour une vivante espérance» (cf. 1 P 1, 3-4). Je désire rappeler quelques aspects pertinents de l’identité missionnaire chrétienne, afin que nous nous laissions guider par l’Esprit de Dieu et que nous brûlions d’un saint zèle pour une nouvelle saison évangélisatrice de l’Eglise, envoyée pour raviver l’espérance dans un monde sur lequel planent des ombres obscures (cf. Lett. enc. Fratelli tutti, nn. 9-55).
1. Sur les traces du Christ, notre espérance
En célébrant le premier Jubilé ordinaire du Troisième millénaire, après celui de l’an 2000, nous gardons le regard fixé sur le Christ qui est au centre de l’histoire, «le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité» (He 13, 8). Dans la synagogue de Nazareth, il a déclaré l’accomplissement de l’Ecriture dans l’«aujourd’hui» de sa présence historique. Il s’est ainsi révélé comme l’Envoyé du Père, avec l’onction de l’Esprit Saint, pour apporter la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et pour inaugurer «l’année de grâce du Seigneur» pour toute l’humanité (cf. Lc 4, 16-21).
Dans cet «aujourd’hui» mystique qui dure jusqu’à la fin du monde, le Christ est l’accomplissement du salut pour tous, en particulier pour ceux dont l’unique espérance est Dieu. Dans sa vie terrestre, il «passait en faisant le bien et en guérissant tous» du mal et du Malin (cf. Ac 10, 38), redonnant l’espérance en Dieu aux nécessiteux et au peuple. En outre, il a fait l’expérience de toutes les fragilités humaines, à l’exception de celle du péché, passant même par des moments critiques qui pouvaient conduire au désespoir, comme dans l’agonie de Gethsémani et sur la croix. Mais Jésus confiait tout à Dieu le Père, obéissant avec une confiance totale à son plan de salut pour l’humanité, un plan de paix pour un avenir plein d’espérance (cf. Jr 29, 11). Il est ainsi devenu le divin Missionnaire de l’espérance, le modèle suprême de ceux qui, au cours des siècles, portent en avant la mission reçue de Dieu, même dans des épreuves extrêmes.
A travers ses disciples, envoyés à tous les peuples et accompagnés mystiquement par Lui, le Seigneur Jésus poursuit son ministère d’espérance pour l’humanité. Il se penche encore sur chaque personne pauvre, affligée, désespérée et rongée par le mal, pour verser «sur ses plaies l’huile de la consolation et le vin de l’espérance» (Préface «Jésus le bon Samaritain»). Obéissant à son Seigneur et Maître et avec le même esprit de service, l’Eglise, communauté des disciples-missionnaires du Christ, prolonge cette mission, offrant sa vie pour tous au milieu des peuples. Tout en devant faire face, d’une part, aux persécutions, aux tribulations et aux difficultés et, d’autre part, à ses propres imperfections et chutes dues aux faiblesses de chacun de ses membres, elle est constamment poussée par l’amour du Christ à avancer unie à Lui sur ce chemin missionnaire et à prendre en charge, comme Lui et avec Lui, le cri de l’humanité, et même le gémissement de toute créature en attente de la rédemption définitive. Telle est l’Eglise que le Seigneur appelle toujours et pour toujours à suivre ses traces: «Pas une Eglise statique, [mais] une Eglise missionnaire, qui marche avec le Seigneur sur les routes du monde» (Homélie de la Messe de clôture de l’Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, 27 octobre 2024).
Sentons-nous donc inspirés nous aussi à nous mettre en route sur les traces du Seigneur Jésus pour devenir, avec Lui et en Lui, des signes et des messagers d’espérance pour tous, en tout lieu et en toute circonstance que Dieu nous donne de vivre. Que tous les baptisés, disciples-missionnaires du Christ, fassent briller son espérance en tous les coins de la terre!
2. Les chrétiens, porteurs et constructeurs d’espérance parmi les peuples
En suivant le Christ Seigneur, les chrétiens sont appelés à transmettre la Bonne Nouvelle en partageant les conditions de vie concrètes de ceux qu’ils rencontrent et en devenant ainsi porteurs et constructeurs d’espérance. En effet, «les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur» (Gaudium et spes, n. 1).
Cette célèbre affirmation du Concile Vatican ii, qui exprime le sentiment et le style des communautés chrétiennes à chaque époque, continue d’inspirer leurs membres et les aide à marcher avec leurs frères et sœurs dans le monde. Je pense en particulier à vous, missionnaires ad gentes, qui, suivant l’appel divin, êtes allés dans d’autres nations pour faire connaître l’amour de Dieu dans le Christ. Merci de tout cœur! Votre vie est une réponse concrète au mandat du Christ ressuscité, qui a envoyé les disciples pour évangéliser tous les peuples (cf. Mt 28, 18-20). Ainsi vous rappelez la vocation universelle des baptisés à devenir parmi les peuples, par la force de l’Esprit et l’engagement quotidien, des missionnaires de la grande espérance que nous donne le Seigneur Jésus. L’horizon de cette espérance dépasse les réalités mondaines passagères et s’ouvre aux réalités divines que nous prévoyons déjà dans le présent. En effet, comme le rappelait saint Paul vi, le salut dans le Christ, que l’Eglise offre à tous comme don de la miséricorde de Dieu, n’est pas seulement «immanent, à la mesure des besoins matériels ou même spirituels […] s’identifiant totalement avec les désirs, les espoirs, les affaires et les combats temporels, mais un salut qui déborde toutes ces limites pour s’accomplir dans une communion avec le seul Absolu, celui de Dieu: salut transcendant, eschatologique, qui a certes son commencement en cette vie, mais qui s’accomplit dans l’éternité» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 27).
Animées par une si grande espérance, les communautés chrétiennes peuvent être des signes d’une nouvelle humanité dans un monde qui, dans les zones plus «développées», montre de graves symptômes de crise de l’humain: un sens diffus de désarroi, de solitude et d’abandon des personnes âgées, des difficultés à trouver de la disponibilité au secours de ceux qui vivent à côté. Dans les pays les plus avancés technologiquement, la proximité est en train de disparaître: nous sommes tous interconnectés, mais nous ne sommes pas en relation. L’efficacité ainsi que l’attachement aux choses et aux ambitions nous conduisent à être centrés sur nous-mêmes et incapables d’altruisme. L’Evangile, vécu dans la communauté, peut nous rendre une humanité intègre, saine, rachetée.
Je renouvelle donc l’invitation à accomplir les actions indiquées dans la Bulle d’indiction du Jubilé (cf. nn. 7-15), en portant une attention particulière aux plus pauvres et faibles, aux malades, aux personnes âgées, aux exclus de la société matérialiste et consumériste. Et à le faire avec le style de Dieu: avec proximité, compassion et tendresse, en prenant soin de la relation personnelle avec les frères et les sœurs dans leur situation concrète (cf. -Exhort. ap. Evangelii gaudium, nn. 127-128). Souvent, ce seront donc eux qui nous enseigneront à vivre avec espérance. Et par le contact personnel, nous pourrons transmettre l’amour du Cœur compatissant du Seigneur. Nous expérimenterons que «le Cœur du Christ […] est le noyau vivant de la première annonce» (Lett. enc. Dilexit nos, n. 32). En puisant à cette source, on peut, en effet, offrir avec simplicité l’espérance reçue de Dieu (cf. 1 P 1, 21), en apportant aux autres la même con-solation par laquelle nous sommes consolés par Dieu (cf. 2 Co 1, 3-4). Dans le Cœur humain et divin de Jésus, Dieu veut parler au cœur de chaque personne, en attirant chacun à son Amour. «Nous avons été envoyés pour continuer cette mission: être signe du Cœur du Christ et de l’amour du Père, en embrassant le monde entier» (Discours aux participants à l’assemblée générale des Œuvres pontificales missionnaires, 3 juin 2023).
3. Renouveler la mission de l’espérance
Face à l’urgence de la mission de l’espérance aujourd’hui, les disciples du Christ sont appelés en priorité à se former pour devenir des «artisans» d’espérance et des restaurateurs d’une humanité souvent distraite et malheureuse.
A cette fin, il faut renouveler en nous la spiritualité pascale que nous vivons à chaque célébration eucharistique et surtout durant le Triduum pascal, centre et sommet de l’année liturgique. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection rédemptrice du Christ, dans la Pâque du Seigneur qui marque le printemps éternel de l’histoire. Nous sommes alors «des personnes du printemps», avec un regard toujours rempli d’espérance à partager avec tous, parce que dans le Christ «nous croyons et savons que la mort et la haine ne sont pas les dernières paroles» sur l’existence humaine (cf. Catéchèse, 23 août 2017). C’est pourquoi, à partir des mystères de Pâques qui s’actualisent dans les célébrations liturgiques et dans les sacrements, nous puisons continuellement la force de l’Esprit Saint avec le zèle, la détermination et la patience pour travailler dans le vaste champ de l’évangélisation du monde. «Le Christ ressuscité et glorieux est la source profonde de notre espérance, et son aide ne nous manquera pas dans l’accomplissement de la mission qu’Il nous confie» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 275). En Lui nous vivons et témoignons de cette sainte espérance qui est «un don et une tâche pour chaque chrétien» (La speranza è una luce nella notte, Città del Vaticano 2024, p. 7).
Les missionnaires de l’espérance sont des hommes et des femmes de prière, parce que «la personne qui espère est une personne qui prie», comme le soulignait le vénérable Cardinal Van Thuan, lequel a maintenu vive l’espérance durant la longue tribulation de la prison grâce à la force qu’il recevait de sa prière persévérante et de l’Eucharistie (cf. F.X. Nguyen Van Thuan, Le chemin de l’espérance, Rome 2001, n. 963). N’oublions pas que prier est la première action missionnaire et en même temps «la première force de l’espérance» (Catéchèse, 20 mai 2020).
Renouvelons donc la mission de l’espérance à partir de la prière, surtout celle faite de la Parole de Dieu et en particulier des Psaumes, qui sont une grande symphonie de prière dont le compositeur est l’Esprit Saint (cf. Catéchèse, 19 juin 2024). Les Psaumes nous éduquent à espérer dans l’adversité, à discerner les signes d’espérance et à avoir un constant désir «missionnaire» que Dieu soit loué par tous les peuples (cf. Ps 41, 12; 67, 4). En priant, nous gardons allumée l’étincelle de l’espérance, allumée par Dieu en nous, pour qu’elle devienne un grand feu qui illumine et réchauffe tout autour, y compris par des actions et des gestes concrets inspirés de la prière.
Enfin, l’évangélisation est toujours un processus communautaire, comme le caractère de l’espérance chrétienne (cf. Benoît xvi, Lett. enc. Spe Salvi, n. 14). Ce processus ne se termine pas par la première annonce ni par le baptême, mais il continue avec la construction des communautés chrétiennes à travers l’accompagnement de chaque baptisé sur le chemin de l’Evangile. Dans la société moderne, l’appartenance à l’Eglise n’est jamais une réalité acquise une fois pour toutes. L’action missionnaire de transmettre et de former la foi mûre dans le Christ est donc «le paradigme de toute œuvre de l’Eglise» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 15), une œuvre qui demande communion de prière et d’action. J’insiste encore sur cette synodalité missionnaire de l’Eglise, ainsi que sur le service des Œuvres pontificales missionnaires dans la promotion de la responsabilité missionnaire des baptisés et le soutien des nouvelles Eglises particulières. Et je vous exhorte tous, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, à participer activement à la mission évangélisatrice commune par le témoignage de votre vie et par la prière, par vos sacrifices et votre générosité. Merci beaucoup pour tout cela!
Chères sœurs et chers frères, tournons-nous vers Marie, Mère de Jésus Christ notre espérance. Confions-lui ce souhait pour le Jubilé et pour les années à venir: «Puisse la lumière de l’espérance chrétienne atteindre chacun comme message de l’amour de Dieu adressé à tous! Puisse l’Eglise être un témoin fidèle de cette annonce dans toutes les parties du monde!» (Bulle Spes non confundit, n. 6).
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 25 janvier 2025,
fête de la Conversion de Saint Paul, Apôtre.
François
Message pour la xie Journée mondiale
de réflexion et de prière
contre la traite des personnes
Ambassadeurs de l’espoir: ensemble contre la traite
des personnes
Chers frères et sœurs!
C’est avec joie que je m’unis à vous à l’occasion de la xie Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes. Cet événement marque la commémoration liturgique de sainte Joséphine Bakhita, une femme et religieuse soudanaise, victime de la traite lorsqu’elle était enfant et qui est devenue un symbole de notre engagement contre ce terrible phénomène. En cette année jubilaire, nous marchons ensemble en tant que «pèlerins de l’espérance», y compris sur la route de la lutte contre la traite des personnes.
Mais comment est-il possible de continuer à donner de l’espérance aux millions de personnes, en particulier les femmes et les enfants, les jeunes, les migrants et les réfugiés, qui sont pris au piège de cet esclavage moderne? Comment donner un nouvel élan à la lutte contre le trafic d’organes et de tissus humains, l’exploitation sexuelle des enfants, le travail forcé, dont la prostitution, le trafic d’armes et de stupéfiants? Comment pouvons-nous faire le constat de tout cela à travers le monde et ne pas perdre l’espérance? Ce n’est qu’en levant le regard vers le Christ, notre espérance, que nous pouvons trouver la force d’un engagement renouvelé qui ne se laisse pas abattre par la dimension des problèmes et des drames, mais qui, dans l’obscurité, œuvre pour allumer des flammes de lumière qui, ensemble, peuvent éclairer la nuit jusqu’à ce que l’aube apparaisse.
Les jeunes du monde entier qui luttent contre la traite nous offrent un exemple: ils nous disent que nous devons devenir des ambassadeurs d’espérance et agir ensemble, avec ténacité et amour; que nous devons nous tenir aux côtés des victimes et des survivants.
Avec l’aide de Dieu, nous pouvons éviter de nous habituer à l’injustice, repousser la tentation de penser que certains phénomènes ne peuvent être éradiqués. L’Esprit du Seigneur ressuscité nous soutient dans la promotion courageuse et efficace d’initiatives ciblées visant à affaiblir et à contrer les mécanismes économiques et criminels qui tirent profit de la traite et de l’exploitation. Avant tout, il nous enseigne à écouter, avec -proximité et compassion, les personnes qui ont fait l’expérience de la traite, afin de les aider à se remettre sur pied et d’identifier avec elles les meilleurs moyens de libérer d’autres personnes et de faire de la prévention.
La traite est un phénomène complexe et en cons-tante évolution, alimenté par les guerres, les conflits, la famine et les conséquences du changement climatique. Elle nécessite donc des réponses globales et un effort commun, à tous les niveaux, pour le contrer.
Je vous invite donc tous, en particulier les représentants des gouvernements et des organisations qui partagent cet engagement, à vous joindre à nous, animés par la prière, pour promouvoir les initiatives en faveur de la défense de la dignité humaine, pour l’élimination de la traite des personnes sous toutes ses formes et pour la promotion de la paix dans le monde.
Ensemble — confiants dans l’intercession de sainte Bakhita — nous pouvons mettre en œuvre un grand effort et créer les conditions pour que la traite et l’exploitation soient bannies et que le respect des droits humains fondamentaux prévale, dans la reconnaissance fraternelle de l’humanité commune.
Frères et sœurs, je vous remercie pour le courage et la ténacité avec lesquels vous poursuivez ce travail, en impliquant tant de personnes de bonne volonté. Allez de l’avant avec espérance dans le Seigneur, qui marche avec vous! Je vous bénis de tout cœur. Je prie pour vous et priez pour moi.
Du Vatican, le 4 février 2025
François
Audience au réseau «Talitha Kum»
Maison Sainte-Marthe, 7 février 2025
Une très grave violation
des droits humains fondamentaux
Chers frères et sœurs!
Je suis heureux de vous rencontrer et de m’unir à vous qui êtes chaque jour engagés contre la traite des personnes. Je remercie en particulier «Talitha Kum» pour le service qu’il accomplit. -Merci!
Nous nous retrouvons la veille de la fête de sainte Joséphine Bakhita, qui fut victime de ce terrible fléau social. Son histoire nous donne beau-coup de force, nous montrant que, en dépit des injustices et des souffrances subies, avec la grâce du Seigneur, il est possible de briser les chaînes, de retrouver la liberté et de devenir messagers d’espérance pour d’autres qui sont en difficulté.
La traite est un phénomène mondial qui provoque des millions de victimes et qui ne s’arrête devant rien. Elle trouve toujours de nouvelles façons de s’insinuer dans nos sociétés, à toutes les latitudes. Face à ce drame, nous ne pouvons pas rester indifférents, et précisément comme vous le faites, nous devons unir nos forces, nos voix et rappeler chacun à ses responsabilités, pour lutter contre cette forme de criminalité qui s’enrichit sur la peau des personnes plus vulnérables.
Nous ne pouvons pas accepter que tant de nos sœurs et frères soient exploités de façon si ignoble. Le commerce des corps, l’exploitation sexuelle, notamment de petits garçons et de petites filles, le travail forcé sont une honte et une très grave violation des droits humains fondamentaux.
Je sais que vous êtes un groupe international, certains de vous sont arrivés de très loin pour cette semaine de prière et de réflexion contre la traite. Je vous remercie! Je félicite en particulier les jeunes ambassadeurs contre la traite qui, avec créativité et énergie, trouvent toujours de nouvelles façons de sensibiliser et d’informer.
J’encourage toutes les organisations de ce réseau et toutes les personnes qui en font partie à continuer d’unir vos forces, en plaçant au centre les victimes et les survivants, en écoutant leurs histoires, en prenant soin de leurs blessures et en faisant entendre leur voix. Cela signifie être ambassadeurs d’espérance; et j’espère qu’en ce Jubilé, de nombreuses autres personnes suivront votre exemple.
Je vous bénis et je vous accompagne par la prière. Et vous aussi, s’il vous plaît, priez pour moi. Merci!
Discours aux participants au Jubilé
des forces armées, de la police
et des agents de sécurité
Place Saint-Pierre, 9 février 2025
Promouvoir, sauver et défendre
la vie loin du poison de la haine
et de la guerre
L’attitude de Jésus au lac de Génésareth est décrite par l’évangéliste avec trois verbes: il vit, il monta, il s’assit. Jésus vit, Jésus monta, Jésus s’assit. Jésus ne s’occupe pas de présenter une image de lui-même aux foules, Il ne s’occupe pas de faire des choses, de suivre une feuille de route de sa mission. Au contraire, il met toujours au premier plan la rencontre avec les autres, la relation, le souci pour telle fatigue et tel échec qui souvent alourdissent le cœur et ôtent l’espérance.
C’est pourquoi Jésus, ce jour-là, vit, monta et s’assit.
Tout d’abord, Jésus vit. Il a un regard attentif qui, même au milieu de tant de monde, lui permet de repérer deux barques près du rivage et de voir la déception sur les visages de ces pêcheurs, qui sont en train de laver leurs filets vides après une nuit qui a mal tourné. Jésus dirige son regard plein de compassion. N’oublions pas ceci: la compassion de Dieu. Les trois attitudes de Dieu sont la proximité, la compassion et la tendresse. Ne l’oublions pas: Dieu est proche, Dieu est tendre, Dieu est compatissant, toujours. Jésus dirige son regard plein de compassion dans les yeux de ces personnes, saisissant leur découragement, la frustration d’avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre, le sentiment d’avoir le cœur vide comme ces filets qu’ils ont maintenant dans leurs mains.
Et maintenant, je m’excuse et je demande au maître [des célébrations liturgiques] de continuer à lire, car j’ai du mal à respirer.
Et voyant leur découragement, Jésus monta. Il demande à Simon d’éloigner la barque de la terre, il y monte, entrant dans l’espace de sa vie, prenant la place de cet échec qui habite son cœur. Cela est beau: Jésus ne se limite pas à observer les choses qui ne vont pas, comme nous le faisons souvent en finissant par nous enfermer dans la plainte et l’amertume; Il prend plutôt l’initiative, va à la rencontre de Simon, Il s’arrête avec lui dans ce moment difficile et décide de monter dans la barque de sa vie qui, cette nuit-là, est revenue à terre sans succès.
Enfin, une fois monté, Jésus s’assit. Et ceci, dans les Evangiles, est l’attitude typique du maître, de celui qui enseigne. Car l’Evangile dit qu’Il s’assit et enseigna. Ayant vu dans les yeux et dans le cœur de ces pêcheurs l’amertume d’une nuit de travail qui n’a rien donné, Jésus monte dans la barque pour enseigner, c’est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la lumière dans cette nuit de déception, pour raconter la -beauté de Dieu dans les fatigues de la vie humaine, pour faire sentir qu’il y a encore une espérance même quand tout semble perdu.
Et alors le miracle se produit: quand le Seigneur monte dans la barque de notre vie pour nous apporter la bonne nouvelle de l’amour de Dieu qui nous accompagne toujours et nous soutient, alors la vie recommence, l’espoir renaît, l’enthousiasme perdu revient et nous pouvons jeter le filet à nouveau dans la mer.
Frères et sœurs, cette parole d’espérance nous accompagne aujourd’hui alors que nous célébrons le Jubilé des Forces armées, de la police et de sécurité, que je remercie pour leur service, et saluant toutes les autorités présentes, les associations et les académies militaires, ainsi que les ordinaires militaires et les aumôniers. Une grande mission vous est confiée, qui embrasse de multiples dimensions de la vie sociale et politique: la défense de nos pays, l’engagement pour la sécurité, le maintien de la légalité et de la justice, la présence dans les prisons, la lutte contre la criminalité et les différentes formes de violence qui risquent de troubler la paix sociale. Et je n’oublie pas non plus ceux qui offrent leur important service dans les catastrophes naturelles, pour la sauvegarde de la création, pour le sauvetage des vies en mer, pour les plus fragiles, pour la promotion de la paix.
Le Seigneur vous demande de faire comme lui: voir, monter, s’asseoir. Voir, parce que vous êtes appelés à avoir un regard attentif, qui sait saisir les menaces contre le bien commun, les dangers qui pèsent sur la vie des citoyens, les risques environnementaux, sociaux et politiques auxquels nous sommes exposés. Monter, car vos uniformes, la discipline qui vous a forgés, le courage qui vous caractérise, le serment que vous avez prêté, sont autant de choses qui vous rappellent combien il est important de ne pas seulement voir le mal pour le dénoncer, mais aussi monter dans la barque dans la tempête et s’engager pour qu’elle ne fasse pas naufrage, avec une mission au service du bien, de la liberté et de la justice. Et enfin, vous asseoir, car votre présence dans nos villes et nos quartiers, votre présence toujours du côté du droit et du côté des plus faibles, devient une leçon pour nous tous: elle nous apprend que le bien peut gagner malgré tout, elle nous apprend que la justice, la loyauté et la passion civique sont encore des valeurs nécessaires aujourd’hui, elle nous apprend que nous pouvons créer un monde plus humain, plus juste et plus fraternel, malgré les forces contraires du mal.
Et dans cette tâche qui embrasse toute votre vie, vous êtes accompagnés par les aumôniers, une présence sacerdotale importante au milieu de vous. Ils ne servent pas — comme cela a parfois malheureusement été le cas dans l’histoire — à bénir des actions de guerre perverses. Non. Ils sont parmi vous comme la présence du Christ qui veut vous accompagner, vous offrir une écoute et une proximité, vous encourager à prendre le large et vous soutenir dans la mission que vous accomplissez chaque jour. Comme un soutien moral et spirituel, ils vous accompagnent dans l’accomplissement de vos devoirs à la lumière de l’Evangile et au service du bien.
Chers frères et sœurs, nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous faites, parfois en prenant des risques personnels. Merci parce qu’en montant dans nos barques en danger, vous nous offrez votre protection et nous encouragez à poursuivre notre traversée. Mais je voudrais aussi vous exhorter à ne pas perdre de vue le but de votre service et de vos actions: promouvoir la vie, sauver la vie, défendre la vie, toujours. Je vous demande, s’il vous plaît, d’être vigilants: vigilants face à la tentation de cultiver un esprit de guerre; vigilants pour ne pas être séduits par le mythe de la force et par le bruit des armes; vigilants pour ne pas être contaminés par le poison de la propagande de la haine qui divise le monde en amis à défendre et en ennemis à combattre. Soyez plutôt des témoins courageux de l’amour de Dieu le Père, qui nous veut tous frères. Et, ensemble, marchons pour construire une nouvelle ère de paix, de justice et de fraternité.
Angelus Domini
Place Saint-Pierre, 9 février 2025
Serviteurs de la liberté, jamais
de la domination sur les pays
Chers frères et sœurs,
Avant de conclure la célébration, je désire tous vous saluer, vous qui avez donné vie à ce pèlerinage jubilaire des Forces armées, de la police et des agents de sécurité. Je remercie les autorités civiles pour leur présence et les évêques aux armées et les aumôniers pour leur service pastoral. J’étends mon salut à tous les militaires du monde, et je voudrais rappeler l’enseignement de l’Eglise à cet égard. Le Concile Vatican ii indique: «Quant à ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire, qu’ils se considèrent eux aussi comme les serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples» (Const. past. Gaudium et spes, n. 79). Ce service armé doit être exercé uniquement en cas de légitime défense, jamais pour imposer sa domination sur les autres pays, toujours en observant les conventions internationales en matière de conflits (cf. ibid.) et, surtout, dans le respect sacré de la vie et de la création.
Frères et sœurs, prions pour la paix en Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël et dans tout le Moyen-Orient, en Birmanie, dans le Kivu, au Soudan. Que le fracas des armes se taise partout et que le cri des peuples, qui demandent la paix, soit écouté.
Confions notre prière à l’intercession de la Vierge Marie, Reine de la Paix.
Angelus Domini…
Message au Président de la République française S.E. M. Emmanuel Macron
à l’occasion du «Sommet pour l’Action
sur l’Intelligence artificielle»
(Paris, 10-11 février 2025)
Un instrument pour lutter
contre la pauvreté et protéger
les cultures et les langues locales
Monsieur le Président, Excellences, distingués participants,
j’ai appris votre louable initiative de tenir un Sommet sur l’intelligence artificielle, à Paris, les 10 et 11 février 2025. J’ai su que vous, Monsieur le Président, vous avez voulu consacrer ce sommet à l’action sur l’intelligence artificielle.
Au cours de notre rencontre, dans les Pouilles, dans le contexte du G7, j’avais eu l’occasion de souligner l’urgence de «garantir et protéger un espace de contrôle significatif de l’être humain sur le processus de choix des programmes d’intelligence artificielle». Je pensais en effet que sans ces mécanismes, l’intelligence artificielle, bien qu’étant un nouvel outil «fascinant», pourrait montrer son côté le plus «redoutable», en devenant une menace pour la dignité humaine (cf. Discours à la session du G7 sur l’intelligence artificielle).
Je me félicite donc des efforts entrepris, avec courage et détermination, pour entamer un parcours politique dans le sens de la protection de l’humanité contre une utilisation de l’intelligence artificielle «qui limite la vision du monde à des réalités exprimables en chiffres et enfermées dans des catégories préconçues, évinçant l’apport d’autres formes de vérité et en imposant des modèles anthropologiques, socio-économiques et culturels uniformes» (ibid.); et du fait qu’au Sommet de Paris, vous ayez voulu impliquer le plus grand nombre d’acteurs et d’experts dans une réflexion qui vise à produire des résultats concrets.
Dans ma dernière Lettre encyclique Dilexit nos, j’ai voulu distinguer la catégorie des algorithmes de celle du «cœur», le concept-clé défendu par le grand philosophe et scientifique Blaise Pascal, auquel j’ai consacré une Lettre apostolique à l’occasion du quatrième anniversaire de sa naissance (cf. Sublimitas et miseria hominis, 2023), afin de souligner que, si les algorithmes peuvent être utilisés pour tromper l’homme, le «cœur», entendu comme le siège des sentiments les plus intimes et les plus vrais, ne pourra jamais le tromper (cf. Lettre encyclique, Dilexit nos, nn. 14.20).
A tous ceux qui participeront au Sommet de Paris, je demande de ne pas oublier que c’est seulement du «cœur» de l’homme que provient le sens de son existence (cf. Blaise Pascal, Pensées). Je demande d’accepter comme axiomatique, le principe exprimé si élégamment par un autre grand philosophe français, Jacques Maritain: «L’amour vaut plus que l’intelligence» (Jacques Maritain, Réflexions sur l’intelligence, 1938).
Vos efforts, chers participants, sont un exemple brillant d’une saine politique qui veut inscrire les nouveautés technologiques dans un projet visant au bien commun pour «ouvrir le chemin à des opportunités différentes qui n’impliquent pas d’interrompre la créativité de l’homme et son rêve de progrès, mais de canaliser cette énergie de façon nouvelle» (Laudato si’, n. 191).
L’intelligence artificielle, j’en suis convaincu, peut devenir un puissant outil pour les scientifiques et les experts qui cherchent ensemble des solutions innovantes et créatives en faveur de l’éco-durabilité de notre planète. Sans ignorer que la consommation d’énergie associée au fonctionnement des infrastructures de l’intelligence artificielle est en soi hautement consommatrice d’énergie.
Déjà dans mon Message pour la Journée mondiale de la paix 2024 consacré à l’intelligence artificielle, j’ai souligné que «dans les débats sur la réglementation de l’intelligence artificielle, il faudrait tenir compte de la voix de toutes les parties prenantes, y compris les pauvres, les marginalisés et d’autres qui restent souvent ignorés dans les processus décisionnels mondiaux» (Message pour la 57e Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2024). Dans cette perspective, je souhaite que le sommet de Paris avance pour qu’une plate-forme d’intérêt public sur l’intelligence artificielle soit créée; et pour que chaque nation puisse trouver dans l’intelligence artificielle un instrument, d’une part, de développement et de lutte contre la pauvreté, et d’autre part, de protection des cultures et des langues locales. Ce n’est qu’ainsi que tous les peuples de la terre pourront contribuer à la création de données, qui seront utilisées par l’intelligence artificielle, représentant la véritable diversité et richesse qui caractérise l’humanité tout entière.
Cette année, le Dicastère pour la doctrine de la foi et le Dicastère pour la culture et l’éducation ont travaillé ensemble sur une Note sur «Intelligence artificielle et intelligence humaine». Dans ce document, publié le 28 janvier dernier, ont été examinées plusieurs questions spécifiques relatives à l’intelligence artificielle que le sommet actuel est en train d’aborder et quelques autres qui me préoccupent plus particulièrement. A l’avenir, j’espère que les travaux des prochains Sommets qui devraient donner suite au présent, examineront plus en détail les effets sociaux de l’intelligence artificielle sur les relations humaines, sur l’information et sur l’éducation. La question fondamentale, cependant, reste et restera toujours anthropologique, à savoir: «si l’homme, comme homme» dans le contexte du progrès technologique «deviendra vraiment meilleur, c’est-à-dire plus mûr spirituellement, plus conscient de la dignité de son humanité. Plus responsable, plus ouvert aux autres, en particulier aux plus nécessiteux et aux plus faibles» (Lettre encyclique Redemptor hominis, n. 15). Notre ultime défi est l’homme et restera toujours l’homme; ne l’oublions jamais. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous tous qui avez travaillé durant ce Sommet.
Du Vatican, le 7 février 2025
François
Lettre aux évêques
des Etats-Unis d’Amérique
Déporter des migrants porte atteinte à la dignité humaine
Chers frères dans l’épiscopat,
je vous écris aujourd’hui pour vous adresser quelques paroles en ce moment délicat que vous vivez en tant que pasteurs du Peuple de Dieu pèlerin aux Etats-Unis d’Amérique.
1. Le voyage de l’esclavage à la liberté accompli par le peuple d’Israël, tel que nous le rapporte le Livre de l’Exode, nous invite à considérer la réalité de notre temps, si clairement marquée par le phénomène de la migration, en tant que moment décisif dans l’histoire pour réaffirmer non seulement notre foi en un Dieu qui est toujours proche, incarné, migrant et réfugié, mais également la dignité infinie et transcendante de toute personne humaine1.
Ces paroles par lesquelles je commence ne sont pas des paroles arbitraires. Un examen même sommaire de la doctrine sociale de l’Eglise montre avec évidence que Jésus Christ est le véritable Emmanuel (cf. Mt 1, 23); il a lui aussi fait l’expérience difficile d’être expulsé de son pays à cause d’un danger imminent pour sa vie, et l’expérience de devoir trouver refuge dans une société et une culture étrangère à la sienne. En devenant homme, le Fils de Dieu a également choisi de vivre le drame de l’immigration. Je voudrais rappeler, entre autres, les paroles par lesquelles le Pape Pie xii a commencé sa Constitution apostolique sur le soin pastoral des migrants, qui est considérée comme la «Magna Carta» de la doctrine de l’Eglise sur la migration:
«La famille de Nazareth en exil, Jésus, Marie et Joseph émigrés et réfugiés en Egypte pour échapper à la colère d’un roi impie, sont le modèle, l’exemple et le soutien de tous les émigrés et pèlerins de tous les temps et de tous les pays, de tous les réfugiés de toute condition qui, poussés par la persécution ou par le besoin, se voient contraints d’abandonner leur patrie, leur famille bien-aimée et les personnes qui leurs sont chères, et se rendre en terre étrangère»2.
3. De même, Jésus Christ, en aimant chacun d’un amour universel, nous éduque à la reconnaissance permanente de la dignité de tout être humain, sans exception. En effet, lorsque nous parlons d’«infinie et transcendante dignité», nous voulons souligner que la valeur la plus importante que possède la personne humaine dépasse et soutient toute autre considération juridique qui peut être faite pour réguler la vie en société. Ainsi, tous les fidèles chrétiens et les personnes de bonne volonté sont appelés à considérer la légitimité des normes et des politiques publiques à la lumière de la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux, et non l’inverse.
4. Je suis de près la crise importante qui a lieu aux Etats-Unis avec le lancement d’un programme de déportations de masse. Une conscience formée avec droiture ne peut manquer d’exprimer un jugement critique et exprimer son désaccord avec toute mesure qui identifie de façon tacite ou explicite le statut illégal de certains migrants avec la criminalité. Dans le même temps, il faut reconnaître le droit d’un pays à se défendre et à protéger les communautés de ceux qui ont commis des crimes violents ou graves lors de leur séjour dans le pays ou avant leur arrivée. Quoi qu’il en soit, déporter des personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur terre pour des raisons d’extrême pauvreté, d’insécurité, d’exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l’environnement, porte atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes, et de familles tout entières, et les rend particulièrement vulnérables et sans défen-se.
5. Il ne s’agit pas d’une question de moindre importance: un authentique état de droit se vérifie précisément dans le traitement digne que toutes les personnes méritent, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisés. Le véritable bien commun est promu lorsque la société et le gouvernement, avec créativité et dans le strict respect des droits de tous — comme je l’ai affirmé en de nombreuses occasions — accueille, protège, promeut et intègre les plus fragiles, sans défense et vulnérables. Cela n’empêche pas le développement d’une politique qui réglemente une migration ordonnée et légale. Toutefois, ce développement ne peut se réaliser à travers le privilège de quelques-uns et le sacrifice d’autres. Ce qui est construit sur le fondement de la force, et non sur la vérité de la dignité égale de tout être humain, commence mal et finira mal.
6. Les chrétiens savent très bien que ce n’est qu’en affirmant l’infinie dignité de tous que notre identité de personnes et de communautés atteint sa maturité. L’amour chrétien n’est pas une expan-sion concentrique d’intérêts qui s’étendent peu à peu à d’autres personnes et d’autres groupes. En d’autres termes, la personne humaine n’est pas un simple individu, relativement expansif, ayant des sentiments philanthropiques! La personne humaine est un sujet doté de dignité qui, à travers la relation constitutive avec tous, en particulier les plus pauvres, peut progressivement mûrir dans son identité et sa vocation. Le véritable ordo amoris qui doit être promu est celui que nous découvrons en méditant constamment sur la parabole du «Bon Samaritain» (cf. Lc 10, 25-37), c’est-à-dire en méditant sur l’amour qui construit une fraternité ouverte à tous, sans exception3.
7. Mais la préoccupation pour l’identité personnelle, communautaire ou nationale, au-delà de ces considérations, peut facilement introduire un critère idéologique qui déforme la vie sociale et impose la volonté du plus fort comme critère de vérité.
8. Chers frères évêques des Etats-Unis, je reconnais vos efforts précieux, alors que vous travaillez étroitement avec les migrants et les réfugiés, en proclamant Jésus Christ et en promouvant les droits humains fondamentaux. Dieu récompensera abondamment tout ce que vous faites pour la protection et la défense de ceux qui sont considérés comme moins précieux, moins importants ou moins humains!
9. J’exhorte tous les fidèles de l’Eglise catholique, ainsi que tous les hommes et les femmes de bonne volonté, à ne pas céder aux discours qui discriminent et causent des souffrances inutiles à nos frères et sœurs migrants et réfugiés. Nous sommes appelés avec charité et clarté à vivre dans la solidarité et la fraternité, à jeter des ponts qui nous rapprochent toujours plus, à rejeter les murs d’ignominie et à apprendre à donner nos vies comme Jésus Christ a donné la sienne pour le salut de tous.
10. Demandons à Notre Dame de Guadalupe de protéger les personnes et les familles qui vivent dans la peur et la douleur à cause de la migration et/ou de la déportation. Puisse la «Virgen morena», qui a su réconcilier les peuples lorsqu’ils étaient ennemis, nous accorder de nous retrouver comme frères et sœurs, dans son étreinte, et d’accomplir ainsi un pas en avant dans la construction d’une société plus fraternelle, inclusive et respectueuse de la dignité de tous.
Fraternellement,
Du Vatican, le 10 février 2025
François
1 Cf. Dicastère pour la doctrine de la foi, Déclaration Dignitas infinita sur la dignité humaine, 2 avril 2024.
2 Pie xii, Constitution apostolique Exsul Familia, 1er août 1952: «Exsul Familia Nazarethana Iesus, Maria, Ioseph, cum ad Aegyptum emigrans tum in Aegypto profuga impii regis iram aufugiens, typus, exemplar et praesidium exstat omnium quorumlibet temporum et locorum emigrantium, peregrinorum ac profugorum omne genus, qui, vel metu persecutionum vel egestate compulsi, patrium locum suavesque parentes et propinquos ac dulces amicos derelinquere coguntur et aliena petere».
3 Cf. François, Lettre encyclique Fratelli tutti, 3 octobre 2020.
Audience générale
Salle Paul vi, 12 février 2025
Le Seigneur ne bouleverse pas
le monde, mais l’illumine
et le renouvelle
Chers frères et sœurs, bonjour!
Dans notre parcours jubilaire de catéchèse sur Jésus, qui est notre espérance, nous nous arrêtons aujourd’hui sur l’événement de sa naissance à -Bethléem.
[Et maintenant je me permets de demander au prêtre, au lecteur, de continuer de lire, car avec ma bronchite, cela ne m’est pas encore possible. J’espère que je pourrai le faire la prochaine fois]
Le Fils de Dieu entre dans l’histoire en devenant notre compagnon de voyage et il commence à voyager étant encore dans le sein de sa mère. L’évangéliste Luc raconte que, dès sa conception, il est parti de Nazareth pour se rendre dans la maison de Zacharie et d’Elisabeth, puis, une fois la grossesse achevée, de Nazareth à Bethléem pour le recensement. Marie et Joseph furent contraints de se rendre dans la ville du roi David, où Joseph était également né. Le Messie tant attendu, le Fils du Dieu Très-Haut, se laisse recenser, c’est-à-dire compter et enregistrer, comme n’importe quel citoyen. Il se soumet au décret d’un empereur, César Auguste, qui se croit le maître de toute la terre.
Luc situe la naissance de Jésus dans «un temps exactement datable» et dans «un cadre géographique exactement indiqué», de sorte que «l’universel et le concret se touchent» (Benoît xvi, L’enfance de Jésus, Editions Flammarion, 2017). Dieu, qui vient dans l’histoire, ne bouleverse pas les structures du monde, mais veut les éclairer et les recréer de l’intérieur.
Bethléem signifie «maison du pain». C’est là que les jours de l’accouchement se sont passés pour Marie et que Jésus est né, pain descendu du ciel pour rassasier la faim du monde (cf. Jn 6, 51). L’ange Gabriel avait annoncé la naissance du Roi messianique sous le signe de la grandeur: «Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin» (Lc 1, 32-33).
Cependant, Jésus naît d’une manière totalement inédite pour un roi. En effet, «pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune» (Lc 2, 6-7). Le Fils de Dieu ne naît pas dans un palais royal, mais à l’arrière d’une maison, dans l’espace où se trouvent les animaux.
Luc nous montre ainsi que Dieu ne vient pas dans le monde avec des proclamations retentissantes, qu’il ne se manifeste pas dans la clameur, mais qu’il commence son chemin dans l’humilité. Et qui sont les premiers témoins de cet événement? Ce sont des bergers: des hommes peu cultivés, malodorants à cause du contact permanent avec les animaux, vivant en marge de la société. Pourtant, ils exercent le métier par lequel Dieu lui-même se fait connaître à son peuple (cf. Gn 48, 15; 49, 24; Ps 23, 1; 80, 2; Is 40, 11). Dieu les choisit pour être les destinataires de la plus merveilleuse nouvelle qui ait jamais retenti dans l’histoire: «Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple: Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire» (Lc 2, 10-12).
L’endroit où il faut aller pour rencontrer le Messie est une crèche. Il se trouve en effet qu’après tant d’attente, «le Sauveur du monde, celui pour qui tout a été créé (cf. Col 1, 16), n’a pas de place» (Benoit xvi, L’Enfance de Jésus, Editions Flammarion, 2017). Les bergers apprennent ainsi que dans un lieu très humble, réservé aux animaux, naît pour eux le Messie tant attendu, pour être leur Sauveur, leur Pasteur. Cette nouvelle ouvre leur cœur à l’émerveillement, à la -louange et à l’annonce joyeuse. «Contrairement à tant de personnes occupées à faire mille choses, les bergers deviennent les premiers témoins de l’essentiel, c’est-à-dire du salut qui est donné. Ce sont les plus humbles et les plus pauvres qui savent accueillir l’événement de l’Incarnation» (Lett. ap. Admirabile signum, 5).
Frères et sœurs, demandons aussi la grâce d’être, comme les bergers, capables de stupeur et de louange devant Dieu, et capables de conserver ce qu’Il nous a confié: nos talents, nos charismes, notre vocation et les personnes qu’Il place à nos côtés. Demandons au Seigneur de savoir discerner dans la faiblesse la force extraordinaire de l’Enfant-Dieu, qui vient renouveler le monde et transformer nos vies avec son dessein plein d’espérance pour l’humanité toute entière.
A l’issue de l’Audience générale, le Pape a lancé les appels suivants:
J’adresse une cordiale bienvenue aux pèlerins.
Et je pense à tous les pays qui sont en guerre. Sœurs, frères, prions pour la paix. Faisons tout notre possible pour la paix. N’oublions pas que la guerre est une défaite. Toujours. Nous ne sommes pas nés pour tuer, mais pour faire grandir les peuples. Puissent des voies de paix être trouvées. S’il vous plaît, dans votre prière quotidienne, demandez la paix. L’Ukraine martyrisée… combien souffre-t-elle. Ensuite, pensez à la Palestine, à Israël, à la Birmanie, au Kivu du Nord, au Soudan du Sud. De nombreux pays en guerre. S’il vous plaît, prions pour la paix. Faisons pénitence pour la paix.
Après-demain, nous célébrerons la fête des saints Cyrille et Méthode, premiers diffuseurs de la foi parmi les peuples slaves. Que leur témoignage vous aide à être, vous aussi, des apôtres de l’Evangile, ferment du renouvellement dans la vie personnelle, familiale et sociale.
Je vous donne à tous ma bénédiction!
Parmi les pèlerins ayant assisté à l’Audience générale se trouvaient les groupes francophones suivants:
De France: Pèlerinage du diocèse de Saint-Etienne, avec S.Exc. Mgr Sylvain Bataille; pèlerinage du diocèse de Laval, avec S.Exc. Mgr Matthieu Dupont; groupe du diocèse aux Armées françaises, de Paris; groupe de pèlerins du diocèse de Bourges; paroisse Saint-Crépin-les-Vignes, de Château-Thierry; paroisse du Sacré-Coeur, de Strasbourg; paroisse d’Oswald, d’Ostwald; paroisse de Nay, d’Asson; lycée Notre-Dame de la Galaure, de Châteauneuf-de-Galaure; lycée Saint-Paul, de Lille; collège Notre-Dame de France, de Paris; Institution Saint-Thomas d’Aquin, de Pontcalec; Ensemble scolaire Saint-Joseph et Saint-Jean, de Lectoure; groupe de pèlerins du diocèse d’Amiens; groupe d’étudiants de Paris; Paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle, de Rennes.
De la Côte d’Ivoire: Groupe de pèlerins du diocèse d’Abidjan.
Je salue cordialement les groupes de pèlerins de langue française, en particulier les diocèses d’Abidjan, de Saint-Etienne, de Bourges, d’Amiens, de Laval, le diocèse aux Armées ainsi que les différents établissements scolaires.
Demandons au Seigneur de garder nos cœurs humbles et ouverts pour entendre sa parole et le cri de nos frères, et pour savoir reconnaître sa présence dans la faiblesse et les blessures du monde. Que Dieu vous bénisse.
Homélie de la Messe
pour le Jubilé des artistes
Basilique Saint-Pierre, 16 février 2025
Protecteurs de la beauté
pour éduquer à l’espérance
Homélie préparée par le Pape et lue par le cardinal José Tolentino de Mendonça:
Dans l’Evangile que nous venons d’entendre, Jésus proclame les Béatitudes devant ses disciples et une multitude de personnes. Nous les avons entendues tant de fois et pourtant elles ne cessent de nous surprendre: «Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez» (Lc 6, 20-21). Ces paroles renversent la logique du monde et nous invitent à regarder la réalité avec des yeux nouveaux, avec le regard de Dieu, qui voit au-delà des apparences et reconnaît la beauté, même dans la fragilité et la souffrance.
La seconde partie contient des paroles dures et d’avertissement: «Quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez!» (Lc 6, 24-25). Le contraste entre «heureux, vous» et «quel malheur pour vous» nous rappelle l’importance de discerner où nous plaçons notre sécurité.
Vous, artistes et hommes et femmes de culture, vous êtes appelés à être les témoins de la vision révolutionnaire des Béatitudes. Votre mission n’est pas seulement de créer de la beauté, mais de révéler la vérité, la bonté et la beauté enfouies dans les plis de l’histoire, de donner une voix aux sans-voix, de transformer la douleur en espérance.
Nous vivons une époque de crise complexe, économique et sociale, mais avant tout de crise de l’âme, de crise de sens. Nous nous posons la question du temps et de la direction. Sommes-nous des pèlerins ou des vagabonds? Marchons-nous avec un but ou sommes-nous perdus dans l’errance? L’artiste est celui ou celle qui a la tâche d’aider l’humanité à ne pas perdre sa direction, à ne pas perdre l’horizon de l’espérance.
Mais attention: il ne s’agit pas d’une espérance facile, superficielle, désincarnée. Non! La véritable espérance est étroitement liée au drame de l’existence humaine. Elle n’est pas un refuge confortable, mais un feu qui brûle et illumine, comme la Parole de Dieu. C’est pourquoi l’art authentique est toujours une rencontre avec le mystère, avec la beauté qui nous dépasse, avec la douleur qui nous interroge, avec la vérité qui nous appelle. Sinon, «malheur»! Le Seigneur est sévère dans son appel.
Comme l’écrit le poète Gerard Manley Hopkins, «le monde est chargé de la grandeur de Dieu. / Il s’éteindra, comme s’il s’agissait d’une feuille d’aluminium secouée». C’est la mission de l’artiste: découvrir et révéler cette grandeur cachée, la faire percevoir à nos yeux et à nos cœurs. Le même poète entendait aussi dans le monde un «écho de plomb» et un «écho d’or». L’artiste est sensible à ces résonances et, par son œuvre, il accomplit un discernement et aide les autres à discerner parmi les différents échos des événements de ce monde. Les hommes et les femmes de culture sont appelés à évaluer ces échos, à nous les expliquer et à éclairer le chemin sur lequel ils nous conduisent: si ce sont des chants de sirènes qui séduisent ou des appels de notre humanité la plus vraie. Il vous faut une sagesse pour distinguer ce qui est comme «la paille balayée par le vent» de ce qui est solide «comme un arbre planté près d’un ruisseau» (Ps 1, 3-4).
Chers artistes, je vois en vous des gardiens de la beauté qui savent se pencher sur les blessures du monde, qui savent écouter le cri des pauvres, des souffrants, des blessés, des prisonniers, des persécutés, des réfugiés. Je vois en vous des gardiens des Béatitudes! Nous vivons à une époque où de nouveaux murs se dressent, où les différences deviennent un prétexte pour la division plutôt qu’une occasion d’enrichissement mutuel. Mais vous, hommes et femmes de culture, vous êtes appelés à construire des ponts, à créer des espaces de rencontre et de dialogue, à éclairer les esprits et à réchauffer les cœurs.
Quelqu’un pourrait dire: «A quoi sert l’art dans un monde blessé? N’y a-t-il pas des choses plus urgentes, plus concrètes, plus nécessaires?». L’art n’est pas un luxe, mais une nécessité de l’esprit. Il n’est pas une fuite, mais une responsabilité, un appel à l’action, un avertissement, un cri. Eduquer à la beauté, c’est éduquer à l’espérance. Et l’espérance ne se sépare jamais du drame de l’existence: elle traverse la lutte quotidienne, les difficultés de la vie, les défis de notre temps.
Dans l’Evangile que nous avons entendu aujourd’hui, Jésus proclame bienheureux les pauvres, les affligés, les doux, les persécutés. Il s’agit d’une logique inversée, d’une révolution de pers-pective. L’art est appelé à participer à cette révolution. Le monde a besoin d’artistes prophétiques, d’intellectuels courageux, de créateurs de culture.
Laissez-vous guider par l’Evangile des Béatitudes, et que votre art soit l’annonce d’un monde nouveau. Que votre poésie nous le montre! Ne cessez jamais de chercher, d’interroger, de risquer. Parce que le vrai art n’est jamais confortable, il offre la paix de l’inquiétude. Et rappelez-vous: l’espérance n’est pas une illusion; la beauté n’est pas une utopie; votre don n’est pas un hasard, c’est une vocation. Répondez avec générosité, avec passion, avec amour.
Angelus Domini
16 février 2025
L’art, langage universel qui peut faire taire tout cri de guerre
Texte de l’Angelus préparé par le Pape diffusé au terme de la Messe pour le jubilé des artistes:
Frères et sœurs, bon dimanche!
Aujourd’hui, au Vatican, nous avons célébré l’Eucharistie dédiée en particulier aux artistes venus de diverses parties du monde pour vivre les Journées jubilaires. Je remercie le Dicastère pour la culture et l’éducation pour la préparation de cet événement, qui nous rappelle l’importance de l’art comme langage universel qui diffuse la beauté et unit les peuples, en contribuant à apporter l’harmonie au monde et à faire taire tout cri de guerre.
Je voudrais saluer tous les artistes qui ont participé: j’aurais aimé être parmi vous mais, comme vous le savez, je suis à l’hôpital Gemelli parce que j’ai encore besoin d’être suivi pour ma bronchite.
J’adresse mes salutations à tous les pèlerins présents à Rome aujourd’hui.
J’invite tout le monde à continuer à prier pour la paix en Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël et dans tout le Moyen-Orient, en Birmanie, au Kivu et au Soudan.
Je vous remercie pour l’affection, la prière et la proximité avec lesquelles vous m’accompagnez ces jours-ci, tout comme je voudrais remercier les médecins et le personnel soignant de cet Hôpital pour leurs soins: ils font un travail très précieux et très fatigant, soutenons-les par la prière!
Et maintenant, confions-nous à Marie, la «pleine de grâce», pour qu’elle nous aide à être, comme elle, chanteurs et artisans de la beauté qui sauve le monde.
Audience générale
19 février 2025
Les étrangers sont
parmi les premiers à être invités
à rencontrer le Dieu enfant
Texte de la catéchèse pour l’Audience générale préparée par le Pape:
Chers frères et sœurs,
Dans les évangiles de l’enfance de Jésus, il y a un épisode propre au récit de Matthieu: la visite des Mages. Attirés par l’apparition d’une étoile qui, dans de nombreuses cultures, est le présage de la naissance de personnes exceptionnelles, des mages se mettent en route depuis l’Orient, sans connaître exactement leur but. Il s’agit des Mages, des personnes qui n’appartiennent pas au peuple de l’alliance. La dernière fois, nous avons parlé des bergers de Bethléem, marginalisés dans la société juive parce que considérés comme «impurs»; aujourd’hui, nous rencontrons une autre catégorie, les étrangers, qui viennent immédiatement rendre hommage au Fils de Dieu entré dans l’histoire avec une royauté entièrement inédite. Les Evangiles nous disent donc clairement que les pauvres et les étrangers sont parmi les premiers à être invités à rencontrer le dieu fait enfant, le Sauveur du monde.
Les Mages étaient considérés comme représentant à la fois les races primitives, générées par les trois fils de Noé, et les trois continents connus dans l’Antiquité: l’Asie, l’Afrique et l’Europe, -ainsi que les trois phases de la vie humaine: la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Au-delà de toute interprétation possible, ce sont des hommes qui ne restent pas immobiles mais qui, comme les grands appelés de l’histoire biblique, sentent l’invitation à bouger, à se mettre en route. Ce sont des hommes qui savent regarder au-delà d’eux-mêmes, qui savent regarder vers le haut.
L’attirance pour l’étoile apparue dans le ciel les met en marche vers le pays de Juda, jusqu’à Jérusalem, où ils rencontrent le roi Hérode. Leur ingénuité et leur confiance à demander des informations sur le nouveau-né roi des Juifs se heurte à la ruse d’Hérode qui, agité par la peur de perdre son trône, cherche immédiatement à en avoir le cœur net, en contactant les scribes et en leur demandant de mener l’enquête.
Le pouvoir du régnant terrestre montre ainsi toute sa faiblesse. Les experts connaissent les Ecritures et signalent au roi le lieu où, selon la prophétie de Michée, devait naître le chef et le pasteur du peuple d’Israël (Mi 5, 1): la petite -Bethléem et non la grande Jérusalem! En effet, comme le rappelle Paul aux Corinthiens, «ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort» (1 Co 1, 27).
Mais les scribes, qui savent identifier exactement le lieu de naissance du Messie, montrent le chemin aux autres, mais eux-mêmes ne bougent pas! Il ne suffit pas, en effet, de connaître les textes prophétiques pour se syntoniser sur les fréquences divines, il faut laisser son âme être scrutée et permettre à la Parole de Dieu de raviver le désir de chercher, d’allumer le désir de voir Dieu.
C’est alors qu’Hérode, en secret, comme le font les trompeurs et les violents, demande aux Mages le moment précis de l’apparition de l’étoile et les incite à poursuivre leur voyage et à revenir ensuite lui donner des nouvelles, pour que lui aussi puisse aller adorer le nouveau-né. Pour ceux qui sont attachés au pouvoir, Jésus n’est pas une espérance à accueillir, mais une menace à éliminer!
Lorsque les Mages se remettent en route, l’étoile réapparaît et les conduit jusqu’à Jésus, signe que la création et la parole prophétique représentent l’alphabet avec lequel Dieu parle et se laisse trouver. La vue de l’étoile suscite chez ces hommes une joie incontrôlable, car l’Esprit Saint, qui anime le cœur de quiconque cherche sincèrement Dieu, le remplit également de joie. Entrés dans la maison, les Mages se prosternent, adorent Jésus et lui offrent des dons précieux, dignes d’un roi, dignes de Dieu. Pourquoi? Que voient-ils? Un auteur antique écrit: ils voient «un humble petit corps à travers lequel le Verbe s’est incarné; mais la gloire de la divinité ne leur est pas cachée. On voit un enfant; mais ils adorent Dieu» (Chromace d’Aquilée, Commentaire à l’Evangile de Matthieu, 5, 1). Les Mages deviennent ainsi les premiers croyants parmi tous les païens, image de l’Eglise rassemblée de toutes les langues et de toutes les nations.
Chers frères et sœurs, mettons-nous aussi à l’école des Mages, de ces «pèlerins de l’espérance» qui, avec beaucoup de courage, ont tourné leurs pas, leur cœur et leurs biens vers Celui qui est l’espérance non seulement d’Israël, mais de toutes les nations. Apprenons à adorer Dieu dans sa petitesse, dans sa royauté qui n’écrase pas mais rend libres et capables de servir avec dignité. Et offrons-lui les dons les plus beaux pour lui exprimer notre foi et notre amour.
Homélie lors de la Messe
pour le Jubilé des Diacres
Basilique Saint-Pierre, 23 février 2025
Un pont entre l’autel et la rue pour bâtir le pardon
et la communion
Homélie préparée par le Pape et lue par Monseigneur Fisichella:
Le message des Lectures que nous avons écoutées pourrait se résumer en un mot: gratuité. Un terme qui vous est certainement cher, à vous diacres, réunis ici pour la célébration du Jubilé. Réfléchissons donc à cette dimension fondamentale de la vie chrétienne et de votre ministère, en particulier sous trois aspects: le pardon, le service désintéressé et la communion.
Premièrement: le pardon. La proclamation du pardon est une tâche essentielle du diacre. En effet, c’est un élément indispensable pour tout cheminement ecclésial et une condition pour toute coexistence humaine. Jésus nous en montre la nécessité et la portée lorsqu’il dit: «Aimez vos ennemis» (Lc 6, 27). Et c’est exactement ainsi: pour grandir ensemble, en partageant les lumières et les ombres, les succès et les échecs des uns et des autres, il est nécessaire de savoir pardonner et demander pardon, en rétablissant les relations et en n’excluant pas de notre amour même ceux qui nous frappent et nous trahissent. Un monde où il n’y a que de la haine pour les adversaires est un monde sans espérance, sans avenir, destiné à être déchiré par des guerres, des divisions et des vengeances sans fin, comme nous le voyons malheureusement encore aujourd’hui, à tant de niveaux et dans diverses parties du monde. Pardonner signifie donc préparer une maison accueillante et sûre pour l’avenir en nous et dans nos communautés. Et le diacre, personnellement investi d’un ministère qui le conduit aux périphéries du monde, s’engage à voir — et à enseigner aux autres à voir — en tous, même en ceux qui se trompent et font souffrir, une sœur et un frère blessés dans l’âme, et donc ayant plus besoin que quiconque de réconciliation, d’accompagnement et d’aide.
La première Lecture nous parle de cette ouverture du cœur, en nous présentant l’amour loyal et généreux de David pour Saül, son roi, mais aussi son persécuteur (cf. 1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23). Dans un autre contexte, la mort exemplaire du diacre Etienne, qui tombe sous les coups de pierres et pardonne à ses lapidateurs, nous en parle aussi (cf. Ac 7, 60). Mais nous la voyons surtout en Jésus, modèle de toute diaconie, qui sur la croix, «se vidant» de lui-même jusqu’à donner sa vie pour nous (cf. Ph 2, 7), prie pour ceux qui le crucifient et ouvre au bon larron les portes du paradis (cf. Lc 23, 34.43).
Et nous arrivons au deuxième point: le service désintéressé. Le Seigneur, dans l’Evangile, le décrit dans une phrase aussi simple que claire: «faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour» (Lc 6, 35). Quelques mots qui portent en eux le bon parfum de l’amitié. Tout d’abord celle de Dieu pour nous, mais aussi la nôtre. Pour le diacre, cette attitude n’est pas un aspect accessoire de son agir, mais une dimension substantielle de son être. Il se consacre en effet à être, dans son ministère, «sculpteur» et «peintre» du visage miséricordieux du Père, témoin du mystère de Dieu-Trinité.
Dans de nombreux passages de l’Evangile, Jésus parle de lui sous cet angle. Il le fait avec Philippe, au Cénacle, peu après avoir lavé les pieds des Douze, en disant: «Celui qui m’a vu a vu le Père» (Jn 14, 9). De même, lorsqu’il institue l’Eucharistie, il affirme: «je suis au milieu de vous comme celui qui sert» (Lc 22, 27). Mais déjà auparavant, sur la route de Jérusalem, alors que ses disciples discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand, il leur avait expliqué que «le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude» (Mc 10, 45).
Frères diacres, le travail gratuit que vous accomplissez, expression de votre consécration à la charité du Christ, est pour vous la première annonce de la Parole, source de confiance et de joie pour ceux qui vous rencontrent. Accompagnez-le le plus possible avec le sourire, sans vous plaindre ni chercher la reconnaissance, en vous soutenant mutuellement, même dans vos relations avec les évêques et les prêtres, «comme expression d’une Eglise engagée à grandir dans le service du -Royaume avec la valorisation de tous les degrés du ministère ordonné» (c.e.i., I Diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme, 1993, p. 55). Votre action concertée et généreuse sera ainsi un pont qui reliera l’Autel à la rue, l’Eucharistie à la vie quotidienne des gens. La charité sera votre plus belle liturgie et la liturgie votre plus humble service.
Et nous arrivons au dernier point: la gratuité comme source de communion. Donner sans rien demander en retour unit, crée des liens, parce que cela exprime et nourrit une communauté qui n’a d’autre fin que le don de soi et le bien des personnes. Saint Laurent, votre patron, à qui ses accusateurs demandaient de leur remettre les trésors de l’Eglise, leur montra les pauvres et leur dit: «Voilà nos trésors!». C’est ainsi que l’on construit la communion: en disant à son frère et à sa sœur, avec des paroles, mais surtout avec des actes, personnellement et en tant que communauté: «tu es important pour nous», «nous t’aimons», «nous voulons que tu fasses partie de notre cheminement et de notre vie». C’est ce que vous faites: des maris, des pères et des grands-parents prêts, dans le service, à agrandir vos familles pour ceux qui sont dans le besoin, là où vous vivez.
Ainsi, votre mission qui vous prend de la société pour vous y réinsérer et en faire un lieu toujours plus accueillant et ouvert à tous est une des plus belles expressions d’une Eglise synodale et «en sortie».
Bientôt, certains d’entre vous, en recevant le sacrement de l’Ordre, «descendront» les marches du ministère. C’est à dessein que je dis et souligne qu’«ils descendront», et non qu’«ils monteront», parce qu’avec l’Ordination, on ne monte pas, mais on descend, on se fait petit, on s’abaisse, on se dépouille. Pour reprendre les mots de saint Paul, on abandonne, dans le service, «l’homme de la terre», et on revêt, dans la charité, «l’homme du ciel» (cf. 1 Co 15, 45-49).
Nous méditons tous sur ce que nous allons faire, tout en nous confiant à la Vierge Marie, servante du Seigneur, et à saint Laurent, votre patron. Qu’ils nous aident à vivre notre ministère avec un cœur humble et plein d’amour, et à être, dans la gratuité, des apôtres de pardon, des serviteurs désintéressés de nos frères et des constructeurs de communion.
Angelus Domini
23 février 2025
En Ukraine, une guerre honteuse pour l’ensemble de l’humanité
Texte de l’Angelus préparé par le Pape et diffusé au terme de la Messe pour le Jubilé des diacres:
Frères et sœurs, bon dimanche!
Ce matin, dans la basilique Saint-Pierre, l’Eucharistie a été célébrée avec l’ordination de certains candidats au diaconat. Je les salue, ainsi que les participants au Jubilé des diacres qui s’est déroulé ces jours-ci au Vatican, et je remercie les Dicastères pour le clergé et pour l’évangélisation pour la préparation de cet événement.
Chers frères diacres, vous vous consacrez à l’annonce de la Parole et au service de la charité; vous exercez votre ministère dans l’Eglise avec des paroles et des actes, en apportant à tous l’amour et la miséricorde de Dieu. Je vous exhorte à poursuivre votre apostolat avec joie et — comme le suggère l’Evangile d’aujourd’hui — à être le signe d’un amour qui accueille tout le monde, qui transforme le mal en bien et qui engendre un monde fraternel. N’ayez pas peur de risquer l’amour!
Pour ma part, je poursuis avec confiance mon hospitalisation à l’hôpital Gemelli, en suivant les traitements nécessaires; et le repos fait aussi partie de la thérapie! Je remercie sincèrement les médecins et le personnel soignant de cet hôpital pour les soins qu’ils me prodiguent et pour le dévouement avec lequel ils accomplissent leur service auprès des malades.
Demain sera le troisième anniversaire de la guerre à grande échelle contre l’Ukraine: un anniversaire douloureux et honteux pour l’ensemble de l’humanité! Tout en renouvelant ma proximité avec le peuple ukrainien martyrisé, je vous invite à vous souvenir des victimes de tous les conflits armés et à prier pour le don de la paix en Palestine, en Israël et dans tout le Moyen-Orient, en Birmanie, au Kivu et au Soudan.
Ces jours-ci, j’ai reçu de nombreux messages d’affection et j’ai été particulièrement touché par les lettres et les dessins des enfants. Merci pour cette proximité et pour les prières de réconfort que j’ai reçues du monde entier!
Je confie tout le monde à l’intercession de Marie et vous demande de prier pour moi.
Message du Pape François
pour le Carême 2025
Marchons ensemble
dans l’espérance
Chers frères et sœurs,
avec le signe pénitentiel des cendres sur la tête, nous commençons le pèlerinage annuel du Saint Carême dans la foi et dans l’espérance. L’Eglise, mère et maîtresse, nous invite à préparer nos cœurs et à nous ouvrir à la grâce de Dieu pour que nous puissions célébrer dans la joie le triomphe pascal du Christ-Seigneur, sur le péché et sur la mort. Saint Paul le proclame: «La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon?» (1 Co 15, 54-55). En effet, Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le centre de notre foi et le garant de la grande promesse du Père qu’est la vie éternelle déjà réalisée en son Fils bien-aimé (cf. Jn 10, 28; 17, 3)1.
Je voudrais proposer à l’occasion de ce Carême, enrichi par la grâce de l’année jubilaire, quelques réflexions sur ce que signifie marcher ensemble dans l’espérance, et découvrir les appels à la conversion que la miséricorde de Dieu adresse à tous, en tant qu’individus comme en tant que communautés.
Tout d’abord, marcher. La devise du Jubilé, «pèlerins de l’espérance», nous rappelle le long voyage du peuple d’Israël vers la Terre promise, raconté dans le livre de l’Exode: une marche difficile de l’esclavage à la liberté, voulue et guidée par le Seigneur qui aime son peuple et lui est toujours fidèle. Et nous ne pouvons pas évoquer l’exode biblique sans penser à tant de frères et sœurs qui, aujourd’hui, fuient des situations de misère et de violence, partant à la recherche d’une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs êtres chers. Un premier appel à la conversion apparaît ici car, dans la vie, nous sommes tous des pèlerins. Chacun peut se demander: comment est-ce que je me laisse interpeller par cette condition? Suis-je vraiment en chemin ou plutôt paralysé, statique, dans la peur et manquant d’espérance, ou bien encore installé dans ma zone de confort? Est-ce que je cherche des chemins de libération des situations de péché et de manque de dignité? Ce serait un bon exercice de Carême que de nous confronter à la réalité concrète d’un migrant ou d’un pèlerin, et de nous laisser toucher de manière à découvrir ce que Dieu nous demande pour être de meilleurs voyageurs vers la maison du Père. Ce serait un bon «test» pour le marcheur.
En second lieu, faisons ce chemin ensemble. Marcher ensemble, être synodal, telle est la vocation de l’Eglise2. Les chrétiens sont appelés à faire route ensemble, jamais comme des voyageurs solitaires. L’Esprit Saint nous pousse à sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu et vers nos frères et sœurs, et à ne jamais nous refermer sur nous-mêmes3. Marcher ensemble c’est être des tisseurs d’unité à partir de notre commune dignité d’enfants de Dieu (cf. Ga 3, 26-28); c’est avancer côte à côte, sans piétiner ni dominer l’autre, sans nourrir d’envies ni d’hypocrisies, sans laisser quiconque à la traîne ou se sentir exclu. Allons dans la même direction, vers le même but, en nous écoutant les uns les autres avec amour et patience.
En ce Carême, Dieu nous demande de vérifier si dans notre vie, dans nos familles, dans les lieux où nous travaillons, dans les communautés paroissiales ou religieuses, nous sommes capables de cheminer avec les autres, d’écouter, de dépasser la tentation de nous ancrer dans notre autoréférentialité et de nous préoccuper seulement de nos propres besoins. Demandons-nous devant le Seigneur si nous sommes capables de travailler ensemble, évêques, prêtres, personnes consacrées et laïcs, au service du Royaume de Dieu; si nous avons une attitude d’accueil, avec des gestes concrets envers ceux qui nous approchent et ceux qui sont loin; si nous faisons en sorte que les personnes se sentent faire partie intégrante de la communauté ou si nous les maintenons en marge4. Ceci est un deuxième appel: la conversion à la synodalité.
Troisièmement, faisons ce chemin ensemble dans l’espérance d’une promesse. Que l’espérance qui ne déçoit pas (cf. Rm 5, 5), le message central du Jubilé5, soit pour nous l’horizon du chemin de Carême vers la victoire de Pâques. Comme nous l’a enseigné le Pape Benoît xvi dans l’Encyclique Spe salvi: «L’être humain a besoin de l’amour inconditionnel. Il a besoin de la certitude qui lui fait dire: “Ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ” (Rm 8, 38-39)»6. Jésus, notre amour et notre espérance, est ressuscité7, il vit et règne glorieusement. La mort a été transformée en victoire, et c’est là que réside la foi et la grande espérance des chrétiens: la résurrection du Christ!
Et voici le troisième appel à la conversion: celui de l’espérance, de la confiance en Dieu et en sa grande promesse, la vie éternelle. Nous devons nous demander: ai-je la conviction que Dieu pardonne mes péchés? Ou bien est-ce que j’agis comme si je pouvais me sauver moi-même? Est-ce que j’aspire au salut et est-ce que j’invoque l’aide de Dieu pour l’obtenir? Est-ce que je vis concrètement l’espérance qui m’aide à lire les événements de l’histoire et qui me pousse à m’engager pour la justice, la fraternité, le soin de la maison commune, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte?
Sœurs et frères, grâce à l’amour de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes gardés dans l’espérance qui ne déçoit pas (cf. Rm 5, 5). L’espérance est «l’ancre de l’âme», sûre et indéfectible8. C’est en elle que l’Eglise prie pour que «tous les hommes soient sauvés» (1 Tm 2, 4) et qu’elle attend d’être dans la gloire du ciel, unie au Christ, son époux. C’est ainsi que s’exprime sainte Thérèse de Jésus: «Espère, ô mon âme, espère. Tu ignores le jour et l’heure. Veille soigneusement, tout passe avec rapidité quoique ton impatience rende douteux ce qui est certain, et long un temps très court» -(Exclamations de l’âme à son Dieu, 15, 3)9.
Que la Vierge Marie, Mère de l’Espérance, intercède pour nous et nous accompagne sur le chemin du Carême.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 6 février 2025,
mémoire de saint Paul Miki
et ses compagnons, martyrs
François
1 Cf. Lett. enc. Dilexit nos (24 octobre 2024), n. 220
2 Cf. Homélie de la Messe de canonisation des bienheureux Giovanni Battista Scalabrini et Artemide Zatti, 9 octobre 2022.
3 Cf. Idem.
4 Cf. Ibid.
5 Cf. Bulle Spes non confundit, n. 1.
6 Lett. enc. Spe salvi (30 novembre 2007), n. 26.
7 Cf. Séquence du dimanche de Pâques.
8 Cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1820.
9 Idem., n. 1821.
Message au ive Congrès organisé
par le Centre pour la protection
des mineurs du Celam
Extirper de la société le cancer
de l’abus sur les enfants
Chers frères,
A travers ce message, je désire m’unir à vous tous qui participez au ive Congrès latino -américain promu par le Ceprome (Centre de recherche et de formation pour la protection des mineurs, ndlr) et par la Commission pontificale pour la protection des mineurs, intitulé «Intelligence artificielle et abus sexuels: un nouveau défi pour la prévention», en demandant à Dieu de soutenir tous les efforts visant à extirper ce cancer de la société et, en particulier, de bénir l’initiative que vous promouvez et les fruits qu’elle est appelée à apporter.
Le thème que vous avez choisi est l’intelligence artificielle qui, telle un tsunami, a révolutionné les réalités déjà en soi toujours innovantes d’internet. Pour un prêtre âgé, les aspects techniques de ces thèmes peuvent apparaître difficiles à comprendre, et il est difficile de rester concrètement au courant de chaque avancée dans cet univers parallèle que nous avons décidé d’appeler le réseau. Toutefois, la vérité, la Vérité avec un «v» majuscule, qui est Jésus-Christ, sera toujours actuelle, et donc valable également pour la ré-flexion sur tout sujet qui se présente à nous comme nouveau.
Parmi les nombreuses questions qui pourraient se faire jour sur l’intelligence artificielle, et que vous affronterez certainement au cours de vos travaux de façon plus systématique, il m’en vient une à l’esprit, que je me permets de vous soumettre: celle de la responsabilité. Vous savez que l’utilisation d’internet crée un sentiment d’impunité, comme si une grande distance nous séparait de ce qui a lieu, tandis que nous l’observons d’une fenêtre lointaine. Bien que les circonstances soient très différentes, cette fragilité humaine nous a beaucoup changés. Adam et Eve avaient déjà tenté de faire retomber leur faute sur celui qui les avait tentés et, de façon encore plus grave, le roi David essaya de faire disparaître les traces de son délit, au point de commettre un crime encore plus horrible. Nous éloigner de notre respon-sabilité n’est donc pas une nouveauté.
Dans le cas de l’intelligence artificielle, cette prétention d’impunité augmente d’un cran, car l’on passe de la simple vision, transmission ou collecte de contenus inappropriés à la création d’un contenu «nouveau», synthétique. Le fait que nous n’ayons pas produit personnellement ces contenus pourrait créer la fausse illusion que nous ne sommes pas ceux qui «font» quelque chose de honteux: agresser une personne, voler une image, utiliser un concept ou une idée appartenant à un autre, exposer quelque chose d’intime qui devrait rester dans la sphère privée de la personne. Mais ce n’est pas vrai. La machine suit nos ordres, elle exécute, elle ne prend pas de décisions, mais elle est programmée pour le faire. Et, de même que nous connaissons le risque que nous courrons en montant dans une voiture très puissante si nous appuyons sur l’accélérateur ou si nous empiétons sur la voie opposée, ainsi, l’utilisation de ces technologies peut provoquer des dommages. Des dommages pour ceux qui, en -voyant ce que nous avons produit, veulent l’imiter: des dommages en raison de l’immense flux de contenus inappropriés qui contaminent l’environnement; des dommages en raison de la difficulté que rencontrent les autorités pour discerner les contenus réels des contenus synthétiques, afin de veiller sur la sécurité des éventuelles victimes, etc. La responsabilité de ces dommages revient tant à ceux qui utilisent la machine qu’à ceux qui l’ont conçue afin qu’elle soit sûre.
L’Ecriture peut nous illuminer sur la manière de répondre à ces défis, précisément dans l’épisode de David que j’ai cité, quand le prophète Nathan réprimande le roi pour son péché (cf. 2 S 12, 9). En premier lieu, en donnant une voix à Dieu et aux victimes qui L’implorent, afin qu’ils prennent conscience du mal qui est causé. En second lieu, en démasquant le mensonge qui consiste à nous retrancher derrière la technologie pour soulager notre conscience, en demandant aux personnes, aux concepteurs de ces technologies et aux autorités compétentes d’imposer des limites et des normes claires, concrètement évaluables, qui permettent de sanctionner leur utilisation nocive ou criminelle.
Que Jésus vous bénisse et que la Sainte Vierge vous protège. Et s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 13 janvier 2025
François
Audience générale
26 février 2025
«Flairer» la présence de Dieu
à travers l’enfant
Catéchèse préparée par le Pape:
Chers frères et sœurs, bonjour!
Aujourd’hui, nous contemplons la beauté de «Jésus-Christ, notre espérance» (1 Tm 1, 1) dans le mystère de sa Présentation au Temple.
Dans les récits de l’enfance de Jésus, l’évangéliste Luc nous montre l’obéissance de Marie et de Joseph à la Loi du Seigneur et à toutes ses prescriptions. En réalité, en Israël, l’obligation de présenter l’enfant au Temple n’existait pas, mais ceux qui vivaient dans l’écoute de la Parole du Seigneur et qui souhaitaient s’y conformer considéraient cette pratique comme précieuse. C’est ce qu’avait fait Anne, mère du prophète Samuel, qui était stérile; Dieu écouta sa parole et, après avoir eu son fils, elle l’amena au Temple et le consacra pour toujours au Seigneur (cf. 1 Sam 1, 24-28).
Luc raconte donc le premier acte du culte de Jésus, célébré dans la ville sainte, Jérusalem, qui sera le but de l’ensemble de son ministère itinérant à partir du moment où il prendra la ferme décision de s’y rendre (cf. Lc 9, 51), allant vers l’accomplissement de sa mission.
Marie et Joseph ne se limitent pas à inscrire Jésus dans une histoire de famille, de peuple, d’alliance avec le Seigneur Dieu. Ils prennent soin de lui et de sa croissance, et ils l’introduisent à l’atmosphère de la foi et du culte. Et eux-mêmes grandissent progressivement dans la compréhen-sion d’une vocation qui les dépasse de loin.
Dans le Temple, qui est une «maison de prière» (Lc 19, 46), l’Esprit Saint parle au cœur d’un homme âgé: Syméon, un membre du Peuple saint de Dieu préparé à l’attente et l’espérance, qui nourrit le désir de l’accomplissement des promesses faites par Dieu à Israël à travers les prophètes. Syméon perçoit la présence de l’Oint du Seigneur dans le Temple, voit la lumière qui resplendit au milieu des peuples plongés «dans les ténèbres» (cf. Is 9, 1) et va à la rencontre de cet enfant qui, comme le prophétise Isaïe, «nous est né», c’est le fils qui «nous a été donné», le «Prince-de-paix» (Is 9, 5). Syméon embrasse cet enfant qui, petit et sans défense, repose dans ses bras; mais c’est lui, en réalité, qui trouve la consolation et la plénitude de son existence en le serrant contre lui. Il l’exprime dans un cantique rempli d’une reconnaissance empreinte d’émotion qui, dans l’Eglise, est devenu la prière au terme de la journée:
«Maintenant, Souverain Maître, tu peux,
selon ta parole, laisser ton serviteur s’en aller en paix;
car mes yeux ont vu ton salut,
que tu as préparé à la face de tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël» (Lc 2, 29-32).
Syméon chante la joie de ceux qui ont vu, ceux qui ont reconnu et peuvent transmettre aux autres la rencontre avec le Sauveur d’Israël et des nations. Il est témoin de la foi, qu’il reçoit en don et qu’il communique aux autres; il est témoin de l’espérance qui ne déçoit pas; il est témoin de l’amour de Dieu, qui remplit de joie et de paix le cœur de l’homme. Comblé par cette consolation spirituelle, le vieux Syméon voit la mort non pas comme une fin, mais comme un accomplissement, comme une plénitude, il l’attend comme une «sœur» qui n’anéantit pas, mais qui introduit dans la véritable vie, dont il a eu un avant-goût et en laquelle il croit.
Ce jour-là, Syméon n’est pas le seul à voir le salut qui s’est fait chair dans l’enfant Jésus. C’est ce qui arrive aussi à Anne, femme de plus de 80 ans, veuve, qui se dédie entièrement au service du Temple et qui se consacre à la prière. A la vue de l’enfant, en effet, Anne célèbre le Dieu d’Israël, qui, précisément à travers cet enfant, a racheté son peuple, et elle le raconte aux autres, en diffusant avec générosité la parole prophétique. Le chant de la rédemption de deux personnes âgées libère ainsi l’annonce du Jubilé pour tout le peuple et le monde. Dans le Temple de Jérusalem, l’espérance se ravive dans les cœurs car Jésus-Christ, notre espérance, y a fait son entrée.
Chers frères et sœurs, imitons nous aussi Syméon et Anne, ces «pèlerins d’espérance» qui ont des yeux limpides capables de voir au-delà des apparences, qui savent «flairer» la présence de Dieu à travers l’enfant, qui savent accueillir avec joie la visite de Dieu et raviver l’espérance dans le cœur des frères et des sœurs.









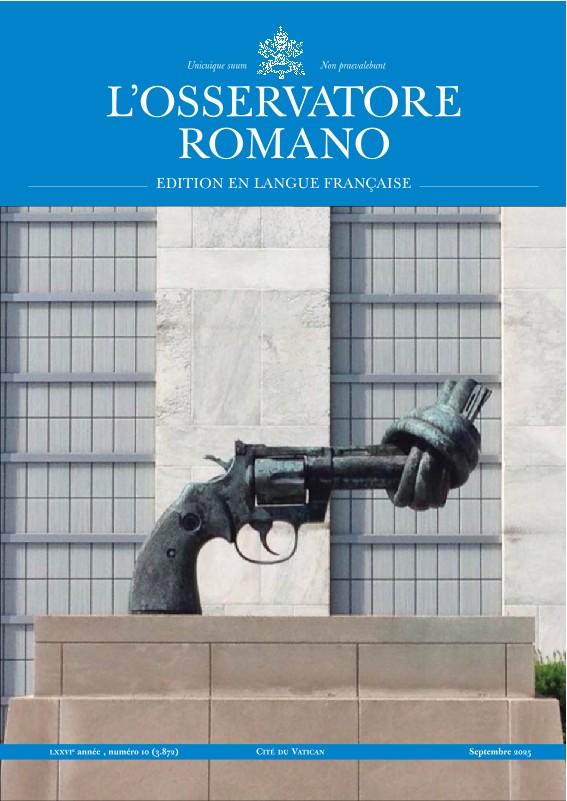



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
