
Lorsqu'en 2019, un évêque italien s'est excusé auprès des séparés, divorcés et remariés civilement pour « vous avoir souvent ignorés dans nos communautés paroissiales », l'effet a été celui d'un pavé dans la mare. Dans la lettre où il les invitait à une rencontre, Renato Marangoni, évêque-titulaire du diocèse de Belluno-Feltre, écrivait : « Nous nous sommes rigidifiés sur une vision très formelle des situations familiales auxquelles vous étiez arrivés ».
Il reçut de dures critiques du monde entier, mais aussi de nombreux témoignages de reconnaissance. Nombre d'entre eux provenaient de femmes qui mettaient l'accent sur l'amour. Perdu, retrouvé, contrarié, libéré.
Nous parlons d'amour. En tant que sentiment durable, générateur et capable de surprendre et de transformer. Mais il semble plus difficile à atteindre, plus compliqué à gérer parce qu'aujourd'hui les relations sentimentales sont confrontées à des défis qui rendent parfois le voyage de l'amour tortueux et imprévisible, et que les formes juridiques et sociales par lesquelles l'amour est canalisé ont changé. Les temps des relations sentimentales ne sont plus absolus, la durée d'une relation n'est pas prédéterminée : on se sépare, on divorce. On se remarie. Les couples ne sont pas seulement ceux traditionnels et leurs parcours sont multiples. Les familles sont « élargies ». Les femmes ne subissent pas tout et toujours. Et dans le couple éclatent parfois des drames : abus, violences, féminicides. Les jeunes ne sont pas exclus.
Et l'Eglise ? Comment répond-elle à l'évolution des réalités humaines, sentimentales et sociales, aux nouvelles formes d'amour, à la complexité des situations familiales modernes et aux situations de fragilité familiale qui se répercutent de manière plus importante sur les femmes ?
L'Eglise du troisième millénaire y a réfléchi lors de deux synodes sur la famille (2014-2015) et dans divers documents magistériels. François, avec le Motu Proprio Summa familiae cura, a institué en 2017 l'Institut théologique pontifical Jean-Paul II, qui a succédé à l'Institut fondé en 1982 par le Pape Wojtyla, consacré au mariage et à la famille. Penser à une nouvelle théologie, élargir le parcours d'études dans une perspective de dialogue pluraliste, avec des disciplines en sciences humaines à 360 degrés et les expériences pastorales des différents continents, est l'horizon qui a été donné à la nouvelle structure académique. Quelque chose a bougé, mais le changement reste laborieux.
« La théologie a pris l'habitude de considérer la famille à partir de l'institution du mariage. Il est temps de rompre avec cette habitude. Il n'est plus possible de s'appuyer sur une théologie et une pastorale du mariage qui appartiennent à un contexte ecclésial et social qui n'existe plus. Il faut avoir le courage de parcourir d'autres voies, plus créatives », dit Philippe Bordeyne, théologien moraliste, doyen de l'Institut. Par exemple ? « Si un couple non marié vient demander le baptême pour un enfant, nous pouvons réveiller le désir du mariage chrétien non pas en partant de la présentation doctrinale du sacrement, mais en valorisant la substance de ce qu'ils vivent déjà du mariage : l'accueil de la vie, l'effort d'élever un enfant, l'expérience merveilleuse de l'amour ».
Ensuite, rappelle Mgr Bordeyne, le Pape François lui-même, dans Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique sur l'amour dans la famille, affirme que « l'idéalisation excessive ne rend pas le mariage désirable et attrayant, mais tout le contraire ». En bref, pour le théologien qui a participé à quatre synodes, écoute et discernement sont les paroles-clés qui doivent caractériser une nouvelle approche de l'Eglise vis-à-vis des couples en recherche.
Pour l'Eglise, le mariage n'est pas limité dans le temps, il est indissoluble, mais François, en publiant il y a dix ans les Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus et Mitis et Misericors Iesus, a voulu réformer et simplifier les procédures du procès canonique pour obtenir la nullité du mariage. Celle-ci n'est plus l'apanage des VIP, des têtes couronnées ou autres personnes fortunées, comme elle était perçue dans l'imaginaire collectif jusqu'à récemment, mais elle est accessible à tous et plus rapidement.
Lors de l'inauguration de l'année judiciaire 2025, le 31 janvier, François a souligné devant le Tribunal de la Rote romaine, la nécessité de la gratuité des procédures.
Une réponse aux signes des temps. On se marie de moins en moins à l'église, on divorce, et pour les femmes, quitter le domicile conjugal ne signifie pas retourner au domicile paternel.
« Les changements introduits par François dans le processus matrimonial », explique Annarita Ferrato, avocate rotale et directrice de l'Institut supérieur des sciences religieuses « Monseigneur Vincenzo Zoccali » de Reggio Calabria, « ont fait de l'institution ecclésiale du jugement en nullité du mariage un instrument plus accessible pour fournir une réponse plus authentiquement pastorale ». Le procès en nullité est un instrument qui « permet de surmonter l’écart qui existe entre une apparence de mariage et la vérité du mariage lui-même ». La réforme se veut capillaire, mais les difficultés de mise en œuvre, en termes de formation du personnel et de recherche de structures, sont importantes.
Et la réalité des personnes séparées et des divorcés remariés interroge toujours plus l'Eglise. En Italie, à Milan, en 2008, sous l’impulsion du cardinal Dionigi Tettamanzi, ont été créés les premiers groupes pour accueillir les personnes qui se sentaient exclues de la participation à l'Eglise en raison d'un divorce ou d'une séparation. « Dans le diocèse, de nombreux couples sont séparés ou divorcés et, dans les paroisses, de nombreux agents pastoraux vivent cette situation », explique Alessandra Doneda, qui, avec son mari Giulio Gaetani, est la coordinatrice des groupes Acor (du prophète Osée : la vallée d’Acor comme porte d'espérance). Aujourd'hui, le travail porte non seulement sur l'accueil, mais aussi sur la gestion de la séparation.
« En Italie, la souffrance des enfants est plus grande que dans le reste de l'Europe, parce que la séparation est perçue comme une chose absolument négative, de sorte que de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à gérer leur relation avec leur ex-mari, leur ex-femme », dit Alessandra Doneda, citant l'étude Joint physical custody of children in Europe, publiée par la revue Demographic Research et reprise par Avvenire. Parmi ceux qui participent aux groupes, beaucoup reconnaissent que « leur idéal d'une famille “parfaite”, le fait d’être plus amoureux du mariage lui-même que de l'autre personne, a fait que l'ex-femme, l'ex-mari se sont sentis inadéquats, ce qui a conduit à la séparation ». Nombre des personnes qui suivent les parcours Acor participent activement à la vie de la communauté. Et le diocèse, sous l'impulsion du magistère papal, a formé ceux qui veulent accompagner les couples réconciliés sur un chemin pour recevoir à nouveau les sacrements.
En passant des parents aux enfants, s’ouvre un nouveau front. Il y a la question des relations avant le mariage, des cohabitations. « Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à fuir les “relations” privilégiant les “situations” : ils profitent de l'occasion pour vivre de bons moments, apprendre à se connaître, peut-être même avoir des relations sexuelles, mais sans se compromettre, sans devenir intimes. Montrer ses émotions est considéré comme trop risqué ! », explique la psychologue Michela Simonetto.
Ce sont des perspectives que ni la société ni l’Eglise ne peuvent pas ne pas voir. Ceux qui travaillent sur le terrain, dans les paroisses, dans les diocèses, signalent la nécessité d'un changement de rythme.
Certes, les expériences positives ne manquent pas pour les jeunes et les couples, mais il s’agit encore d’exceptions.
A Rome, une fois par mois, le samedi matin, il y a des couples mariés qui laissent de côté les enfants et les courses, la maison et la salle de sport, ce que les Italiens font généralement le week-end. Et ils sortent. Destination, la basilique Saint-Jean-de-Latran, où ils participent aux rencontres Vers le Mont Ararat organisées depuis deux ans par don Fabio Rosini, professeur de communication et de transmission de la foi, qui commente chaque semaine l'Evangile du dimanche pour Radio Vatican.
Ce sont des couples de tous les âges, plus ou moins trois mille personnes qui « s’embarquent sur l'arche de Noé, et tandis que le déluge fait rage, naviguent ensemble », dit le père Rosini, qui a inventé une formule qu'il avait déjà testée il y a des années dans la paroisse avec Gigi De Paolo, président de la Fondation pour la natalité, et son épouse Annachiara Gambini, mariés depuis vingt ans, cinq enfants. L’ordre du jour est fixe : les époux posent un problème très concret de leur vie conjugale ( « Comment vivons-nous l'intimité ? Comment faire la paix ? »), le père Fabio se réfère à la Parole. Les couples se confrontent, par whatsapp anonymes ils posent des questions au prêtre et aux époux, on tente de répondre.
« On parle beaucoup de la famille, mais il y a peu de propositions. Les prêtres ne sont pas formés pour accompagner les couples. Dans de nombreux cas, ce n'est pas le mariage qui est en cause, mais le cadre dans lequel il se déroule. Si au lieu de parler, même dans les cours pour fiancés, on se mettait à l'écoute des gens, peut-être que les choses iraient mieux. Au cours de ma longue expérience, j'ai compris qu'il fallait une préparation au mariage à distance, proche et immédiate », commente le père Rosini.
A Padoue, en revanche, un cours sur l'éducation affective et la prévention de la violence de genre a été lancé, où enseigne Michela Simonetto. Elle met en garde : « Le danger que court l'Eglise est de rester ancrée dans des lieux communs et des positions qui, au lieu de faciliter le dialogue, risquent d'éloigner, en apparaissant rigides et figés. L'Eglise doit au contraire avoir le courage de se dire et de dire que, pendant des siècles, elle a contribué à forger un certain modèle de couple, fondé sur la domination de l'homme et la soumission de la femme, allant jusqu'à justifier l'arrogance et la prévarication masculines et à inviter les femmes au sacrifice et au dévouement familial. Reconnaître déjà cela ouvrirait des voies importantes de réflexion et de remise en cause du statu quo ».
Sœur Fabrizia Giacobbe, dominicaine de Florence, est convaincue que « même si les manières de vivre l'amour ont profondément changé, chez la plupart des personnes ne semble pas avoir changé la conviction selon laquelle dans l'amour, c'est-à-dire dans l'expérience d'aimer et d'être aimé, se joue le sens de la vie ». Une conviction qui se heurte toutefois à une réalité souvent marquée par des illusions et des blessures, une fragilité relationnelle et un grand sentiment d'isolement que la société hyperconnectée a exacerbé. « C'est pour cela que des parcours éducatifs sérieux sont fondamentaux », affirme Fabrizia Giacobbe. Il y a des années, la religieuse a rencontré le groupe Kairòs, fondé en 2001 par des chrétiens LGBT+. La rencontre avec des jeunes LGBT, dit-elle, l'a aidée à comprendre comment ils vivent les mêmes dynamiques que leurs pairs dans leur parcours de maturation affective. La foi, souligne-t-elle, est une grande ressource pour eux.
« Il faut s'aimer soi-même pour vouloir le bien. C'est pourquoi le document final du Synode sur les jeunes invite à “aider chaque jeune, sans exclusion aucune, à intégrer toujours plus la dimension sexuelle dans sa propre personnalité” ». Le passage à effectuer, dit Fabrizia Giacobbe, est « d'une “pastorale pour” (par exemple conçue pour les personnes LGBT) à une “pastorale avec”, qui permette à tous les baptisés d’être partie intégrante et active de la vie ordinaire de la communauté chrétienne ». Le magistère de François, reconnaît-elle, va dans ce sens. Il suffit de citer Fiducia Supplicans, la Déclaration de la doctrine de la foi qui ouvre, non sans précisions et objections ultérieures, à la bénédiction des couples homoaffectifs. Le texte, dit sœur Fabrizia Giacobbe, demande à la communauté « d'accompagner les personnes dans le souci de toujours faciliter leur chemin de foi, indépendamment de la conformité ou de la non-conformité des situations personnelles à la doctrine morale ».
Et pourtant, selon la religieuse, un problème fondamental demeure : « La tension difficilement soutenable entre l'ouverture de la pastorale et une doctrine morale inchangée qui ne voit pas de possibilité d'amour chrétien authentique dans l'union de deux personnes du même sexe. De nombreux homosexuels vivent la non-reconnaissance de ce qu'ils considèrent comme leur vocation à l'amour comme une discrimination injuste ».
Vittoria Prisciandaro
Journaliste à « Credere » et « Jesus » Revues des éditions San Paolo









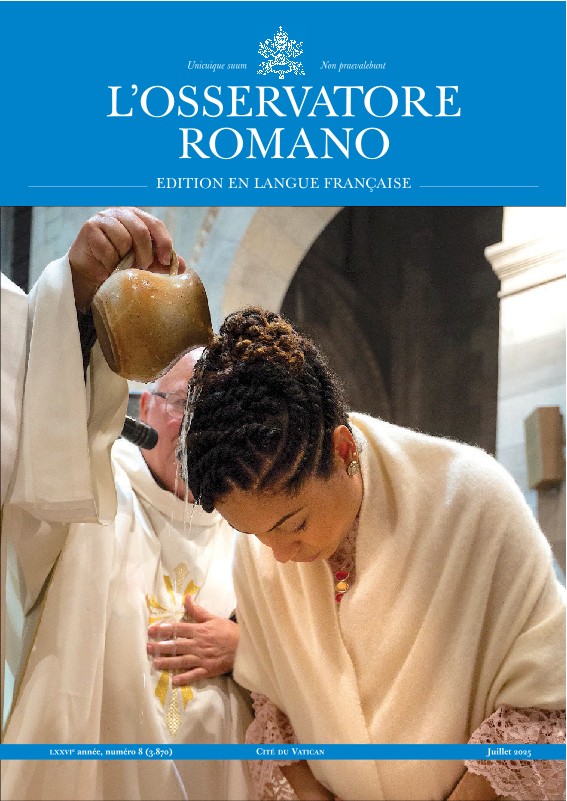



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
