
En traversant la Piazza Plebiscito, dans la direction qui mène du centre de Naples au front de mer, on se trouve à côté du Palais Royal. Sur sa façade se trouvent huit statues de souverains qui ont marqué l’histoire de Naples et pas seulement, chacune symbolisant et évoquant une dynastie particulière. Parmi eux, cependant, aucune femme. Et si l’on parle d’une femme souveraine, à Naples, on pense généralement à la reine Marguerite de Savoie, ne serait-ce que parce qu’elle a donné son nom au plat le plus célèbre du monde : précisément la pizza Marguerite.
Il y a pourtant une femme qui a marqué la vie politique et religieuse du royaume de Naples. Jeanne d’Anjou (1325-1382) fut la première reine régnante de Naples. Elle fut donc une souveraine, non pas en tant que reine consort d’un rois, mais parce qu’elle était l’héritière légitime de la dynastie qui s’était imposée en Italie du Sud dans la seconde moitié du XIIIe siècle, avec la fin des Hohenstaufen et l’établissement des Angevins, alliés de l’Église.
Alors qu’elle n’était encore qu’une enfant de sept ou huit ans, Jeanne avait été fiancée à un cousin éloigné, André de Hongrie. Son grand-père Robert avait voulu mettre les choses au point et, en 1333, il avait fait rédiger un contrat de mariage en bonne et due forme. André et Jeanne se marièrent en 1343 et lorsque Jeanne fut âgée de 17 ans, elle monta sur le trône de l’un des plus importants royaumes d’Europe et de la Méditerranée. Peu après, le roi consort André fut assassiné et Jeanne, tenue pour responsable du complot, dut faire face à son beau-frère Louis, roi de Hongrie. Elle épousa alors un autre parent, Louis de Tarente, le deuxième de ses quatre maris. Celui-ci tint les rênes du pouvoir, laissant apparaître le côté le plus sombre et le plus despotique de son caractère. Comme le rapporte un chroniqueur de l’époque, il traitait la reine plus comme une esclave que comme une épouse. La mort de Louis en 1362 fut accueillie par Jeanne comme une libération, ouvrant la porte aux années les plus brillantes de son règne. En effet, après des années très sombres, celles de la peste noire (1347-1352), dont on se souvient comme de la plus grande pandémie de l’histoire, celles des fuites précipitées pour échapper aux ennemis, du troisième mariage tout aussi malheureux avec Jacques de Majorque – elle épousa ensuite Otto de Brunswick-Grubenhagen en quatrième mariage –, Jeanne put se consacrer au bon gouvernement, aux œuvres de charité et de bienfaisance, à la construction d’églises et d’hôpitaux.
Jeanne d’Anjou finança la construction de la chartreuse de Saint-Martin, bâtie sur la colline du Vomero et achevée en 1367-68. Immédiatement après, elle commandita la construction d’un lieu utile pour célébrer le caractère sacré de sa mission, l’église de l’Incoronata, dont les fresques dans la nef centrale attribuées à Robert d’Oderisio, qui représentent les Sacrements, exaltent une initiative à forte valeur politique et sociale, mais aussi artistique, dans la continuité de l’œuvre réalisée par Giotto à Naples quelques décennies plus tôt. Elle ne négligea pas non plus l’aspect dévotionnel et caritatif. Il s’agissait en effet une église-hôpital qui eut le privilège de conserver une importante relique offerte par saint Louis de France, une épine de la couronne du Christ provenant du dépôt de la Sainte-Chappelle à Paris, d’où le nom de « Spinacorona » sous lequel l’église est connue dans la tradition napolitaine. Jeanne, dont la mère était morte à Bari lors d’un pèlerinage, était une reine de son temps, extrêmement pieuse, et elle portait fièrement le titre de reine de Jérusalem.
Sur le plan politique, Jeanne fut la principale interlocutrice du Saint-Siège, qui se trouvait alors en Avignon (sud de la France), lorsqu’il fallut défendre l’État pontifical contre les menaces de ses ennemis italiens, en particulier Milan et Florence. En outre, Jeanne encouragea le retour de la papauté en Italie, bien qu’elle ait elle-même essayé d’établir la curie papale à Naples plutôt qu’à Rome. En vertu de ses bons offices, elle reçut la rose d’or du Pape Urbain V en 1368, signe de distinction spéciale accordée par les Papes aux souverains. Pour se conformer aux souhaits des Papes, Jeanne mena des négociations en vue d’une trêve avec les Aragonais de Sicile, entérinée par le traité d’Avignon en 1372.
Jeanne régna trente-huit longues années. À partir de 1378, ces années furent à nouveau compliquées, en raison du contexte politico-ecclésiastique difficile qui s’était formé à la suite du schisme d’Occident, le fossé qui divisa l’Église de Rome de celle d’Avignon jusqu’en 1417. Après la mort de Grégoire XI, en effet, deux Papes furent élus dans des circonstances différentes. Après quelques hésitations, Jeanne prit le parti du Français Clément VII, entré dans l’histoire comme l’« antipape ». Le Pape Urbain VI, qui sortit victorieux de la querelle, accusa Jeanne d’hérésie, lui faisant perdre le trône de Naples au profit de son neveu Charles de Durazzo. Il condamna la souveraine sortante à l’exil, puis la fit assassiner dans le château de Muro Lucano et lui refusa même une sépulture chrétienne.
C’est sur cette base que se développa le chapitre post-mortem de la biographie de Jeanne, marqué par une « malafama » [mauvaise réputation] qui finit par s’imposer. Dans une vision machiste, Jeanne fut considérée comme une femme de peu de culture, surtout si on la compare à son grand-père Robert, dit le Sage. Pire encore, elle était décrite comme dissolue, lascive et de petite vertu. Des lieux comme les Bagni della Regina Giovanna, une plage célèbre près de Sorrente, et le Palazzo Donn’Anna à Posillipo, qui représente l’un des plus beaux lieux de Naples, ont été désignés comme le cadre de ses aventures amoureuses. Une autre victime de ce courant visant à ternir sa réputation fut son homonyme Jeanne II d’Anjou-Durazzo (1371-1435), marquée elle aussi par des vicissitudes dynastiques, des relations difficiles avec le Pape et des mariages malchanceux. On disait même que dans les douves du Maschio Angioino vivait un crocodile qui se nourrissait des amants que la reine prenait de temps à autre. Dans cette optique de la damnatio memoriae, il importait peu de savoir s’il s’agissait de la première ou de la seconde Jeanne. Dans la tradition populaire, il était d’usage de dire, pour manifester son mépris – et cela l’est toujours ! –, « tu es pire que la reine Jeanne ».
Pourtant, sous les règnes de ces deux reines, Naples, après avoir surmonté une longue crise, se distingua comme un centre commercial de référence de l’économie méditerranéenne et eut un important développement par rapport aux autres villes de l’Italie méridionale, se consolidant comme une capitale incontestée, grâce à un important développement démographique. Mais c’était également un centre de grande importance culturelle, à tel point que Boccace, que Jeanne accueillit comme un ami à sa cour, dédia à la première reine régnante de Naples son ouvrage sur les femmes les plus illustres (De mulieribus claris), dans lequel figure un profil biographique de la reine angevine. C’est à la seconde Jeanne que l’on doit l’achèvement, en style monumental – avec le tombeau de Ladislas et la chapelle Caracciolo del Sole – de l’église de San Giovanni a Carbonara, l’une des églises les plus méconnues, mais certainement parmi les plus belles de toute l’Italie.
Giuseppe Perta
Professeur d’histoire médiévale, Université de Naples Suor Orsola Benincasa









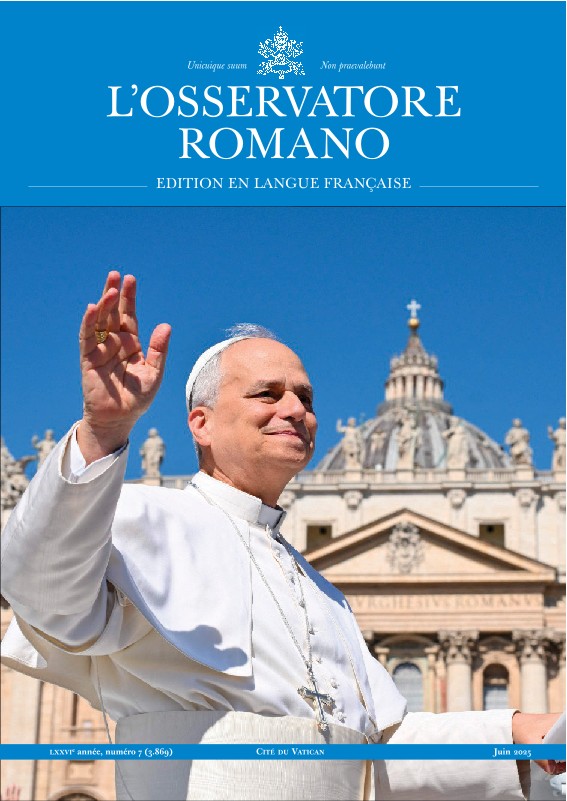



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
