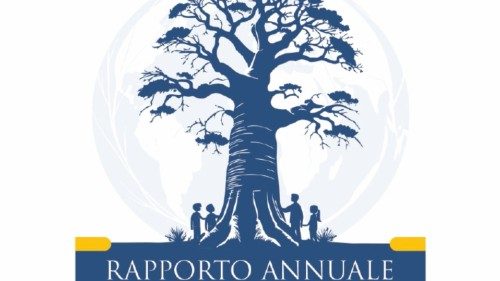
«Je voudrais que la Commission prépare et me soumette un Rapport sur les initiatives prises par l’Eglise relatives à la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Cette tâche pourrait s’avérer difficile au départ, mais je vous demande de commencer là où c’est nécessaire, de fournir un compte-rendu fiable sur ce qui se fait actuellement ainsi que sur ce qui doit changer, afin que les autorités compétentes puissent agir».
Après un travail long et intense, la Commission pour la protection des mineurs — organisme institué par le Pape en 2014 en vue de proposer les initiatives les plus opportunes pour prévenir les abus dans l’Eglise —, répondant à l’appel de François, a publié le 29 octobre le premier Rapport annuel sur les politiques et les procédures en matière de protection.
Composée d’une cinquantaine de pages et de quatre sections, le document recueille de nombreuses données sur les cinq continents et dans divers instituts et congrégations religieuses, ainsi qu'au sein de la Curie romaine elle-même, qui est appelée à une transparence toujours plus grande en matière de procédures et de processus.
Le document a été rédigé par un groupe de travail présidé par Maud de Boer-Buquicchio, membre de la Commission, ayant une longue expérience dans la défense des mineurs. Sur la couverture figure un baobab, symbole de «résilience», celle dont ont fait preuve des milliers de victimes qui ont dénoncé et lutté pour faire de l’Eglise un lieu toujours plus sûr et retrouver la confiance perdue à cause de ces crimes. C’est sur ces victimes, sur leur souffrance et sur leur guérison qu’est centré le travail de toute la Commission ainsi que le Rapport lui-même.
Plus spécifiquement, le Rapport — lit-on — veut promouvoir l’engagement de l’Eglise en vue d’apporter une réponse «rigoureuse» au fléau des abus, fondée sur les droits humains et centrée sur les victimes, en accord avec les récentes réformes du Livre iv du Code de droit canonique, qui définit le crime d’abus comme violation de la dignité de la personne.
Le texte présente les risques et les progrès accomplis dans les efforts de l’Eglise pour protéger les enfants. Il rassemble également les ressources et les best practices à partager dans l’Eglise universelle, et constitue un instrument pour la Commission lui permettant de rendre compte de façon systématique de ses conclusions et recommandations devant être partagées avec le Pape, avec les victimes, avec les Eglises locales et le Peuple de Dieu.
Parmi les «nécessités» identifiées par le document figure celle de mieux promouvoir l’accès des victimes et des survivants aux informations afin d’éviter d’engendrer de nouveaux traumatismes.
«Il faudrait étudier les mesures qui garantissent le droit de tout individu d’accéder aux informations le concernant», toujours «dans le respect des lois et des règlements concernant la protection des données», énonce le texte, qui réitère également le besoin de «consolidation et de clarté autour des juridictions tenues par les Dicastères de la Curie romaine, afin de garantir la gestion efficace, opportune et rigoureuse des cas d’abus qui ont été déférés au Saint-Siège», suggérant l’importance de rationaliser les procédures — «lorsque cela est nécessaire» — de démissions ou de destitution d’un responsable de l’Eglise.
Selon le Rapport, il est également nécessaire de «développer davantage le magistère de l’Eglise par rapport à son ministère de protection»; d’examiner les dommages et les politiques de compensation afin d’encourager une approche rigoureuse aux réparations; de promouvoir des opportunités de formation universitaire et des ressources adéquates aux aspirants opérateurs en matière de protection.
La deuxième section du Rapport annuel se concentre en revanche sur les Eglises locales et présente l’analyse d’un certain nombre d’institutions ecclésiales. La Commission reconnaît avant tout l’importance d’accompagner les responsables de l’Eglise locale dans leur responsabilité de mise en œuvre des politiques de prévention et de réponse.
Elle assure également «des échanges de données standardisées» avec les évêques et les supérieurs religieux locaux et explique que la révision des politiques et des procédures de protection présentées par les évêques a lieu dans le cadre du processus des visites ad limina, sur demande spéciale d’une conférence épiscopale ou d’un des groupes régionaux de la Commission.
Plus précisément, Tutela Minorum examine chaque année entre 15 et 20 Eglises locales, avec l’intention de couvrir l’ensemble de l’Eglise au cours d’une période qui concernera cinq à six rapports annuels. Chaque Rapport comprend en outre l’analyse d’une sélection d’institutions religieuses.
Les Conférences épiscopales en question sont: le Mexique, la Pa-pouasie-Nouvelle Guinée et les Iles Salomon, la Belgique, le Cameroun. Les Conférences qui ont effectué la visite ad limina au cours de la période de référence sont: Rwanda, Côte d’Ivoire, Sri Lanka, Colombie, Tanzanie, République démocratique du Congo, Zimbabwe, Zambie, Ghana, République du Congo, Afrique du Sud, Botswana, e-Swatini, Togo, Burundi. Les instituts religieux présentés dans le Rapport sont les Sœurs missionnaires de la Consolata (féminins), et la Congrégation des Spiritains (masculins).
Dans l’analyse des Eglises locales, la Commission souligne que «tandis que certaines institutions et autorités ecclésiastiques font preuve d’un engagement manifeste en matière de protection, d’autres ne sont qu’au début de leur engagement de responsabilité institutionnelle» à l’égard du phénomène des abus. Dans certains cas, la Commission se heurte à «un manque troublant de structures de communication et de services d’accompagnement» des victimes et des survivants, comme cela a été exigé par le Motu proprio Vos estis lux mundi.
De plus, les données recueillies par la Commission au sein des régions continentales font apparaître certains déséquilibres. Si, d’un côté, certaines régions d’Amérique, d’Europe et d’Océanie ont bénéficié de «ressources importantes disponibles pour les initiatives de protection», une partie conséquente de l’Amérique Centrale et du Sud, de l’Afrique et de l’Asie ne dispose que «de ressources dédiées inadéquates».
C’est pourquoi la Commission pontificale considère qu’il est fondamental de «renforcer la solidarité entre les conférences épiscopales dans les différentes régions», de «mobiliser les ressources en faveur de normes universelles de protection», de «créer des centres de signalement et de secours pour les victimes/survivant(e)s, et de «développer une vraie culture de la protection».
Dans la troisième section, le regard se porte en revanche sur la Curie romaine qui, en tant que «réseau de réseaux», pourrait représenter une sorte de plateforme de partage des bonnes pratiques en matière de protection pour les autres Eglises locales: «L’Eglise — affirme le Rapport — en faisant progresser sa mission de promouvoir les droits humains au sein de la société dans son ensemble, entre en relation avec toute une variété de populations auxquelles elle doit assurer des normes de protection appropriées».
Le même organisme pontifical se propose de promouvoir une vision commune et de recueillir des données fiables, afin d’encourager un niveau de transparence plus élevé dans les procédures et la jurisprudence de la Curie romaine par rapport aux cas d’abus. Il est souligné que la section disciplinaire du Dicastère pour la doctrine de la foi a partagé publiquement des informations statistiques limitées sur ses activités et les auteurs du Rapport demandent d’avoir accès à davantage d’informations.
Parmi les autres actions indiquées, figurent celles de «présenter les différentes responsabilités de protection des divers Dicastères»; «promouvoir l’élaboration de normes partagées de sauvegarde à travers la Curie romaine»; «diffuser des approches au travail des Dicastères qui tiennent compte des traumatismes et qui mettent les victimes/survivants au centre».
Dans le Rapport annuel sont en outre présentées les observations de «Case studies» concernant les différentes organisations de Caritas: Caritas Internationalis, au niveau universel; Caritas Oceania, au niveau régional; Caritas Chile, au niveau national; Caritas Nairobi, au niveau diocésain. On reconnaît «la grande complexité» de la mission entreprise par Caritas ainsi que les progrès accomplis concernant la protection au cours des dernières années; dans le même temps, on cons-tate «une variation considérable dans les pratiques de protection entre les diverses institutions». Un aspect au sujet duquel la Commission a manifesté sa préoccupation.
Le Rapport réserve une place également à l’initiative Memorare qui, au cours des dix dernières années, a recueilli des fonds de Conférences épiscopales et ordres religieux pour aider les Eglises ayant moins de ressources. L’objectif de Memorare est de développer dans les pays du Sud des centres pour les signalements d’abus, d’offrir une aide et des compétences pour la formation au niveau local, ainsi qu’un réseau local de professionnels en matière de protection.
Selon le Rapport, en 2023, la commission a reçu pour Memorare un premier don annuel de 500.000 euros de la part de la Conférence épiscopale italienne (qui s’est engagée à verser au total 1.500.000 euros); 35.000 euros du monde religieux; le premier don annuel de 100.000 dollars de la Fondation papal (qu s’est engagée à verser 300.000 dollars au total sur trois ans). En plus de cela, l’initiative a reçu une promesse de la Conférence épiscopale espagnole en vue de soutenir des projets choisis sur indication de la Commission pour un montant de 300.000 dollars par an (pour un total de 900.000 dollars sur trois ans).
Salvatore Cernuzio









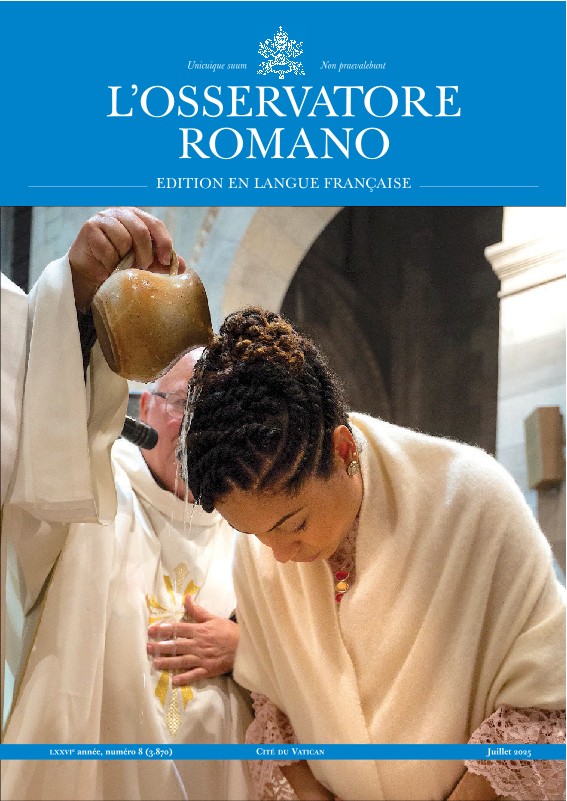



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
