
«Ecoute, créateur miséricordieux»: le chant d'entrée de la veillée pénitentielle, présidée par le Pape François dans la basilique Saint-Pierre dans l'après-midi du 1er octobre, renferme une des significations primaires du Synode sur la synodalité: celui de la conversion.
Une célébration sobre, mais intense, organisée par la secrétairerie générale du Synode et le diocèse de Rome en collaboration avec l'Union des supérieurs généraux et l'Union internationale des supérieures générales, à laquelle ont participé environ 2.500 fidèles, principalement des jeunes. Deux chœurs ont animé la célébration: celui du diocèse de Rome, dirigé par Mgr Marco Frisina, et celui de la communauté congolaise résidente de Rome. Avec simplicité, les participants et les membres de l'Assemblée synodale, ainsi que les jeunes et les fidèles romains, se sont préparés à l'écoute. L'écoute de la Parole de Dieu, mais aussi des uns les autres.
Après la lecture d'un passage du livre d'Isaïe (58, 1-14) est arrivé le moment émouvant des témoignages: trois voix ont raconté trois drames différents et éloignés, mais unis par la douleur. Les drames des abus, des migrations, de la guerre. C'est Laurence qui a témoigné en premier: à l'âge de 11 ans, en Afrique du Sud, il a été abusé par un prêtre. «Il m'a amené dans un lieu sombre, dans le silence hurlant, et m'a enlevé ce qui ne devrait jamais être enlevé à un enfant» a-t-il dit, dénonçant avec fermeté «le voile du secret que l'Eglise, historiquement, a préservé de façon complice». Laurence a aujourd'hui 53 ans, il est baryton de profession, mais n'a jamais oublié la violence qu'il a subie, l'anonymat qui entoure souvent les victimes, «réduites au silence à cause de la peur, de la stigmatisation ou des menaces».
Avec clarté, cet homme a parlé du «manque de transparence au sein de l'Eglise», d'«accusations ignorées, étouffées», d'un manque de responsabilité qui a remis en cause la confiance des -croyants. Mais pas seulement: les conséquences de ces abus, a conclu Laurence, vont «bien au-delà des murs de l'Eglise», provoquant «une crise de confiance qui se reflète dans la société» car «lorsqu'une institution aussi importante que l'Eglise catholique échoue à protéger ses membres les plus vulnérables, elle transmet le signal que la justice et la respon-sabilité sont négociables».
La voix de Sara, directrice régionale de la Fondation Migrantes Toscane, a été douce, mais ferme. Elle est arrivée à la basilique Saint-Pierre depuis le diocèse de Carrare pour témoigner des nombreux débarquements de migrants dans sa ville. «Dans notre port arrivent ceux qui ont survécu», survécu aux voyages inhumains, à la faim et à la soif, aux violences en tout genre qui laissent des marques sur le corps mais surtout dans l'âme. Ceux qui embarquent sur un «bateau de l'espérance», a-t-elle poursuivi, ne trouvent pas la solidarité d'une communauté qui voyage ensemble, mais la solitude de ceux qui luttent pour survivre, comme c'était le cas dans les camps d'extermination, où il n'y avait pas de personnes, mais uniquement des nombres. Des paroles de la responsable de Migrantes Toscane est également ressortie l'espérance de ceux qui, anxieux, attendent au port l'arrivée d'un proche, d'un ami, vivant dans la terreur de ne pas savoir si la personne a survécu ou non au voyage.
Le parcours de la migration, a rappelé Sara, est plus difficile pour les femmes, «silencieuses et invisibles», souvent victimes de violences aussi bien dans leur pays d'origine que durant la fugue vers une vie meilleure. Contraintes d'abandonner leurs enfants par peur qu'ils ne survivent pas au voyage, elles «meurent de l'intérieur», écrasées par la solitude et les remords, mais conscientes que l'unique façon de bâtir un avenir est de migrer. «Il n'y a pas d'autres choix: si vous voulez avoir la moindre possibilité de survivre et de continuer à donner de l'espoir à vos enfants, vous embarquez», a raconté Sara.
Avec elle, il y avait Solange: née en Côte d'Ivoire, elle a débarqué à Carrare il y a cinq mois et a apporté «toute son Afrique» aux participants au Synode. «Nous sommes ici aujourd'hui pour témoigner d'une humanité nouvelle», a conclu Sara.
Le troisième témoignage nous est arrivé d'un pays en guerre, la Syrie, racontée par la voix de sœur Deema Fayyad. Originaire de Homs et membre de la communauté monastique de al-Khalil — fondée en 1991 au monastère syro-catholique de Saint-Moïse-l'Abyssin par le jésuite Paolo Dall’Oglio, porté disparu depuis 2013 —, la religieuse syrienne a souhaité raconter «une expérience de profonde douleur» comme celle du conflit qui ne détruit pas seulement des «bâtiments et des routes, mais affecte aussi les liens les plus intimes qui nous rattachent à nos souvenirs, à nos racines». Avec une voix émue, empreinte d'une grande sensibilité, sœur Deema a souligné l'urgence de travailler sur les relations dans un monde «blessé par tant de violence». Car là où la guerre fait ressortir «le pire des hommes», mettant en avant «l'égoïsme, la violence et l'avidité», il est toujours possible de trouver une lumière dans la résistance non violente qui constitue «une dénonciation silencieuse de ceux qui tirent profit de la guerre en vendant des armes ou en s'emparant de terres».
Allumer des petites lumières dans l'obscurité du conflit est exactement ce qu'a fait la consacrée, s'engageant avec sa communauté en faveur des jeunes, créant pour eux des espaces de dialogue et de croissance». «Cela nous a permis de découvrir de plus précieux trésors parmi les décombres de la souffrance humaine: la solidarité et la fraternité, qui continuent de briller comme des signes d'espérance et de paix» car «également dans les moments les plus sombres, précisément là, il est possible de rencontrer Dieu».
Après la proclamation du passage de l'Evangile selon Luc sur le pharisien et la publicain (Lc 18, 9-14), le moment où sept cardinaux ont donné lecture à sept demandes de pardon a été tout aussi émouvant. Ponctuées d'un chant congolais et d'un Misericordias Domini chanté par l'assemblée, les demandes de pardon ont introduit, après un moment de silence, la réflexion du Pape François, suivie par le prière au Seigneur: «Nous te demandons pardon pour tous nos péchés, aide-nous à restaurer ton visage que nous avons défiguré par notre infidélité. Nous demandons pardon, avec honte, à ceux qui ont été blessés par nos péchés. Donne-nous le courage d’un repentir sincère pour la conversion».
Puis, avant la bénédiction et le chant de conclusion «Le Seigneur est ma lumière», François a remis un exemplaire de l'Evangile à deux jeunes, à un séminariste et à une sœur des missionnaires de la Charité: un geste symbolique pour transmettre aux générations futures une mission que l'on espère meilleure, toujours plus fidèle à la logique du Royaume de Dieu.
Isabella Piro









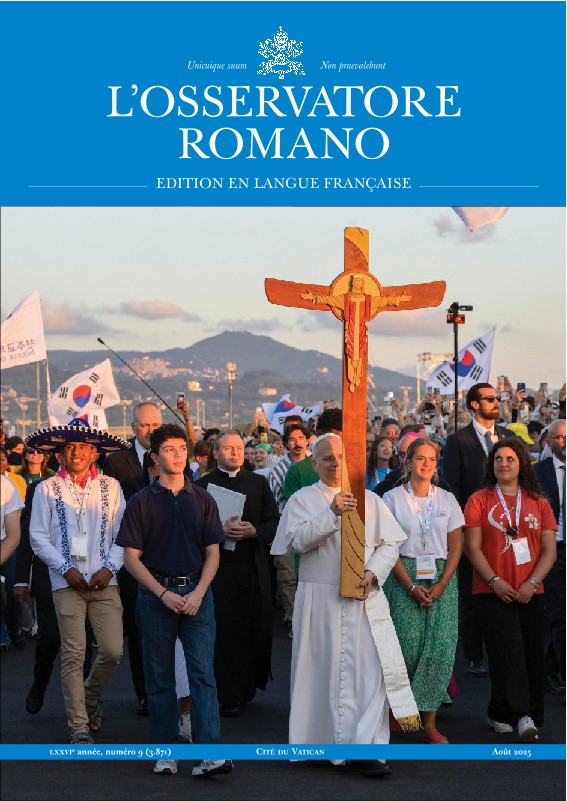



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
