Une foi qui va au-delà

L’épisode évangélique de la rencontre de Jésus avec la syro-phénicienne a fait couler beaucoup d’encre. Notamment parce que l’exégèse féministe en a fait un étendard : par rapport aux nombreux récits évangéliques de la rencontre de Jésus avec diverses femmes, celui-ci présente un attrait particulier. Elle sort gagnante parce qu’il a dû se plier non pas à son insistance, mais à son argumentation.
Ce n’est pas le seul cas, car à plusieurs reprises dans les évangiles, les personnages féminins ne correspondent pas au stéréotype de la femme faible qui a besoin d’aide. Des récits de miracles et même des paraboles émerge souvent l’image d’une femme qui sait ce qu’il faut faire, comme celle qui a des pertes de sang ou qui a perdu sa drachme, et surtout qui sait ce qu’il faut dire, comme la Samaritaine ou la veuve importune. La syro-phénicienne, qui lui est doublement étrangère parce qu’étrangère et parce que femme, apostrophe le prophète galiléen dans une langue qui n’est pas la sienne et l’affronte avec une surprenante fierté. Certes, une mère devient capable de tout lorsqu’elle a une fille malade, mais ce qui est frappant, c’est que face au rejet de Jésus, cette femme n’ajoute pas des larmes à ses supplications, mais le défie et le vainc. Par la dialectique : il lui dit alors : « A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille ». Pour l’évangéliste Marc (7, 24-30), contrairement à Matthieu (15, 21-28), ce ne sont pas les supplications de la femme qui convainquent Jésus, ni les demandes agacées des disciples qui veulent qu’elle s’en aille, ni sa foi, mais sa « parole ». La femme reste une étrangère, retourne dans son monde païen, ne se convertit pas.
Il était inévitable que cette femme devienne une icône dès le moment où les femmes croyantes purent enfin lire les pages de l’Évangile de leurs propres yeux et les interpréter avec leur propre intelligence. Et il faut dire aussi que cela rendait justice au texte, dans lequel l’accent est certainement davantage mis sur le protagonisme de l’étrangère que sur l’action thaumaturgique de Jésus qui, peut-être pour la première fois, accepte d’obéir aux circonstances.
Sans rien enlever à cette interprétation, qui est tout à fait évidente dans le texte lui-même, on ne peut cependant pas nier qu’à l’arrière-plan de la scène, il est possible d’entrevoir un troisième protagoniste qui, bien qu’implicite, confère à l’ensemble un niveau de signification supplémentaire auquel Marc et Matthieu, les deux seuls évangélistes qui relatent l’épisode, attribuent cependant une importance décisive. Ce troisième protagoniste n’est pas un personnage, mais une situation à la fois géographique et théologique. Il s’agit de la frontière.
Tout le récit insiste sur le fait que Jésus a rencontré la femme étrangère parce qu’il avait franchi la frontière qui séparait la terre d’Israël du territoire de Tyr et de Sidon, c’est-à-dire des régions païennes.
Selon le récit de Marc, l’importance de cet élément narratif reste implicite, mais Matthieu lui donne au contraire une connotation très forte. En effet, l’évangéliste met en évidence la valeur du dialogue entre Jésus et la femme au sujet du pain destiné aux enfants et non aux petits chiens sous la table, lorsqu’il ajoute au refus de Jésus d’accomplir le miracle une déclaration très importante d’un point de vue théologique : ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le pouvoir thaumaturgique du Messie, c’est le sens même de son messianisme. Le Messie a-t-il été envoyé à tous les hommes ou seulement « aux brebis perdues de la maison d’Israël » ? À qui s’adresse l’annonce de l’Évangile, seulement aux Juifs ou bien aussi aux païens ? Nous savons bien, à partir de l’expérience de l’apôtre Paul, que c’est là le grand problème des deux premières générations chrétiennes. Cet universalisme, que Paul poursuit de toutes ses forces, que Matthieu et Luc présentent comme une directive précise du Ressuscité aux disciples, Marc nous le laisse entrevoir précisément dans l’épisode de la femme étrangère. Apporter l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre n’était pas un choix arbitraire des disciples de Jésus après sa mort, ni le fruit de la foi en la résurrection et en l’exaltation pascale. En fait, Jésus lui-même avait déjà transgressé, franchi la frontière, tant géographique que théologique. Lui qui avait compris son messianisme uniquement en fonction de la reconstitution du peuple d’Israël, a en revanche accepté que non seulement les enfants aient faim de pain, mais aussi les petits chiens. Il a dû apprendre à être le Messie de tous. Et c’est justement sa rencontre avec cette femme étrangère qui le lui a appris.
Marinella Perroni
La foi d’une femme païenne
Partant de là, il s’en alla dans le territoire de Tyr. Etant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais il ne put rester ignoré. Car aussitôt une femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle le priait d’expulser le démon hors de sa fille. Et il lui disait : « Laisse d’abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Mais elle de répliquer et de lui dire : « Oui, Seigneur ! et les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants ! ». Alors il lui dit : « A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille ».
Elle retourna dans sa maison et trouva l’enfant étendue sur son lit et le démon parti.
Marc 7, 24-30









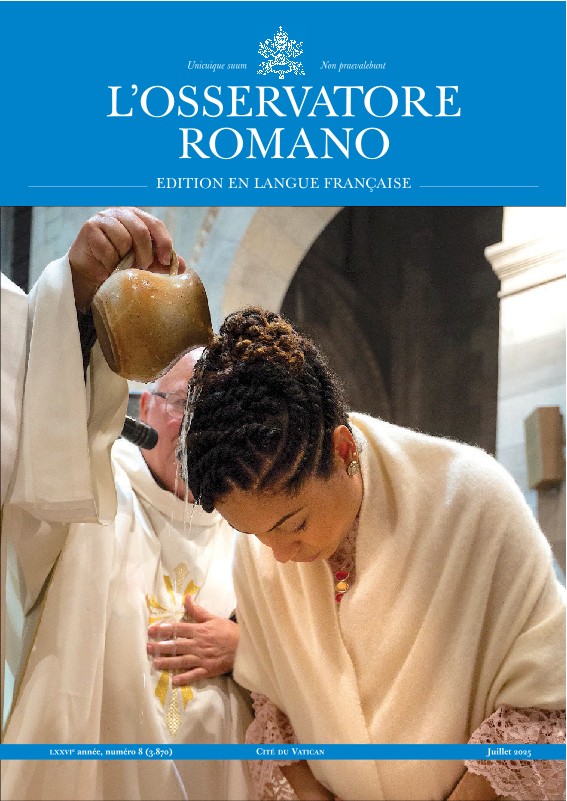



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
