
Nous célébrons la Nativité de Marie le 8 septembre, il s’agit de l’une des plus anciennes fêtes mariales. Nous en avons déjà des nouvelles au IVe siècle, à Jérusalem, coïncidant avec la célébration de la dédicace de la basilique Sainte-Anne, construite sur l’emplacement présumé de la maison de Joachim et Anna, indiqués par les Apocryphes comme ses parents. En Occident, elle fut célébrée à partir du VIIe siècle à l’initiative de Serge Ier, Pape d’origine syriaque.
Nous ne savons bien évidemment pas quand Marie est née. Les dates de son cycle, comme celles du cycle du Seigneur (et de saint Jean) sont toutes hypothétiques et liées à des cycles astraux et/ou agricoles, heureuses transsignifications de fêtes païennes. Nous ne connaissons à propos de Marie que ce que nous disent les Apocryphes et ce ne sont pas des données « historiques », comme d’ailleurs celles des Évangiles.
Le 8 septembre est donc lié à la piété populaire. Très vite le peuple de Dieu essaya de combler le « silence » des récits évangéliques, en prêtant attention à des détails imaginaires mais édifiants. C’est dans cette tension vers des événements réels, qui n’ont ni lieu, ni date, ni récit, que se situe la célébration de la naissance de la Mère du Seigneur. Sans son « oui », il n’y aurait pas eu d’incarnation. C’est d’elle que part la réalisation du projet de Dieu, qui en fait une demeure digne de sa Parole.
Ces raisons théologiques de poids accroissent la vénération, sans oublier que la présence de Marie constitue un correctif à la lecture univoquement patriarcale du salut. Par son intermédiaire, le peuple de Dieu a réacquis ce « féminin divin » éliminé des religions du Livre. D’où un attachement débordant à son égard, parfois proche de l’imaginaire et de la superstition. Face à un tel phénomène parfois lourd et embarrassant, Paul VI souhaita que soit rédigé un document qui recalibrerait la dévotion mariale, dix ans seulement après la fin de Vatican II. Il s’agissait de thésauriser ces avertissements déjà présents dans les derniers paragraphes de Lumen Gentium. La constitution dogmatique sur l’Église avait accepté la dissertation mariologique, restituant la mère du Seigneur à l’Église, comme son membre éminent et singulier, son type et son modèle ; cependant, en citant Pie XII, Pape d’une intense dévotion mariale, il avait averti sur la nécessité, œcuménique mais pas seulement, d’abandonner toute exagération vaine et crédule.
En effet, la croissance de l’attention portée à Marie est mêlée, au fil des siècles, à des manifestations imaginaires et imaginées. L’iconographie elle-même nous offre les différents regards sur la Mère du Seigneur. Elle l’a d’abord représentée dans les absides, soulignant sa proximité avec l’Église ; puis, pendant des siècles, elle l’a associée à son Fils, soulignant ses privilèges ; enfin, à l’âge moderne, elle a de nouveau été dessinée et exaltée seule, tandis qu’en polémique avec le minimalisme de la Réforme, l’accent placé sur sa fonction s’est accru, en même temps que se multipliaient les pratiques pieuses. Ce n’est pas un hasard si nous, les catholiques romains, avons été accusés de la substituer à l’Esprit Saint dans un excès de prérogatives qui, en vérité, lui appartiennent. À cela s’ajoute la multiplication des visions vraies ou supposées, des pèlerinages ... sans parler des déclinaisons infinies avec lesquelles les différentes familles religieuses sont liées à Marie. Dans tout cela, il faut également lire en arrière-plan une certaine vision de la femme et de la femme-mère, utilisée comme antidote à la croissance de la conscience féminine et à son émancipation.
L’Exhortation apostolique Marialis Cultus promulguée le 2 février 1974 et dont c’est le 50e anniversaire, reste à mon avis, dans ses trois parties, le plus beau document rédigé à ce jour pour faire la lumière sur la Mère du Seigneur. On y respire l’enthousiasme du Concile et tout le tournant anthropologique propre à ces années. Pour la première fois, en dehors des stéréotypes pieux, une place est faite à l’image théologique de Marie.
Paul VI s’intéresse au « culte de la Vierge Marie dans la liturgie ». Il s’agit d’une double analyse : la « Vierge dans la Liturgie romaine restaurée » ; Marie comme « modèle de l’Église dans l’exercice du culte ». Les numéros dans lesquels il la propose comme Vierge à l’écoute, Vierge en prière, Vierge Mère, Vierge Offrante sont vraiment évocateurs. « Modèle de toute l’Église dans l’exercice du culte divin, ... maîtresse de la vie spirituelle de chaque chrétien ... Marie ... est avant tout un modèle de ce culte qui consiste à faire de sa vie une offrande à Dieu ».
Destiné à promouvoir « le renouveau de la piété mariale », le document se développe selon trois notes et quatre orientations. La « Note trinitaire, christologique et ecclésiale dans le culte de la Vierge » rappelle la nature du culte chrétien – toujours ad Patrem per Filium in Spiritu Sancto – , non sans un accent explicite sur l’Esprit qui revient comme protagoniste de la piété comme de la recherche théologique. Suivent alors, et c’est la partie la plus originale, les « Quatre orientations pour le culte de la Vierge : biblique, liturgique, œcuménique, anthropologique ». Pour Paul VI, il est fondamental de ramener Marie au témoignage de l’Écriture, tout comme il est important de lier la dévotion à son égard au temps liturgique. Tout aussi importante est la nécessité, déjà mentionnée, d’éviter tout ce qui pourrait entraver le dialogue œcuménique.
Pour ma génération, l’Exhortation Marialis Cultus reste liée à l’orientation anthropologique. En effet, il y est précisé que Marie n’a pas été proposée à l’imitation des fidèles en raison du type de vie qu’elle a mené ou du milieu dans lequel elle s’est déroulée, aujourd’hui dépassés dans une grande partie du monde, mais parce que « dans sa condition concrète de vie ... elle a adhéré ... à la volonté de Dieu (Luc 1, 38) ; parce qu’elle a accueilli sa parole et l’a mise en pratique ; parce que son action a été animée par la charité et l’esprit de service ; parce que, en somme, elle a été la première et la plus parfaite disciple du Christ ».
Le Pape est bien conscient des difficultés et des réserves que la théologie féministe naissante oppose à l’image de Marie, et c’est précisément pour cette raison qu’il distingue son image évangélique des représentations culturelles de la vierge-épouse-mère. « L’Église, affirme-t-il, ne se lie pas aux schémas représentatifs des différentes époques culturelles ni aux conceptions anthropologiques particulières qui les sous-tendent, et elle comprend que certaines expressions du culte, parfaitement valables en elles-mêmes, soient moins adaptées à des hommes appartenant à des époques et à des civilisations différentes » (n. 36).
« Notre époque ... est appelée à vérifier sa compréhension de la réalité avec la Parole de Dieu et ... à confronter ses conceptions anthropologiques et les problèmes qui en découlent avec la figure de la Vierge Marie, telle qu’elle est proposée par l’Evangile. La lecture des divines Ecritures ... en tenant compte des acquisitions des sciences humaines et des diverses situations du monde contemporain, conduira à découvrir comment Marie peut être considérée comme un modèle de ces réalités qui constituent les attentes des hommes de notre temps ».
Le résultat pour les femmes contemporaines, désireuses de participer avec un pouvoir de décision aux choix de la communauté, est la découverte de Marie comme une femme qui a donné à Dieu son consentement actif et responsable ; dont le choix virginal n’a pas signifié la fermeture aux valeurs de l’état matrimonial... Une femme ni soumise ni aliénée ; une femme forte qui a connu la souffrance, la pauvreté, l’exil... En somme, une Marie qui incarne les valeurs de la théologie de la libération contemporaine.
Les exemples proposés dans le sillage de l’Écriture prouvent tous que « la figure de la Vierge ne déçoit pas certaines attentes profondes des hommes de notre temps et leur offre le modèle accompli du disciple du Seigneur : artisan de la cité terrestre et temporelle, mais pèlerin assidu vers la cité céleste et éternelle ; promoteur de la justice qui libère les opprimés et de la charité qui aide les nécessiteux, mais surtout témoin actif de l’amour qui construit le Christ dans les cœurs ».
La dernière partie propose des « Instructions pour les pieux exercices de l’Angélus et du Saint Rosaire » (III).
L’Exhortation se termine en rappelant que la piété envers la Vierge Marie est un élément intrinsèque du culte chrétien. La dévotion à son égard est « une aide puissante pour l’homme sur son chemin... Elle, la Femme nouvelle, est aux côtés du Christ, l’Homme nouveau, et ce n’est que dans le mystère de celui-ci que le mystère de l’homme trouve la vraie lumière... ».
Il n’est pas difficile de discerner dans ces expressions un écho de Gaudium et Spes. Et les expressions qui suivent évoquent à nouveau cette constitution : « À l’homme contemporain, souvent tourmenté entre l’angoisse et l’espérance, prostré par le sentiment de ses limites et assailli par des aspirations sans limites, troublé dans son âme et divisé dans son cœur, l’esprit suspendu par l’énigme de la mort, opprimé par la solitude alors qu’il tend à la communion, en proie au dégoût et à l’ennui, la Bienheureuse Vierge Marie, contemplée dans son récit évangélique et dans la réalité qu’elle possède déjà dans la Cité de Dieu, offre une vision sereine et une parole rassurante : la victoire de l’espérance sur l’angoisse, de la communion sur la solitude, de la paix sur le trouble, de la joie et de la beauté sur l’ennui et le dégoût, des perspectives éternelles sur les perspectives temporelles, de la vie sur la mort ».
Aussi étrange que cela puisse paraître, Marialis Cultus n’a pas été accueillie par les femmes dans sa valeur novatrice. D’autre part, l’Année internationale de la Femme, bien que célébrée en 1975, avait eu comme préliminaire en 1974 l’admission des seuls viri probati aux ministères « laïcs ». L’année 1976 verra par ailleurs la publication d’Inter Insigniores, le document qui, tout en laissant la question ouverte, invoquait la tradition comme motif pour refuser aux femmes l’admission au ministère ordonné.
Une fois de plus, l’accent mis sur Marie, bien qu’exprimé d’une manière appropriée au tournant conciliaire, laissa donc les femmes en marge de la subjectualité ecclésiale, presque comme s’il n’y avait besoin que d’une seule femme. La force subversive du Magnificat, bien que reconnue et soulignée, ne suffit pas à changer leur position ecclésiale.
Cettina Militello
Théologienne, vice-présidente de la « Fondazione Accademia Via Pulchritudinis ETS ».









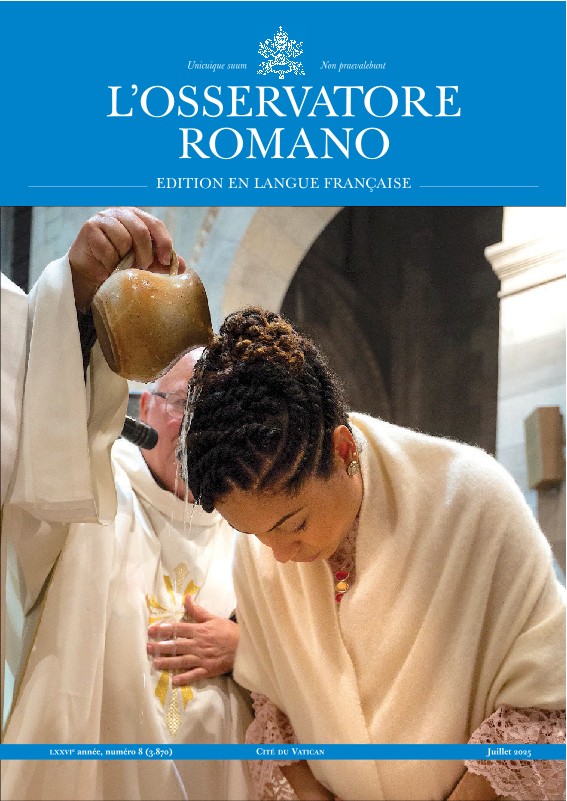



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
